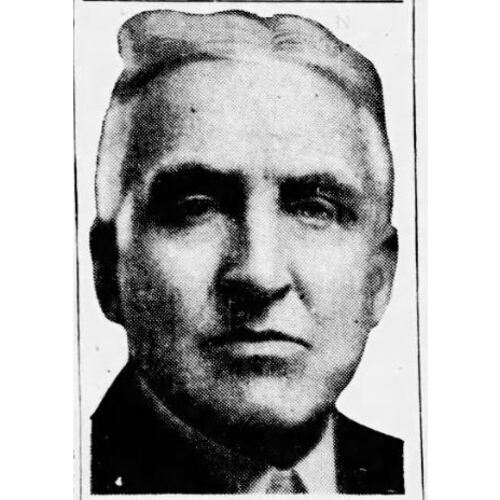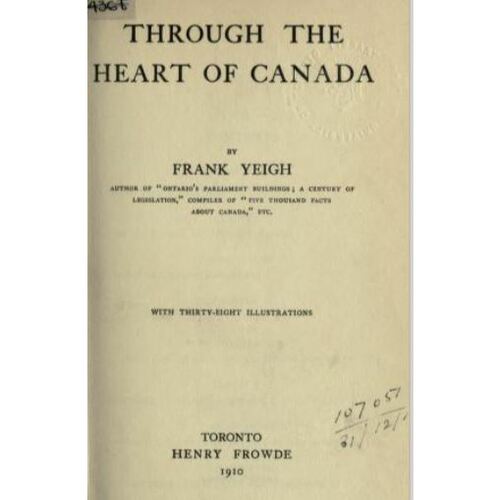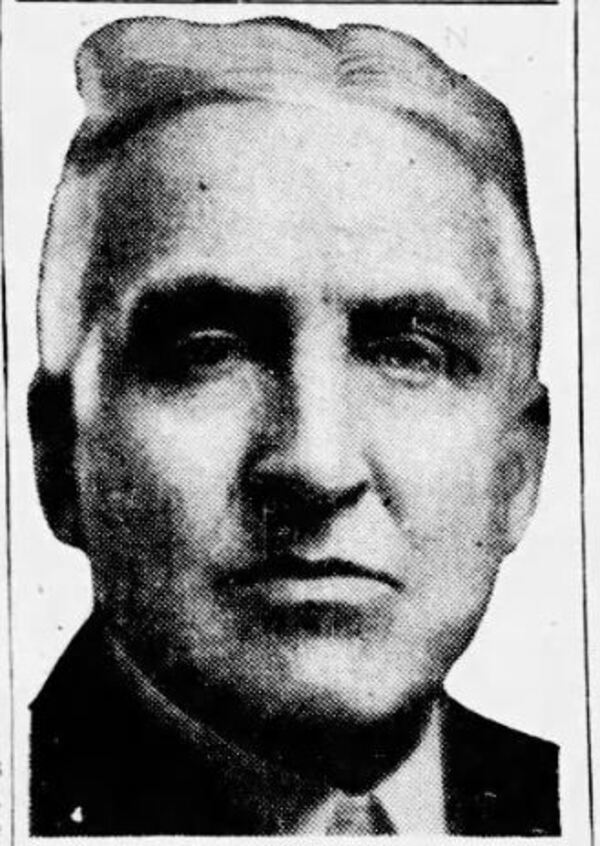
Provenance : Lien
YEIGH, FRANK, imprimeur, éditeur, auteur, conférencier, publicitaire et fonctionnaire, né le 21 juillet 1860 dans le canton de Burford, Haut-Canada, fils d’Edmund Lossing Yeigh et d’Adaliza (Ada) Whitehead ; le 27 octobre 1892, il épousa à Toronto Kate Eva Westlake* (1856–1906), et ils n’eurent pas d’enfants, puis le 2 septembre 1908, à Kingston, Ontario, Annie Louise Laird, et ils eurent un fils ; décédé le 2 octobre 1935 à Toronto et inhumé dans cette ville au cimetière Mount Pleasant.
Autodidacte, Frank Yeigh, que le Canadian Alpine Journal décrirait comme « minutieux, mais non ambitieux », descendait d’Allemands de Pennsylvanie et d’Écossais. Auteur prolifique, il n’eut cependant guère d’influence. Intrigué par diverses technologies, notamment la presse à imprimer, le phonographe et les lanternes magiques, il utilisa ces appareils au cours de sa carrière de publicitaire et de conférencier. Vraisemblablement inspiré par la tradition de service militaire dans sa famille, Yeigh croyait que les Canadiens avaient la responsabilité de soutenir l’Empire britannique. Parmi ses réalisations figurent principalement son habileté à susciter l’intérêt des gens pour le Canada et son histoire, et son aide aux jeunes. Convaincu de la valeur des services sociaux, il joua un rôle important dans la fondation du Save the Children Fund au pays.
La curiosité de Yeigh pour l’édition s’éveilla très tôt : quand sa famille acquit une presse à imprimer d’occasion, il commença avec son frère Henry à publier le « Burford Pioneer » dans la ferme familiale. Ses études primaires terminées, Yeigh travailla à titre d’apprenti imprimeur au Brantford Expositor, puis se rendit à Chicago, où il apprit la sténographie et enrichit ses connaissances en édition. À la fin de son adolescence, il s’installa à Toronto et, en 1880, démarra sa carrière de rédacteur à compte d’auteur avec l’éphémère Canadian Illustrated Shorthand Writer. La même année, il devint registraire pour Arthur Sturgis Hardy*, alors député provincial de Brant South. En 1887, Yeigh produisit le Canadian Advance, hebdomadaire de faits divers sérieux qui dura environ un an. À partir de 1903, il fit aussi paraître une brochure annuelle, 5000 Facts about Canada, dont les fonctionnaires fédéraux du ministère de l’Immigration achetaient, semble-t-il, un grand nombre d’exemplaires ; on les envoyait peut-être à l’étranger pour les distribuer à des immigrants potentiels.
Après son engagement auprès de Hardy, Yeigh continua à écrire et à publier, souvent officiellement. En 1890, le député lui demanda de faire de la publicité pour la région lointaine autour de la rivière à la Pluie, commande parue sous le titre The Rainy River District, province of Ontario, Canada. Trois ans plus tard, Yeigh rédigea une chronique historique, Ontario’s parliament buildings : or a century of legislation, 1792–1892, à l’occasion de l’inauguration des nouveaux édifices législatifs de la province à Queen’s Park [V. Kivas Tully*]. Quand le premier ministre sir Oliver Mowat* prit sa retraite, en 1896, Hardy lui succéda et Yeigh fut promu greffier des Terres de la couronne.
Au début des années 1890, Yeigh avait commencé à courtiser l’écrivaine Kate Eva Westlake, dont le roman à quatre sous sur le chef Sitting Bull [Ta-tanka I-yotank*], Sitting Bull’s white ward, publié anonymement à New York, devint très populaire aux États-Unis en 1891. Ils se marièrent en octobre 1892. En janvier de la même année, Yeigh avait animé une soirée sur la littérature canadienne à Toronto, parrainée par le Young Men’s Liberal Club, qu’il présidait depuis peu. William Wilfred Campbell*, William Douw Lighthall*, Agnes Maule Machar* et Duncan Campbell Scott* faisaient partie du programme. Il invita également Emily Pauline Johnson*, auteure de deux poèmes publiés en 1889, pour donner un récital ; elle connut un tel succès que Yeigh organisa pour elle un second événement en février. Il lui servit d’agent de promotion et de publicité jusqu’à ce que l’artiste embauche, en 1894, un gérant professionnel. Yeigh continuerait de l’aider : un an plus tard, par exemple, il la défendit contre des critiques dans le Week. Sa vie durant, Mlle Johnson demeura profondément reconnaissante envers celui qu’elle appelait son « Yeigh-man » pour les efforts qu’il déploya en son nom.
Yeigh s’impliqua de plus en politique, dans les événements courants et l’engagement civique. Il publia principalement des travaux sur l’histoire et la biographie canadiennes. Il guida aussi, à Niagara, la visite de lieux commémoratifs de la guerre de 1812. Comme correspondant littéraire membre de la direction du Canadian Club of Toronto, il mit sur pied un programme d’installation de plaques historiques. En 1901–1902, il agit à titre de trésorier pour l’Ontario Historical Society et, en 1903, on le nomma vice-consul pour le Paraguay à Toronto.
Grand voyageur, Yeigh assista à l’Exposition universelle de Chicago en 1893 et se rendit en Europe l’année suivante. En 1906, après la mort de sa première femme, il partit pour la Colombie-Britannique ; membre de l’Alpine Club of Canada, il fit une randonnée dans le parc national Yoho. Là, au milieu des « collines de Dieu », comme il appela les Rocheuses dans le premier numéro du Canadian Alpine Journal, il rencontra Annie Louise Laird ; institutrice de près de 20 ans sa cadette, elle était une amie d’Elizabeth Parker [Fulton*], cofondatrice de l’Alpine Club of Canada. Deux ans plus tard, Yeigh épousa Annie Louise, dont l’héritage lui permit de quitter la fonction publique. Ils demeurèrent actifs le reste de leur vie. Yeigh écrivit et discourut beaucoup sur ses voyages, se servant souvent des technologies les plus avancées, dont, pendant ses tournées de conférences, une lanterne magique. En 1910, il partagea ses impressions sur le pays dans le livre intitulé Through the heart of Canada, destiné aux lecteurs britanniques et américains. Il y laissait clairement entendre son amour du Canada, terre de libertés civiles et d’opportunités économiques, prête à accueillir les nouveaux venus qui pouvaient contribuer à forger un nouveau pays « canadianisé » et « cosmopolite ». Néanmoins, le grand nombre d’Asiatiques sur la côte Ouest lui donnait matière à réflexion. « L’Oriental, pensait-il, […] possède ses propres vices et vertus, ses propres croyances et manières inaltérables, son propre point de vue » et, par conséquent, « il semble certain qu’[il] ne peut être assimilé ».
Quand le gouvernement d’union de sir Robert Laird Borden imposa la conscription en 1917, Yeigh, favorable à la mesure, se joignit au War Lecture Bureau, que dirigeait le département de l’Information publique, et en devint le secrétaire à l’organisation à l’échelle nationale. Le bureau avait pour but de contrer la propagande allemande. Yeigh assuma son rôle administratif, écrivit, donna des conférences et prépara des discours pour d’autres membres de l’organisation. Libéral nationaliste, et partisan du Canada et de l’Empire britannique, Yeigh affirmait que le conflit constituait un banc d’essai pour la démocratie canadienne.
Yeigh et sa première femme avaient fréquenté l’église presbytérienne Bloor Street ; en 1892, il y mit sur pied une grande classe d’études bibliques pour jeunes hommes, qui remporta beaucoup de succès. Tous deux collaborèrent aussi grandement à la Young Men’s Christian Association, pour laquelle Yeigh réalisa une brochure sur l’immigration en 1911. Après la guerre, Annie Louise et lui se joignirent au Forward Movement, organisation évangélique adoptée par les presbytériens et d’autres églises dans le but de raviver l’idéalisme de la jeunesse désillusionnée par le conflit.
Pendant l’adolescence de son fils unique, Yeigh devint membre du National Boys’ Work Board du Religious Council of Canada, qui encourageait les garçons de l’âge du sien à pratiquer des activités physiques. Ce rôle lui était familier. Yeigh siégeait au conseil de la Young Men’s Christian Association de Toronto et avait lancé sa classe d’études bibliques près de 30 ans auparavant. Son approche nouvelle, qui favorisait la participation des élèves et la conscience sociale, influença d’innombrables personnes, dont le juriste James Chalmers McRuer*.
En 1922, Frank Yeigh, aidé d’Annie Louise, contribua à la création à Toronto d’une filiale canadienne du Save the Children Fund britannique fondé en 1919. Il devint le secrétaire de l’organisation du comité en 1925. L’association secourait les enfants affectés par la guerre et Yeigh, qui en était le correspondant pour l’Angleterre, publia une certaine quantité d’articles sur les jeunes victimes des conflits mondiaux. À la mort de son mari, en 1935, Annie Louise prit sa relève. Le Save the Children Fund acquit le statut d’organisme canadien indépendant en 1946, et se révéla le legs le plus durable de Yeigh.
Les AO conservent des exemplaires de la plupart des textes de l’œuvre imposante de Frank Yeigh. Parmi ses publications importantes figurent : The Rainy River District, province of Ontario, Canada […] (Toronto, 1890) ; Ontario’s parliament buildings ; or, a century of legislation, 1792–1892 : a historical sketch (Toronto, 1893) ; 5000 Facts about Canada, (Toronto), 1903 ?–1934 ? ; One thousand facts about Canada (Toronto, [1906 ?]) ; « Canada’s first alpine club camp », Canadian Alpine Journal (Winnipeg), 1 (1907), 47–57 ; Through the heart of Canada (Toronto, 1910) ; Educating the coming Canadians ([Toronto, entre 1911 et 1914]) ; et « The span of a Canadian generation », Empire Club of Canada, Addresses (Toronto), 1913 : 238–249. Il a également publié ou édité plusieurs revues éphémères, notamment le Canadian Illustrated Shorthand Writer (Toronto), mai 1880–août 1881, et le Canadian Advance (Toronto), 1887–1890.
Ancestry.com, « Décès de l’Ontario et décès à l’étranger, Ontario, Canada, 1869 à 1949 », Frank Yeigh, 26 oct. 1935 : www.ancestry.ca/search/collections/8946 (consulté le 19 mars 2024).— AO, F 1085 (Frank Yeigh fonds) ; RG 80-5-0-201, no 015242 ; RG 80-5-0-376, no 009156.— Arch. de l’Église presbytérienne au Canada (Toronto), Committee on the Forward Movement records, 1919–1923.— BAC, R233-35-2, Ontario, dist. Brant South (159), sous-dist. Brantford (A), div. 7 : 56 ; R1867-0-3 ; R5181-0-2 ; MG30-C187, vol. 8, dossier 368 (Robert Boyer Inch fonds, League of Nations Soc., corr., Yeigh, Frank) ; R10811-0-X ; RG76-I-A-1, vol. 356, dossier 396503 (Frank Yeigh, Toronto, Ontario, pamphlet « 5000 facts about Canada » ; mfm. accessible à : heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_c10260, image 1134).— Queen’s Univ. Arch. (Kingston, Ontario), Annie Louise (Laird) Yeigh fonds.— TRL, Marilyn & Charles Baillie Special Coll. Centre, Biog. scrapbooks, 6 : 735 ; 9 : 62.— Globe, 28 oct. 1935.— Toronto Daily Star, 28 oct. 1935.— Week (Toronto), 22 févr., 1er mars 1895.— M. E. Cameron, « “How the dominion heard the cry” : the early history of the Canadian Save the Children Fund, 1922–1946 » (mémoire de m.a., Univ. of Guelph, Ontario, 2001).— « Frank Yeigh : an appreciation », Canadian Alpine Journal (Winnipeg), 24 (1936), 115–116.— Charlotte Gray, Flint & feather : the life and times of E. Pauline Johnson, Tekahionwake (Toronto, 2002).— The hour of prayer : a book of fifty-two prayers for use in the home, Mrs Frank Yeigh [K. E. Laird], compil. (s.l., 1921).— R. C. Muir, The early political and military history of Burford (Québec, 1913).— PearlAnn Reichwein, Climber’s paradise : making Canada’s mountain parks, 1906–1974 (Edmonton, 2014).— Veronica Strong-Boag et Carole Gerson, Paddling her own canoe : the times and texts of E. Pauline Johnson (Tekahionwake) (Toronto, 2000).
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Terry Crowley, « YEIGH, FRANK », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 16, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 6 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/yeigh_frank_16F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/yeigh_frank_16F.html |
| Auteur de l'article: | Terry Crowley |
| Titre de l'article: | YEIGH, FRANK |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 16 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 2025 |
| Année de la révision: | 2025 |
| Date de consultation: | 6 déc. 2025 |