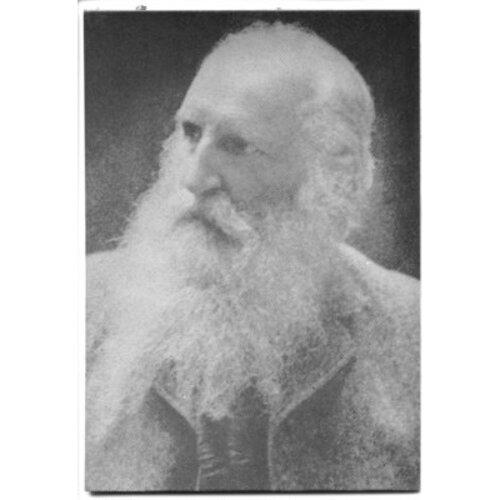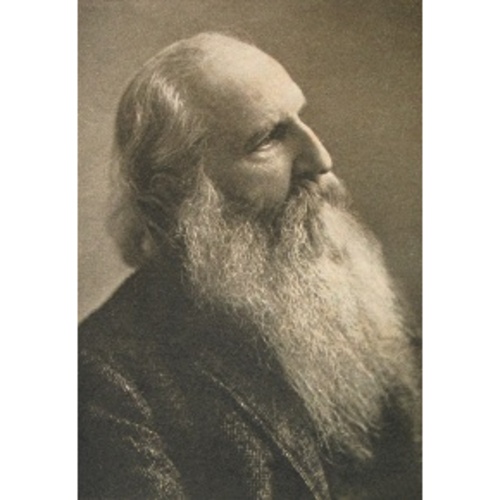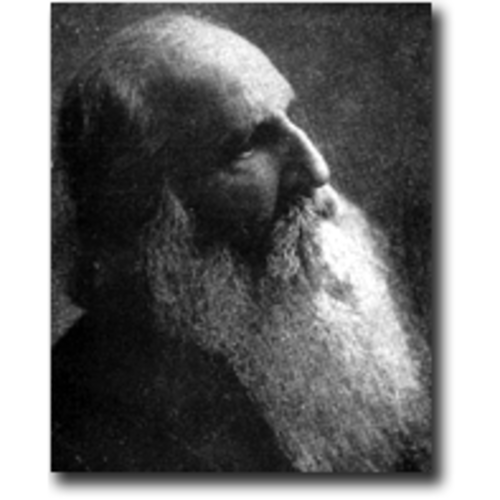Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
BUCKE, RICHARD MAURICE, médecin, surintendant d’asile et auteur, né le 18 mars 1837 à Methwold, Angleterre, septième des dix enfants du révérend Horatio Walpole Bucke et de Clarissa Andrews ; le 7 septembre 1865, il épousa à Mooretown, Haut-Canada, Jessie Maria Gurd, et ils eurent cinq fils et trois filles ; décédé le 19 février 1902 à London, Ontario.
Les Bucke immigrèrent au Canada en 1838 et s’établirent près de London, dans le Haut-Canada. Richard Maurice passa son enfance à la ferme familiale et, au lieu d’aller à l’école, puisa librement dans l’immense bibliothèque de son père. Il lut de tout, et notamment – ce qui allait avoir son importance – un ouvrage controversé sur l’évolution paru à Londres en 1844, Vestiges of the natural history of creation, de Robert Chambers. Ayant perdu sa mère en 1844 et sa belle-mère en 1853, il quitta la maison à l’âge de 16 ans pour s’engager comme journalier dans le Centre-Ouest américain. En 1856, après la mort de son père, il se joignit à un convoi de chariots en route pour le Far West. Arrivé sur les contreforts de la Sierra Nevada vers la fin de l’année, il s’associa à deux jeunes prospecteurs, Allen et Hosea Grosh. Ce dernier mourut d’un empoisonnement du sang moins d’un an plus tard, et le premier ne résista pas aux rigueurs du voyage qu’il fit avec Bucke, en novembre et en décembre 1857, pour franchir les montagnes. Bucke subit lui-même de telles engelures au cours de cette terrible marche qu’il dut se faire amputer tout un pied et une partie de l’autre.
De retour au Canada en 1858, Bucke, à l’exemple de deux de ses frères aînés, entra à la faculté de médecine du McGill College, qui était sans doute l’école de médecine la plus avancée d’Amérique du Nord à l’époque. Le cours, d’une durée de quatre ans, comprenait des leçons en anatomie, chimie, pharmacologie, médecine, chirurgie, obstétrique et jurisprudence médicale. Durant leur dernière année, les étudiants faisaient un stage clinique au Montreal General Hospital. Bucke, qui était un excellent sujet, obtint son diplôme en 1862 avec plusieurs prix, dont un pour sa thèse intitulée « Correlation of the vital and physical forces ».
Au sortir de McGill, Bucke alla étudier au University College Hospital et au King’s College Hospital de Londres. C’est là qu’il subit l’influence de Benjamin Ward Richardson, médecin attaché à plusieurs hôpitaux londoniens, auteur connu et partisan convaincu des mesures d’hygiène publique. En 1863, il passa quatre mois à Paris, où il apprit à parler français couramment et adopta le scepticisme que manifestait l’école clinique de Paris à l’égard des thérapies en vogue. Toutefois, l’événement marquant de ce séjour fut sa conversion au positivisme. Déjà en Angleterre il avait lu Auguste Comte en traduction, mais à Paris, il s’attaqua résolument à la version originale de ses volumineux ouvrages. À l’instar de Comte, il avait la conviction que l’étude scientifique de la société humaine permettrait aux philosophes de découvrir des principes sociologiques aussi universels que les lois de la biologie. Ce serait la science médicale, apprit-il, qui répondrait aux questions sur la nature de l’esprit, et non les métaphysiciens avec leurs spéculations oiseuses. Par la suite, dans ses propres ouvrages, il allait reprendre l’idée comtienne selon laquelle le meilleur moyen de remplacer la religion conventionnelle était d’assigner un rôle divin à l’humanité. Enfin, dans les pages du penseur français, peut-être plus que dans l’œuvre de Charles Darwin ou de Herbert Spencer, il trouva une théorie de l’évolution humaine dont il sut tirer parti. Sa dette envers Comte était telle qu’en 1863, il déclara sans hésiter n’avoir jamais connu de « plus grand esprit ».
Dans les derniers mois de cette année-là, Bucke rentra au Canada et reprit, à Sarnia, la clientèle de son frère Edward Horatio, qui venait de mourir. Ses plans furent cependant retardés lorsqu’il dut se rendre en Californie pour témoigner au procès que la famille Grosh avait intenté dans l’espoir de faire reconnaître ses droits sur un fameux gisement d’argent à Comstock. Il ouvrit finalement son cabinet en 1865. Durant la dizaine d’années qui suivit, il travailla ferme comme omnipraticien, fit plusieurs voyages en Angleterre et, au cours d’une brève maladie, tâta de la spéculation foncière. Puis, en 1876, grâce à son bon ami le ministre provincial Timothy Blair Pardee*, il accéda à la direction de l’Asylum for the Insane de Hamilton. L’année suivante, il passa à celui de London, qu’il allait diriger durant un quart de siècle. On l’avait préféré au docteur Stephen Lett pour remplacer le défunt docteur Henry Landor.
Pendant les années où il pratiquait la médecine générale à Sarnia, Bucke s’était plaint de son isolement intellectuel. « Je vis ici dans les épaisses ténèbres du pays d’Égypte en ce qui concerne la lumière du monde littéraire », écrivait-il à son ami Henry Buxton Forman. Pourtant, son enthousiasme pour Walt Whitman et son œuvre était né justement à cette époque. Initié à la poésie de Whitman en 1867 par le géologue Thomas Sterry Hunt*, il en était venu, au fil des deux années suivantes, à apprécier ses « extraordinaires qualités morales » et à le juger égal à Milton pour ce qui était de la « majesté de l’expression ». En 1877, il rendit visite à Whitman dans le New Jersey et proclama que c’était « un homme moyen magnifié [au point d’avoir] la stature d’un Dieu » ; « [le voir], nota-t-il, changea l’attitude de ma nature morale envers toutes choses ». Il avait déjà écrit à Whitman que c’était au cours d’une illumination inspirée par ses vers, en 1872, que sa propre philosophie avait trouvé une cohérence pour la première fois. Whitman était assez fin pour comprendre que Bucke voyait simplement dans ses poèmes le reflet de « ses propres rêveries ». Bucke avait d’ailleurs le sentiment d’y déceler des significations qui « ne pourraient jamais être pleinement saisies du point de vue de l’auteur ». En fait, contrairement à ce qu’ont suggéré nombre d’érudits, il emprunta peu à la philosophie de Whitman ; il tenta plutôt, et souvent, de convertir le poète à sa propre manière de voir les choses.
Durant leurs 15 années d’amitié, Bucke n’eut que louanges pour Whitman. Il supportait les railleries du public et le déplaisir marqué que sa femme manifestait à le voir si lié à ce poète non conformiste et controversé. Les deux hommes s’écrivaient plusieurs fois par semaine, Bucke alla dans le New Jersey en plusieurs occasions et Whitman passa près de quatre mois chez son ami en 1880, soit lorsque celui-ci commença sa biographie. Comme la santé du poète se détériora terriblement à compter de 1885 environ, ses relations avec Bucke devinrent de plus en plus celles d’un malade par rapport à son médecin. Il confia même à son ami Horace L. Traubel que l’on ne pouvait « vraiment connaître, comprendre » Bucke que dans un contexte médical. Le déclin de Whitman, marqué par de brèves missives sur son régime alimentaire et le fonctionnement de ses intestins, fut une expérience éprouvante pour Bucke, et sa mort, en 1892, dut le délivrer d’un grand poids. Il devint ensuite l’un des exécuteurs testamentaires du poète.
La littérature et la philosophie étaient certes, pour Bucke, des passions dévorantes, mais il assumait tout de même l’administration courante et la direction médicale de l’un des plus grands asiles d’aliénés d’Amérique du Nord. Fondé en 1870, l’asile de London abritait plus de 900 patients, outre le personnel, dans un complexe immobilier qui, déclara Bucke en 1883, atteignait « presque les dimensions d’une ville ». Les malades, environ la moitié d’hommes et la moitié de femmes, venaient généralement des couches inférieures de la classe laborieuse. Près de la moitié d’entre eux demeuraient à l’asile plus de dix ans. En fait, il y eut de nombreuses années où les départs excédèrent à peine les décès. Malgré de constants efforts d’économie, les coûts ne cessaient d’augmenter : en 1878, ils représentaient 3,1 % du budget provincial, et en 1893, 3,6 %. Étant donné l’accumulation des cas chroniques et la montée du coût de leur traitement, le trop lourd travail administratif occupait davantage Bucke que la pratique de la médecine. Cloîtré avec ses malades sur les terrains de l’asile et soumis au même horaire qu’eux, il en vint peu à peu à partager leur « vie horriblement monotone ».
Bucke reconnaissait la réalité de la chronicité et déclarait que « la folie est essentiellement une maladie incurable ». Son traitement reflétait cette conviction et différait peu de celui de la plupart des aliénistes victoriens. Conçu pour hâter et favoriser la guérison spontanée, ce traitement consistait en un régime alimentaire sain, des occupations utiles dans la journée, des divertissements constructifs et la pratique régulière de rites religieux. Pourtant, Bucke savait se démarquer de l’orthodoxie. D’abord, dès 1882, il ne prescrivait plus d’alcool à des fins médicales ; or le docteur Daniel Clark* de l’asile de Toronto, par exemple, préconisait cette pratique, approuvée à divers degrés par nombre de médecins de l’époque. Ensuite, dès 1883, apparemment sur les instances de son assistant, le docteur Nelson Henry Beemer, il élimina la plupart des formes de contention et autorisa la majorité des malades à circuler librement dans le parc de l’hôpital. À l’époque, la plupart des grands asiles ne donnaient pas encore une telle latitude aux patients, mais les docteurs William George Metcalf* et Charles Kirk Clarke*, du Rockwood Asylum de Kingston, suivirent bientôt son exemple. Enfin, Bucke était convaincu que la chirurgie pouvait améliorer l’état de certains malades mentaux. Sa première expérience consista en une intervention mineure qui visait à inhiber la masturbation, alors généralement considérée comme une cause commune de folie. Cependant, après avoir procédé à 21 opérations en 1877, il ne put produire aucun résultat positif et dut admettre que, chez la plupart des patients, le « vice solitaire » était probablement un symptôme plutôt qu’une cause de maladie. Dix-huit ans s’écoulèrent avant qu’il ne tente d’autres expériences chirurgicales.
En 1895, Bucke se lança dans une nouvelle série de tentatives, en recourant cette fois à la chirurgie gynécologique. Suivant la théorie de l’action réflexe, alors largement acceptée, une maladie dans une partie du corps pouvait engendrer des symptômes dans une autre partie, éloignée de la première. Pour les médecins victoriens, rien ne confirmait mieux cette théorie que la conviction très répandue selon laquelle les maladies pelviennes pouvaient, chez les femmes, produire des aberrations mentales. Bucke aurait pu accepter cette théorie, sans plus, mais l’engagement fortuit d’un assistant qui s’intéressait vivement à la chirurgie gynécologique, le docteur Alfred Thomas Hobbs, le décida à procéder à des interventions. Bon nombre des patientes de l’asile souffraient sans doute de problèmes gynécologiques gênants et débilitants. Certaines devaient porter les marques des grossières méthodes obstétricales de l’époque. D’autres encore souffraient peut-être des effets de maladies vénériennes, alors très répandues. Enfin, quelques patientes devaient présenter de légères anomalies anatomiques que l’on classerait par la suite comme bénignes mais qui étaient alors jugées pathologiques. Il n’est donc pas étonnant que, en examinant leur patiente type – une femme âgée d’environ 35 ans, mariée et multipare – Bucke et Hobbs aient constaté des maladies dans 85 % des cas.
Selon Bucke, les résultats obtenus sur les 19 premières patientes opérées dépassèrent les espérances : la maladie mentale, dit-il, régressa ou disparut dans près des deux tiers des cas. En cinq ans, 228 femmes subirent des interventions, les plus fréquentes étant la suspension de l’utérus (24 %), la dilatation et le curetage (21 %), l’amputation du col (16 %) et la remise en état du périnée (14 %). Malgré les affirmations de Bucke, la comparaison de ses patientes avec un groupe-contrôle de femmes du même âge ne permet pas de conclure que les interventions furent bienfaisantes sur le plan psychiatrique. Aussi peut-on dire que les conclusions de Bucke et de Hobbs reflétaient leur parti pris : ils tenaient beaucoup à avoir des résultats positifs. Outre qu’ils désiraient réellement guérir leurs patientes, ils étaient très conscients du retard de la psychiatrie par rapport aux autres domaines de la médecine. En recourant à la chirurgie antiseptique, alors nouvelle, et en suggérant que les « sécrétions internes » ou hormones, découvertes depuis peu, jouaient un rôle important, ils cherchaient à moderniser leur discipline et à lui donner du prestige. C’est ce souci professionnel qui explique le mieux leur enthousiasme pour la gynécologie, et non les théories victoriennes sur les pathologies féminines – que leurs nombreux détracteurs partageaient certainement.
Tout en dirigeant l’asile, Bucke eut enfin le temps de mettre sur papier ses spéculations philosophiques et littéraires. En 1879, il publia Man’s moral nature, où il avançait principalement deux thèses. D’abord, il avait la conviction que les êtres humains possédaient un sens moral inné dont le siège était la portion du système nerveux autonome que l’on appelle le système sympathique. C’était une idée anachronique, fondée sur la physiologie française des années 1820, et Bucke la défendait par inférence à partir de l’anatomie plutôt qu’en s’appuyant sur des recherches expérimentales. Pourtant, en tentant de situer des fonctions mentales spécifiques en des points précis du système nerveux et en utilisant la psychologie associationniste d’Alexander Bain ou de Herbert Spencer, il s’inscrivait tout à fait dans les grands courants de la médecine victorienne. Sa seconde thèse voulait que ce sens moral inné soit en progression. Pour l’appuyer, il recourait à la théorie évolutionniste et à l’hypothèse de la récapitulation popularisée par Ernst Haeckel, qui soutenait que l’espèce humaine évoluait en tant que collectivité à peu près à la manière de l’enfant qui passe à la maturité. Bucke était certain d’avoir écrit « un livre très remarquable et utile », mais ce ne fut pas un succès : il s’en vendit seulement 4 exemplaires en Angleterre la première année, et 241 en Amérique du Nord durant les quatre années qui suivirent sa publication. Néanmoins, Man’s moral nature fait date car il s’agit de la première monographie canadienne sur la neuropsychiatrie.
Au cours de la vingtaine d’années suivantes, Bucke publia sa biographie de Whitman ainsi que de nombreux articles sur la psychiatrie, et il participa à des publications commémoratives après la mort de Whitman. Tout au long de cette période, il rassembla des exemples et des théories en vue de ce qui allait être son œuvre la plus marquante, Cosmic consciousness, parue à Philadelphie en 1901. Pour lui, ce livre fut à la fois une occasion de rendre un nouvel hommage à Whitman et de donner une certaine cohérence à son illumination de 1872. Du point de vue historique, il compte non pas en tant que classique du mysticisme mais parce qu’il constitue un exemple précis des tentatives que lit la médecine psychologique, à la fin du xixe siècle, pour intégrer la nouvelle donnée qu’était l’inconscient. Bien que, par la suite, on ait trouvé ce livre passablement religieux de ton et d’intention, Bucke, quant à lui, le considérait comme une étude de physiologie mentale et de psychologie. Ce n’était pas un ouvrage sur le surnaturel, et son sujet pouvait, affirmait-il, « être étudié sans plus de difficulté que d’autres phénomènes naturels ».
Bucke reprenait, dans son introduction, bon nombre d’idées qu’il avait déjà exprimées dans des écrits antérieurs. Encore une fois, il préconisait une vision évolutionniste de l’esprit humain. Empruntant au zoologue et psychologue britannique George John Romanes, il soutenait que l’esprit s’était développé graduellement, en trois étapes. Au début, il ne faisait qu’enregistrer les sensations, après quoi il était passé à une « conscience simple », de type animal, puis il était parvenu à l’actuelle « conscience de soi ». L’apport de Bucke à cette théorie consistait en l’addition d’une quatrième étape à l’évolution de l’esprit. C’était la « conscience cosmique, conscience de [...] la vie et de l’ordre de l’univers », qui s’accompagnait d’une « lumière intellectuelle » et d’un « état d’exaltation morale ». Le livre renfermait essentiellement des études de cas portant sur une cinquantaine d’hommes qui étaient censés avoir possédé cette faculté, dont Jésus, Mahomet, Bouddha, Dante, Francis Bacon, Bucke lui-même et, bien sûr, Whitman. Bucke était convaincu que la conscience cosmique, rare dans les siècles précédents, progressait, et qu’un jour tous les êtres humains en seraient dotés. Alors ils n’auraient plus besoin du décorum ni des doctrines de la religion conventionnelle. Pour Bucke comme pour Auguste Comte, Dieu n’était rien de plus ni de moins que l’humanité prise collectivement.
À l’instar de la plupart des écrits de Bucke, Cosmic consciousness s’appuyait sur des convictions répandues à l’époque victorienne, mais en revanche, ses conclusions n’appartenaient qu’à lui. On aurait tort de juger l’ouvrage en fonction de son apparente excentricité mystique et d’oublier dans quel contexte Bucke l’écrivit. Il faut tenir compte en particulier de deux courants intellectuels de la fin du xixe siècle. D’abord, Bucke connaissait très bien les travaux de la Society for Psychical Research, qui comptait parmi ses membres Alfred Russel Wallace, William James, Sigmund Freud, Carl Jung et Pierre Janet. L’empirisme de ce groupe, manifeste dans ses études poussées sur la télépathie et la clairvoyance, dépouilla le spiritualisme de ses connotations surnaturelles. Ensuite, à compter du moment où le plus grand neurologue européen, Jean-Martin Charcot, fit de l’hypnose un sujet d’intérêt légitime pour la médecine, en 1882, il se publia de plus en plus de travaux dans lesquels des médecins étudiaient les désordres et les attributs d’un inconscient désormais défini comme dynamique. Si, pour les générations suivantes, l’œuvre de Bucke, et surtout Cosmic consciousness, est largement religieuse, ses contemporains durent la trouver assez peu différente des premiers écrits de Jung, de Janet ou de Freud.
Dans les trois quarts de siècle suivants, Cosmic consciousness allait être réimprimé plus de 20 fois, mais Bucke ne vit malheureusement pas à quel point son dernier livre allait être populaire. En février 1902, en s’arrêtant pour admirer les étoiles, il perdit l’équilibre et se fit à la tête une blessure qui lui fut fatale. N’eût été de cet accident, peut-être serait-il devenu, à la place d’Ernest Jones, le grand propagateur de l’œuvre de Freud au Canada, et il aurait certainement prêté sa voix au mouvement en faveur de l’hygiène mentale. D’abord aventurier dans le Far West, il s’était livré à l’étude dans les universités et les salons de Londres et de Paris, puis avait été de l’avant-garde des lettres américaines. Personnage souvent énigmatique et original, il récolta néanmoins beaucoup d’honneurs et exerça de nombreuses fonctions. Élu membre fondateur de la Société royale du Canada en 1882, il fut le premier à accéder, la même année, à la chaire de pathologie nerveuse et mentale de la Western University of London, Ontario, devint président de la section de psychologie de la British Medical Association en 1897 et fut élu l’année suivante président de l’American Medico-Psychological Association.
Le fait que Richard Maurice Bucke ait joui d’un tel crédit auprès de ses contemporains permet de croire que, même s’il n’était sûrement pas homme à se plier aux conventions, les problèmes intellectuels qu’il tenait pour importants et les outils philosophiques au moyen desquels il tentait de façonner une vision du monde cohérente s’inscrivaient bien dans la mentalité victorienne. Il ne voyait pas de discontinuité entre ses activités littéraires, ses spéculations métaphysiques et sa théorie clinique. Naturalisme évolutionniste, poésie whitmanienne, positivisme, psychologie associationniste et théories sur la localisation neurologique s’unissaient dans sa philosophie. Bien que son prosélytisme en faveur de Whitman et ses spéculations apparemment nébuleuses sur la conscience cosmique aient dominé ses dernières années, il convient de se souvenir de lui comme d’un psychiatre victorien soucieux de ses malades et comme du premier théoricien canadien en neuropsychiatrie.
Outre Man’s moral nature : an essay (New York et Toronto, 1879) et Cosmic consciousness : a study in the evolution of the human mind (Philadelphie, 1901), les publications importantes de Richard Maurice Bucke sont Walt Whitman (Philadelphie, 1883) et le rapport des ses expériences en gynécologie, « Two hundred operative cases–insane women », American Medico-Psychological Assoc., Proc. (s.l.), 1900 : 99–105. Le mémoire qu’il a présenté pour l’obtention de son diplôme en médecine, « The correlation of the vital and physical forces [...] », a paru dans le British American Journal (Montréal), 3 (1862) : 161–167, 193–200, 225–233. On trouve des bibliographies de ses écrits dans Richard Maurice Bucke : a catalogue based upon the collections of the University of Western Ontario Libraries, M. A. Jameson, compil. (Londres, 1978), et en annexe à J. H. Coyne, « Richard Maurice Bucke – a sketch », SRC Trans., 2e sér., 12 (1906), sect. ii : 159–196.
La correspondance de Bucke avec Whitman et son groupe a été publiée sous le titre de Richard Maurice Bucke, medical mystic : letters of Dr. Bucke to Walt Whitman and his friends, Artem Lozynsky, édit. (Detroit, 1977).
AO, RG 10, 20-C-1 ; RG 63, A-1.— Univ. of Western Ontario Library, Regional Coll. (London), R. M. Bucke papers.— Sarnia Observer and Lambton Advertiser (Sarnia, [Ontario]), 14 sept. 1865.— M. L. Barr, A century of medicine at Western : a centennial history of the faculty of medicine, University of Western Ontario (Londres, 1977).— Cook, Regenerators.— J. R. Horne, « Cosmic consciousness–then and now » : the evolutionary mysticism of Maurice Bucke » (thèse de ph.d., Columbia Univ., New York, 1964) ; « R. M. Bucke : pioneer psychiatrist, practical mystic », OH, 59 (1967) : 197–208.— C. L. Krasnick, « In charge of the loons : a portrait of the London, Ontario, Asylum for the Insane in the nineteenth century », OH, 74 (1982) : 138–184.— Wendy Mitchinson, « Gynecological operations on insane women : London, Ontario, 1895–1901 », Journal of Social Hist. (Pittsburgh, Pa), 15 (1982) : 467–484 ; « R. M. Bucke : a Victorian asylum superintendent », OH, 73 (1981) : 239–254.— Ontario, Legislature, Sessional papers, Annual reports of the medical superintendent of the London asylum in the reports of the inspector of prisons and public charities, 1877–1881, et Annuals reports upon the lunatic and idiot asylum, 1882–1903.— Edwin Seaborn, The march of medicine in western Ontario (Toronto, 1944).— S. E. D. Shortt, « The myth of a Canadian Boswell : Dr. R. M. Bucke and Walt Whitman », Canadian Bull. of Medical Hist. ([Québec]), 1 (1984), no 2 : 55–70 ; Victorian lunacy : Richard M. Bucke and the practice of late nineteenth-century psychiatry (Cambridge, Angleterre, 1986).— H. B. Timothy, « Rediscovering R. M. Bucke », Western Ontario Hist. Notes (London), 21 (1965), no 1 : 34–40.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Samuel E. D. Shortt, « BUCKE, RICHARD MAURICE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 15 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/bucke_richard_maurice_13F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/bucke_richard_maurice_13F.html |
| Auteur de l'article: | Samuel E. D. Shortt |
| Titre de l'article: | BUCKE, RICHARD MAURICE |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1994 |
| Année de la révision: | 1994 |
| Date de consultation: | 15 déc. 2025 |