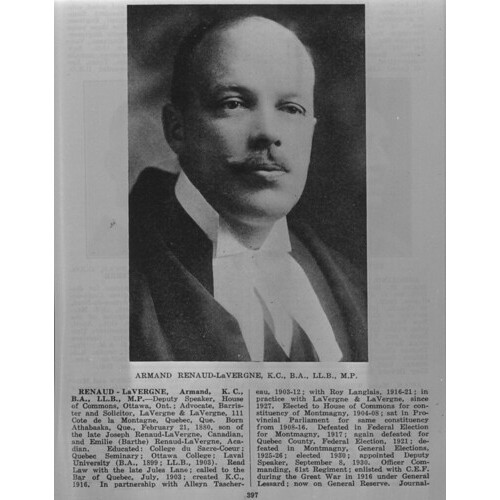![Armand La Vergne, [Vers 1903], BAnQ Vieux-Montréal, Fonds Famille Landry, (06M,P155,S1,SS1,D265), Montminy. Titre original : Armand La Vergne, [Vers 1903], BAnQ Vieux-Montréal, Fonds Famille Landry, (06M,P155,S1,SS1,D265), Montminy.](/bioimages/w600.15590.jpg)
Provenance : Lien
LA VERGNE, ARMAND, avocat, journaliste, homme politique, directeur de journaux, auteur, conférencier et officier de milice, né le 21 février 1880 à Arthabaskaville (Victoriaville, Québec), fils de Joseph Lavergne, avocat, et d’Émilie Barthe* ; le 1er décembre 1904, il épousa dans la paroisse Notre-Dame, à Montréal, Georgette Roy, et ils n’eurent pas d’enfants ; décédé le 5 mars 1935 à Ottawa et inhumé trois jours plus tard dans le cimetière de la paroisse Saint-Christophe-d’Arthabaska, à Arthabaska (Victoriaville).
Origines
L’ancêtre d’Armand La Vergne, François Lavergne, maçon, originaire de la paroisse Saint-Michel-des-Lions, de Limoges, en France, arrive en Nouvelle-France vers 1669–1670. Il se marie à Québec, le 19 octobre 1671, avec Françoise Lefrançois, fille du roi, de la paroisse d’Ouville, de Lisieux, en France. À la fin du xviie siècle ou au début du xviiie siècle, l’un de leurs fils, prénommé Arnoul mais qui s’appelle lui-même Renaud, s’établit dans la mission Saint-Thomas-de-la-Pointe-à-Lacaille (Montmagny), dans la partie de ce territoire qui deviendra Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Le 25 novembre 1693, il épouse Marguerite Daniau. Parmi leur descendance figure le père d’Armand, Joseph, né le 29 octobre 1847. En 1874, il vient habiter Arthabaskaville pour s’associer à l’étude légale de Wilfrid Laurier* [V. Sir Wilfrid Laurier].
Les Lavergne à Arthabaskaville
À la naissance d’Armand, Arthabaskaville, chef-lieu du district judiciaire d’Arthabaska, compte quelque 992 habitants, dont 97,2 % sont francophones et 99,4 % sont catholiques. Joseph s’y est marié en 1876 avec Émilie Barthe. Le couple promène déjà une enfant, Gabrielle, née en 1877. D’envergure moyenne, Joseph prend du galon jusqu’à être élu député libéral de la circonscription fédérale de Drummond et Arthabaska en 1887. Émilie s’intègre rapidement à l’élite locale tandis que sa maison devient le centre mondain du village. Des invités tombent sous son charme. L’un, surtout : Wilfrid Laurier. Émilie et lui vivent la liaison la plus célèbre de l’histoire politique canadienne. Au point qu’une rumeur, jamais avérée, circule : Armand serait le fils de Laurier. Plus tard, Armand en subira les quolibets disgracieux.
Enfance dorée
À Arthabaskaville, Armand égrène les plus beaux moments de son enfance. Il l’atteste dans ses mémoires, intitulés Trente ans de vie nationale. Cet enfant espiègle, d’une intelligence supérieure, d’une gaieté communicative, aux réparties déjà foudroyantes, emporte l’admiration de Laurier. Assoiffé de lecture, il montre une curiosité intellectuelle rare pour son âge. Épris de liberté, peu discipliné, il adore baguenauder dans la forêt pour chasser les petits animaux ou chercher les traces du passage des Premières Nations. La forêt, puis la chasse, demeureront pour lui un lieu et une activité préférés, ce qui lui coûtera plus tard les pires ennuis de santé.
Études
Armand n’est pas, et ne sera jamais, un homme d’étude et d’approfondissement. Indolent, il préfère apprendre en dilettante. Et s’inspirer de mentors. Dans sa vie politique, tel sera aussi le cas. Le collège commercial du Sacré-Cœur d’Arthabaskaville l’accueille en 1885. La Vergne remporte quand même des prix et des accessits. Il se transporte le 5 septembre 1890 au petit séminaire de Québec pour entreprendre ses études classiques. Il y demeure jusqu’à la rhétorique. Il ne récolte aucun prix et se satisfait de mentions honorables ou d’accessits. En 1897–1898, le voilà au collège d’Ottawa, un établissement universitaire. Armand n’y reste qu’un an, devient vice-président de la société dramatique et reçoit une médaille d’argent pour l’excellence en doctrine chrétienne. À l’été de 1898, sa famille l’amène en Europe. À Paris, Armand admire le comédien Constant Coquelin, dit Coquelin aîné, dans la pièce Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. Il y découvre les fondements de ce qui se révélera l’obsession de sa carrière : la défense imperturbable de la langue française. Enfin, le 22 août 1899, il est admis officiellement à l’étude de la profession d’avocat dans la province de Québec, ce qu’il effectue à la faculté de droit de l’université Laval à Québec, où il accède à la présidence des étudiants en septembre 1901. En juillet 1903, non sans peine, il accède au Barreau de la province de Québec.
Avocat et causes
Âgé de 23 ans, l’avocat La Vergne arbore une belle prestance qui peut séduire la clientèle. En novembre 1903, il ouvre, seul, un bureau à Québec, qui rapporte peu. Il le déplace dès janvier 1904 à Montmagny, le pays de ses ancêtres, où, en 1905, il devient, en outre, directeur du Courrier de Montmagny [V. Philippe-Auguste Choquette*], fonction qu’il assume jusqu’au 2 février 1906. Il pratique soit seul, soit associé à d’autres avocats, surtout à Québec, tout en maintenant, certainement jusqu’en juin 1907, un bureau à Montmagny et en Beauce. Durant un peu plus de 31 ans, sans s’enrichir, il accepte des causes dans divers domaines du droit et s’active dans des procès célèbres. Mentionnons ceux de conscrits lors de la Première Guerre mondiale et des victimes des émeutes de Québec [V. Georges Demeule*] en 1918, celui de Télesphore Gagnon accusé dans la mort d’Aurore Gagnon*, dite Aurore l’enfant martyre, en 1920, et ceux, en 1921 et 1922, touchant la ténébreuse affaire Blanche Garneau. Enfin, La Vergne est promu conseiller du roi le 14 juin 1918 et bâtonnier du barreau de Québec le 1er mai 1930.
Carrière politique : antécédents
La Vergne développe tôt une passion dévorante pour la vie politique de son pays. Jusqu’en 1899, le Parti libéral et Wilfrid Laurier le séduisent. Cependant, en 1899–1900, La Vergne s’éprend du député libéral Henri Bourassa*, pourfendeur du gouvernement Laurier qui permet la participation du Canada à la guerre des Boers [V. Les relations avec l’Empire britannique]. Malgré cette attitude contestataire, La Vergne demeure franchement libéral jusqu’au début de 1902. Ensuite, son rougisme inquiète le parti. D’abord, en mars 1902, La Vergne s’associe à des jeunes revendicateurs pour défendre les droits et prérogatives de la langue française au Québec. Puis, il discourt en compagnie de Bourassa. Enfin, en mars 1903, il fonde, avec d’autres jeunes inspirés par Bourassa mais regroupés autour d’Olivar Asselin, la Ligue nationaliste canadienne qui promeut le développement politique, économique et culturel du Canada. Centrée sur l’autonomie du pays et des provinces, la ligue se veut un mouvement par-delà les partis politiques. Elle se dote, l’année suivante, d’un hebdomadaire, le Nationaliste, auquel La Vergne collaborera. Les articles, percutants, bousculeront les acteurs politiques.
Carrière politique : originalité
L’année 1904 s’avère déterminante pour La Vergne : il est élu député libéral dans deux élections fédérales, l’une partielle le 16 février, et ce, dès l’âge de 23 ans, l’autre générale le 3 novembre, dans la circonscription de Montmagny. La Vergne refuse cependant d’approuver toutes les politiques de Laurier. Déçus, les libéraux espèrent le voir intégrer le rang. Ce ne sera jamais le cas. La carrière singulière de La Vergne empruntera des voies détournées pour s’accomplir. Ses liens privilégiés avec Laurier lui promettaient les promotions. Or, La Vergne s’inscrit tôt en marge de cette destinée. Il opte pour la route la plus difficile à l’époque étant donné la rigidité du système de partis bipartite qui prévaut au pays jusqu’au début des années 1920 : il agira le plus souvent à l’extérieur des cadres des partis ou les contestera de l’intérieur. Cette décision l’écartera quasi complètement des réalisations concrètes, unité de mesure des carrières apparemment réussies. En somme, La Vergne, nationaliste, perçoit qu’une mission le requiert et qu’elle doit s’exercer, à peu d’exceptions près, par-delà les exigences partisanes. Cette mission naît dans le creuset du nationalisme canadien, épouse l’idéologie sociale conservatrice et embrasse principalement quatre causes : la promotion de la langue française, la défense des minorités, française ou anglaise, l’obligation du bilinguisme et l’opposition à l’impérialisme britannique.
Député fédéral rebelle, 1904–1908
L’année 1904 s’avère aussi celle des apprentissages à la Chambre des communes. Suivent trois années pendant lesquelles, inspiré par Bourassa, La Vergne concrétise son choix. Quand, entre février et juillet 1905, Laurier crée l’Alberta et la Saskatchewan [V. Le peuplement de l’Ouest] sans octroyer à la minorité catholique et française ses pleins droits aux écoles confessionnelles et à la langue française, La Vergne s’insurge. Par la suite, en 1906–1907, La Vergne, xénophobe, s’oppose aux politiques gouvernementales d’immigration intensive et de l’observance du repos dominical [V. John George Shearer* ; Réformes morales et religieuses]. Puis, lors d’une élection partielle dans la circonscription de Québec en 1906, il contribue à défaire le candidat libéral Georges-Élie Amyot*. En même temps, sous le pseudonyme de Montjorge, il écrit dans le Nationaliste des chroniques parlementaires virulentes contre le gouvernement. Le 25 janvier 1907, Laurier, exaspéré, l’expulse du parti. La Vergne devient alors député indépendant tout en proclamant son adhésion aux principes fondamentaux du libéralisme.
Peu après, La Vergne se consacre à la promotion du bilinguisme. Le 25 février, il présente en Chambre, sans suite, un « projet de résolution » visant, à l’échelle du Canada, la « parfaite égalité » des langues française et anglaise « dans toutes les matières d’intérêt public ». Il récidive le 28 janvier 1908 en soumettant, en vain, « un projet de loi » énonçant grosso modo les mêmes objectifs, mais ne s’appliquant qu’au Québec, et, le 21 mai, une pétition comprenant 433 845 signatures.
La Vergne prend alors acte de ses insuccès à Ottawa. En lien avec Bourassa, il opte pour la scène provinciale. Dès l’été de 1907, Bourassa et lui ont amorcé une campagne d’assemblées contre les politiques économiques du gouvernement libéral de Lomer Gouin* [V. Henri Bourassa]. Progressivement, ils quittent Ottawa, Bourassa dès le 26 octobre 1907, La Vergne le 27 mai 1908. Ils se présentent aux élections générales provinciales du 8 juin 1908. Résultats : Gouin conserve le pouvoir, mais les deux nationalistes triomphent, La Vergne dans la circonscription de Montmagny et Bourassa dans celles de Saint-Hyacinthe et de Montréal, division no 2.
Premier mandat provincial, 1908–1912
Loi La Vergne
La Vergne amorce dès lors deux mandats successifs qui totaliseront huit années à titre de député provincial. À l’Assemblée législative, il se préoccupe des questions provinciales, les yeux rivés sur Ottawa. Entre 1909 et 1912, La Vergne et Bourassa, alliés aux 14 députés conservateurs de Joseph-Mathias Tellier*, attaquent férocement le gouvernement de Gouin. Leurs efforts rapporteront : l’État, notamment, contrôlera mieux la spéculation, louera les chutes d’eau par bail emphytéotique, imposera un embargo sur l’exportation du bois à pâte provenant des terres de la couronne. La Vergne, aux mots d’esprit irrésistibles, y contribue par ses discours entraînants. Mais il y a plus. Le 4 mars 1909, il reprend son combat sur le bilinguisme. Il dépose le projet de loi 160 amendant le Code civil concernant les contrats faits avec les compagnies de services d’utilité publique. D’abord voté à l’Assemblée, le 3 mai, son projet est transformé au Conseil législatif : La Vergne le rejette le 29 mai. Il le relance le 17 mars 1910. Voté à l’Assemblée le 8 avril suivant, le projet de loi 151, peu modifié au Conseil [V. Némèse Garneau], devient loi le 4 juin 1910 ; on l’appellera la loi La Vergne. C’est la première loi en matière linguistique dans la province de Québec. Elle oblige, sous peine d’une amende, les compagnies de services d’utilité publique établies au Québec, spécifiquement les compagnies de chemin de fer, de navigation, de télégraphe, de téléphone, de transport et de messageries ou d’énergie électrique, à utiliser le français et l’anglais dans leurs diverses communications écrites avec leurs clients.
Marine de Laurier
L’année 1910 est balisée aussi par la politique fédérale. Dès le 12 janvier, Laurier crée une marine de guerre [V. Les relations avec l’Empire britannique], ce qui agresse La Vergne. Devant la recrudescence de l’impérialisme, Bourassa et La Vergne se joignent aux députés conservateurs fédéraux de la province de Québec dirigés par Frederick Debartzch Monk* et opposés sur cette question tant à leur chef national Robert Laird Borden qu’à Laurier. Ensemble, ils forment en mai l’alliance conservatrice-nationaliste. Il s’agit d’une coalition qui regroupe désormais ces députés conservateurs fédéraux de la province de Québec indépendants du Parti conservateur fédéral de Borden et les nationalistes près de Bourassa et de La Vergne, tous mobilisés autour des principes véhiculés par la Ligue nationaliste canadienne. Cette alliance, appelée aussi Parti autonomiste, réclame un plébiscite [V. Henri Bourassa], tient plusieurs assemblées pendant l’été au Québec et défait un libéral dans une élection partielle fédérale le 3 novembre, dans la circonscription de Drummond et Arthabaska. La Vergne s’implique à fond. Son éloquence pleine d’esprit, emphatique, théâtrale, joue sur l’émotion comme sur le romantisme. La Vergne filtre les faits au gré de son objectif : battre Laurier et sa politique qui entraîneraient la participation du Canada aux guerres de l’Empire britannique et la conscription. Lors de l’élection générale fédérale du 21 septembre 1911 [V. La campagne électorale de 1911], l’alliance raffermit ses principes nationalistes. La Vergne, toujours député provincial, dirige l’organisation dans la région de Québec, y sélectionne les candidats et déclame plusieurs allocutions. Résultats : les libéraux perdent et 17 députés conservateurs-nationalistes sont élus, sans, cependant, détenir la balance du pouvoir recherchée. La Vergne, néanmoins, jubile. À 31 ans, il est à l’apogée de son influence. Il refuse un portefeuille dans le cabinet Borden et désigne le prétendant de son choix, Louis-Philippe Pelletier*. Et prévient, comme il le rappellera dans ses mémoires : « [N]ous arriv[ons] trop vite. » L’avenir immédiat le confirme. Dès février–mars 1912, lors de l’annexion d’une partie du district de Keewatin (Nunavut) au Manitoba [V. George Robson Coldwell*], Borden sacrifie les écoles séparées de la minorité catholique. Sept conservateurs-nationalistes seulement respectent leurs principes nationalistes. C’est le début des déceptions de La Vergne.
Second mandat provincial, 1912–1916
Marine, langue et guerre
Une lueur d’espoir anime néanmoins La Vergne le 15 mai 1912 puisqu’il est réélu député provincial de Montmagny. Sans Bourassa, occupé au Devoir auquel La Vergne collabore, une lourde tâche l’attend à l’Assemblée. Dès 1912, cependant, l’alerte vient d’Ottawa et de Toronto. Le 5 décembre, le premier ministre Borden dévoile son projet de marine : une contribution de 35 millions à la mère patrie pour construire trois navires de guerre [V. sir Robert Laird Borden]. La Vergne fulmine car, en plus, dix conservateurs-nationalistes trahissent leurs principes nationalistes. Il intervient aussi sur la question linguistique. Le 13 avril 1912, le gouvernement ontarien a émis le Règlement 17 qui limite l’instruction en français aux deux premières années scolaires [V. sir James Pliny Whitney*]. Jusqu’à la fin de son mandat, La Vergne militera en faveur des Franco-Ontariens. Enfin, le 4 août 1914, le Canada, colonie de l’Empire britannique, est automatiquement entraîné dans la Grande Guerre. Cette journée-là, et dans les deux années suivantes, La Vergne, officier de la milice, lieutenant-colonel commandant du 61e régiment de Montmagny, réagit. Anti-impérialiste, il refuse la participation du Canada puisqu’elle se déroulerait à l’extérieur du pays. Selon lui, la Grande-Bretagne doit défendre ses colonies, non le contraire. En 1915, La Vergne décline l’offre du ministre de la Milice et de la Défense, sir Samuel Hughes*, de former un bataillon pour le service outre-mer. Il se résume ainsi le 12 janvier 1916, comme le rapporte le Devoir le jour suivant : « Pas un homme, pas un sou, pas un canon. » S’il avoue désirer s’enrôler, il lie l’engagement des Canadiens français au règlement de la question scolaire ontarienne. Opposé à la conscription, il s’y soumettrait si elle devenait loi. À tous ces égards, ses propos incisifs lui causent des ennuis, surtout à l’Assemblée législative.
Solitaire à l’Assemblée
Seul nationaliste à l’Assemblée, La Vergne tient sa place jusqu’en 1916. Il propose quelques projets de loi, émet des propos xénophobes sur l’immigration, plaide pour le droit de vote des Hurons (Hurons-Wendats) [V. Ludger Bastien*], réitère son soutien aux Franco-Ontariens et, bien qu’opposé au concours des femmes à la vie publique, il appuie en vain leur admission au barreau [V. Samuel William Jacobs ; Annie Macdonald*]. L’hebdomadaire le Franc Parler, qu’il fonde à l’automne de 1913 et dirige, prolonge ses interventions. Lorsque la Grande Guerre exige davantage d’hommes pour combattre les Allemands notamment, La Vergne échappe des paroles des plus acérées et provocantes le 13 janvier 1916 à l’Assemblée. Il établit froidement un rapprochement entre le traitement qu’il juge indigne éprouvé encore alors par les Franco-Ontariens à la suite de l’imposition du Règlement 17 par le gouvernement ontarien et celui que les Allemands font subir aux soldats alliés et aux populations soumises à leur joug. Il lance : « Je n’ai pas peur d’être Allemand, et je rappellerai à ce sujet un vieil axiome qui dit : ‟Mordu par un chien ou mordu par une chienne, mordu quand même.” Je me demande si le régime allemand ne peut pas se comparer au régime ultra-boche de l’Ontario. » Ses collègues – comme Joseph-Mathias Tellier, l’ancien chef du Parti conservateur et toujours député conservateur de Joliette, et Louis-Alexandre Taschereau*, ministre des Travaux publics et du Travail – le désavouent, des Canadiens veulent l’exiler en Allemagne, l’accuser de haute trahison et le fusiller à l’aube. Exclu du Club de la garnison de Québec, La Vergne se défend vigoureusement.
Retrait
Le 7 mai 1916, La Vergne annonce qu’il se retire de la politique provinciale, se réservant pour le prochain combat fédéral. La tête haute, il synthétise ainsi sa contribution à la vie publique, comme le rapporte le Devoir le jour suivant : « [J’ai] préféré l’honneur aux honneurs. » Se clôture alors son séjour à l’Assemblée législative. Succès et échecs se côtoient. D’une part, s’imposent la loi La Vergne et plusieurs projets nationalistes adoptés par le gouvernement. D’autre part, se confirme, au provincial, la fin de l’influence concrète du mouvement nationaliste. Au total, bien que critiqué, La Vergne jouit encore, à 36 ans, d’une notoriété publique enviable.
Période difficile, 1917–1930
Défaites électorales
La Vergne devra patienter avant de siéger à Ottawa puisqu’il subira quatre échecs électoraux consécutifs lors de scrutins fédéraux. Le premier survient au moment de l’élection générale du 17 décembre 1917, centrée sur la conscription imposée par Borden, qui provoque la furie au Québec [V. La Première Guerre mondiale]. Réfractaire à cette loi, La Vergne, candidat indépendant dans Montmagny, a réclamé depuis le printemps un référendum, conseillé la désobéissance, évoqué la perspective de mourir pour la combattre et abordé la séparation de la province de Québec. Il perd son pari. Ses électeurs, comme ceux au Québec, préfèrent les libéraux, vaincus largement au pays par le Parti unioniste de Borden, ce qui isole la province. Par la suite, La Vergne échoue aux élections générales fédérales de 1921, 1925 et 1926. Il connaît, en outre, la défaite à l’élection générale provinciale de 1923.
Déclin relatif
Déclin de La Vergne ? Certes, mais il est relatif car l’homme demeure présent dans l’actualité. C’est d’abord indéniable entre 1918 et 1924, même si, en 1920, un accident de chasse lui fracture une vertèbre lombaire et le ralentit. Citons pour exemple, au delà des causes célèbres déjà mentionnées, le cas des émeutes contre la conscription à Québec en 1918 [V. François-Louis Lessard*], quand il réussit, le 31 mars, à disperser la foule. Et cet autre lorsqu’il signe, le 13 septembre 1920, l’éditorial du Devoir sur l’isolement de la province de Québec. Enfin, ce dernier exemple, tandis qu’il prononce des conférences sur la langue française (1919), sur sir Louis-Hippolyte La Fontaine* (1921), sur l’indépendance de l’Irlande et son appui indéfectible à la Self-Determination for Ireland League of Canada and Newfoundland (1920, 1921) [V. Katherine Angelina Hughes*] et sur la légende du lauriérisme (1924).
Chez les conservateurs
Puis, entre 1924 et 1930, La Vergne frappe un grand coup. Dans un retournement inattendu, provoqué probablement par l’appel de la politique au quotidien, il semble reconsidérer son cheminement élaboré depuis 1903. À l’étonnement de ses amis, à partir du printemps de 1924, il s’allie au Parti libéral-conservateur fédéral d’Arthur Meighen*, si honni au Québec depuis la conscription, afin de le convertir à son nationalisme. La Vergne estime réussir car, selon lui, les politiques de Meighen rejoignent son nationalisme. Malgré les divisions dans ce parti et les suspicions à son égard, il milite activement. C’est le cas jusqu’au 11 octobre 1926 alors que, miné par les défaites, Meighen démissionne. Le 12 octobre 1927, à la convention conservatrice de Winnipeg, La Vergne étale devant Richard Bedford Bennett*, le chef élu, sa ferveur nationaliste et sa volonté de la propager. Ce qu’il fait jusqu’en 1930. D’abord auprès de Bennett puis d’autres, tout en travaillant, dans une attitude critique digne de son passé, à l’organisation du parti. Lors du déclenchement des élections générales fédérales le 30 mai 1930, La Vergne hésite à se présenter car, au delà de son comportement frondeur, ses douleurs lombaires le font souffrir. Le 13 juillet, il lance néanmoins sa campagne conservatrice dans Montmagny, affligée par la crise économique. Se qualifiant d’homme libre, il déploie son nationalisme dont il ambitionne le rayonnement. Le 28 juillet 1930, La Vergne l’emporte. Joyeux, il télégraphie son bonheur à Bennett, bientôt premier ministre puisque son parti gagne 137 circonscriptions, dont 24 au Québec.
Retour aux Communes, 1930–1935
Désillusions et interrogations
Cette joie ne dure pas. Jusqu’en 1935, La Vergne connaît plusieurs désillusions. Ce conservateur à la discipline de parti relâchée souhaite devenir ministre ; il n’obtient que la vice-présidence de la Chambre, fonction secondaire assumée avec compétence de 1930 à 1935. Actif, il lutte pour ses propositions nationalistes, dont l’égalité des Canadiens français et des Canadiens anglais au Canada, de leurs langues et de leurs aspirations de minoritaires dans les provinces où ils ne peuvent se prévaloir d’un statut majoritaire. Il ne recueille que des miettes. Notamment lors de la Conférence économique impériale de l’été de 1932 à Ottawa. Constatant l’attitude frileuse de Bennett sur le bilinguisme, il s’éclate dans le Devoir du 21 juillet : « [I]l convient de dire que jamais, sous aucun gouvernement, notre race [les Canadiens français] n’a eu aussi peu d’influence. » Puis, lorsque le premier ministre récidive concernant l’émission d’une monnaie bilingue [V. sir Thomas Chapais*], La Vergne hasarde même des démarches auprès de libéraux. Le compromis de Bennett et de Meighen, devenu sénateur, le désespère. La Vergne écrit au Devoir le 21 juillet 1934 : « Le parti libéral, officiellement, par la voix de son chef, s’est prononcé en faveur du bilinguisme ; et le parti conservateur, officiellement, par son chef, s’est prononcé contre. » Entre 1931 et 1934, La Vergne se heurte aussi aux trois ministres canadiens-français – Arthur Sauvé*, Maurice Dupré et Alfred Duranleau – qui, incapables et sans influence selon lui, l’aideraient entre autres trop peu dans le favoritisme pour sa circonscription. Désabusé, il s’éloigne du caucus conservateur et espère en vain quitter Ottawa pour devenir délégué à la Société des nations en 1931 et en 1933 ou lieutenant-gouverneur de la province de Québec en 1933. S’il contribue à l’élection de Maurice Le Noblet Duplessis* à la tête du Parti conservateur provincial en 1933, l’homme est abattu.
Naissent alors les interrogations. D’abord, sur la pertinence de sa carrière. Le 30 octobre 1933, La Vergne confie à l’abbé Lionel Groulx* sa crainte d’avoir « fait fausse route » et qu’« il vient des moments où [il] ne sai[t] plus… » Puis, sur sa santé. La Vergne réalise qu’une longue dégradation physique ne lui sera pas épargnée. Sa fracture vertébrale l’afflige d’« horribles tortures » qui l’affaiblissent, l’obligent à utiliser des béquilles, réduisent ses activités, redessinent son corps qui abdique. La Vergne n’est plus, pour Groulx, qu’un demi-paralytique. Courbé, presque chauve, il a vieilli prématurément. Il subit, vainement, divers traitements, une délicate opération en 1931 et plusieurs séjours à l’hôpital. Le 17 janvier 1934, il avoue à Groulx : « [J]e souffre beaucoup et mon moral se désagrège. Je désire la mort. »
Réconfort et Jeune-Canada
La Vergne bénéficie de réconfort. D’abord, de sa foi. Il devient si religieux qu’il accepte ses souffrances. Puis, de Groulx. Une franche amitié s’est nouée entre eux. La Vergne le présente même comme son « seul chef » pendant un discours prononcé au Monument national de Montréal le 10 avril 1933, tel que le rapporte le Devoir le jour suivant. L’abbé lui confirme l’utilité de son œuvre. La Vergne s’exclame ainsi le 30 octobre 1933 : « Merci pour votre lettre, quel réconfort. » En outre, des démarches de son épouse, Georgette Roy, auprès de Bennett. Celle-ci, femme du monde bien au courant des dessous, des manœuvres et des tractations entourant la vie politique, tente d’éveiller le premier ministre à l’importance de son mari ainsi qu’à la nécessité de l’encourager et de lui offrir les promotions désirées, ce qui doit réjouir La Vergne. Certes, Armand et Georgette ne vivent pas le grand amour. Armand l’a constamment ressenti et déploré, mais, en dépit de moments difficiles, l’un et l’autre se sont toujours témoigné de la tendresse et du respect comme le montrent leurs correspondances personnelles. D’autres nationalistes apaisent aussi La Vergne : les Jeune-Canada réunis autour d’André Laurendeau* et de Pierre Dansereau*, étudiants. Ils accueillent son nationalisme, dont son opposition à l’immigration intensive et juive. Même s’il refuse l’étiquette antisémite, La Vergne méprise depuis longtemps l’immigration juive. Il écrit dans le Miroir et le Goglu, organes antisémites montréalais d’Adrien Arcand* et de Joseph Ménard qu’il appuie auprès de Bennett, et il va jusqu’à admettre l’authenticité du meurtre rituel juif. Invité d’honneur au lancement de la campagne des Jeune-Canada en 1932, La Vergne contribue à deux autres assemblées. Grâce aux Jeune-Canada, confesse-t-il à Groulx le 27 décembre 1933, « [n]ous n’aurons pas vécu en vain ». Enfin, au début de 1935, La Vergne éprouve la satisfaction de conclure le premier tome de ses mémoires tandis qu’il combat difficilement une vilaine grippe. Il y tente, pas toujours adroitement et avec justesse, de relier les fils dispersés de son existence tumultueuse et de ses actions audacieuses jusqu’en 1914. Ses mémoires déçoivent, car trop ancrés à la surface des sujets. Au bout de sa vie, La Vergne n’en verra jamais la publication le 15 mars 1935.
Bilan
Armand La Vergne meurt d’une pneumonie à l’hôpital Saint-Vincent d’Ottawa le 5 mars 1935, à l’âge de 55 ans. Suivent les hommages, les funérailles le 8 mars à Arthabaska, puis diverses activités pour l’honorer : messes au Québec et au Manitoba, évocation de sa mémoire par plusieurs institutions, associations, simples citoyens, clubs et organisations dont il a fait partie. S’ajoutent des conférences de Laurendeau et d’Omer Héroux*, rédacteur en chef du Devoir, en mars et avril 1935 et, le 4 octobre 1936, un pèlerinage nationaliste à Arthabaska. Plus tard, son nom sera attaché à des avenues à Montréal et Montmagny, ville centrale de sa circonscription pour laquelle il a rempli du mieux qu’il a pu son rôle de député intermédiaire. Il en sera de même d’une école primaire et d’un centre d’hébergement à Montréal. Parfois, des personnes rappellent son souvenir dans des journaux, dans des sites Web et dans leurs correspondances. En 2022, le professeur et auteur Claude Corbo en fait l’un des deux principaux personnages d’une fiction historique. Au total, une carrière politique hors du commun que celle d’Armand La Vergne ! Certes, elle est considérée décevante par ceux rivés aux lignes partisanes et même par Bourassa pour qui, comme il le caricature pendant une conférence en 1944, La Vergne a été « toute sa vie un jeune homme de belle espérance ». Pour d’autres, cette carrière, au parcours sinueux, houleux, parfois incompréhensible et parsemé d’erreurs telle sa xénophobie, reste motivante car centrée sur l’indépendance d’agir en fonction d’objectifs ambitieux et nobles. La Vergne laisse peu de réalisations concrètes. Mais il a assidûment cherché à élever la conscience et l’éthique politiques de ses compatriotes afin qu’ils s’entendent sur une application généreuse du pacte de 1867. Tout en manifestant un réel attachement aux Premières Nations, cette application respecterait, selon lui, les deux nations contractantes et leurs langues dont l’une, qu’il a tant aimée, demeure alors médiocrement soutenue.
Nous tenons à remercier les auxiliaires de recherche qui ont effectué pour nous des dépouillements ponctuels dans quelques journaux et dépôts d’archives.
Les sources d’information essentielles de cette biographie d’Armand La Vergne demeurent la correspondance et les écrits de ce personnage qui sont, somme toute, relativement réduits. Ses principaux fonds d’archives sont conservés à BAC, R6172-0-1 (fonds de la famille Armand Lavergne), à BAnQ-Q, P487 (fonds Armand Lavergne), et au Musée de la civilisation (Québec), P34 (fonds Armand Lavergne). Nous avons retracé et consulté un fonds privé, composé d’une quantité importante de documents inédits à ce jour ayant appartenu à La Vergne et à sa famille, chez une personne qui désire garder l’anonymat. Celle-ci nous a aussi remis trois albums de photos originales. Nous avons également consulté le fonds Juliette Bussières – intéressant mais de moindre portée que le précédent –, avant sa cession en août 2023 à BAnQ-Q (P487, S1) par l’avocat Pierre Delisle, qui l’a généreusement mis à notre disposition. D’autres fonds d’archives, notamment d’hommes politiques et de journalistes, ont éclairé plusieurs aspects de la carrière de La Vergne. Mentionnons, entre autres, à BAC, les fonds sir Wilfrid Laurier (R10811-0-X), Henri Bourassa (R8069-0-5), sir Robert Borden (R6113-0-X), Frederick Debartzch Monk (R14067-0-1) et Arthur Meighen (R14423-0-6) ; à la Univ. of N.B. Libraries, Arch. & Special Coll. (Fredericton), le Richard Bedford Bennett fonds (MG H 96) ; à BAnQ-CAM, les fonds Familles Laurendeau et Perrault (CLG2), Famille Olivar Asselin (CLG72), Lionel Groulx (CLG1 ; on trouvera la correspondance avec l’abbé Groulx citée dans notre texte sous la cote CLG1, S1, D2164), fonds Famille Bourassa (CLG65 ; on trouvera la conférence de Bourassa de 1944 sous la cote CLG65, S3, SS6, D60) ; à VM-SA, le fonds Olivar Asselin (BM55) ; à BAnQ-Q, dans le fonds Famille Rivard (P584), la série Antoine Rivard (S2).
La Vergne n’a pas rédigé de publications d’envergure. Au total, ses écrits, insuffisamment approfondis, se résument à ses mémoires intitulés Trente ans de vie nationale (Montréal, 1935), incontournables, malgré leurs faiblesses, pour évaluer sa carrière jusqu’en 1914, à deux brochures, soit les Écoles du Nord-Ouest (Montréal, 1907) et Deux refus (s.l., [1932 ?]), et enfin à quatre articles publiés dans des revues : « Un beau et bon livre : l’Indépendance économique du Canada français, par Errol Bouchette, Compagnie d’imprimerie d’Arthabaska, 1907 », la Revue franco-américaine (Québec), 1 (1908) : 89−93 ; « la Patrie canadienne », Dalhousie Rev., 9 (1929–1930) : 457–460 ; « Canadiens », l’Action nationale (Montréal), 5 (1935) : 26–30 ; et « Propos d’un jeune… un peu mûr », Vivre (Québec), 1re sér., 6 (1934–1935) : 10–12. De plus, La Vergne a rédigé plusieurs articles parus dans quelques journaux que nous avons consultés systématiquement, dont le Nationaliste (Montréal) (1904–1910) et le Devoir (1910–1935). Nous pouvons y ajouter le Courrier de Montmagny (Montmagny, Québec) ainsi que le Franc Parler (Québec), compulsés occasionnellement à des moments clés. D’autres quotidiens ou hebdomadaires ont reproduit des lettres ouvertes de La Vergne à des individus ou ont relevé plusieurs de ses activités politiques et de ses conférences, en les louangeant ou en les critiquant. Parmi eux, mentionnons, entre autres, le Soleil (parcouru systématiquement de 1904 à 1935), la Presse et la Patrie (parcourus à des moments clés de 1904 à 1935), l’Événement (parcouru à des moments clés de 1901 à 1935), l’Action catholique (Québec) (parcouru à des moments clés de 1915 à 1935) et l’Union des Cantons de l’Est (Arthabaskaville [Victoriaville, Québec]) (parcouru à des moments clés de 1881 à 1900, ainsi qu’en mars 1935). Enfin, deux autres sources, indispensables, nous ont permis d’évaluer le rôle de La Vergne aux parlements d’Ottawa et de Québec : Canada, Chambre des communes, Débats, 1904–1908, 1930–1935 ; et Québec, Assemblée législative, Débats, 1909–1916.
Les études sérieuses consacrées à La Vergne n’abondent pas dans l’historiographie. Nous pouvons être reconnaissants, d’abord, à l’historien Marc La Terreur d’avoir posé les premières et incontournables balises à une meilleure connaissance de la carrière de La Vergne. Faute d’avoir pu découvrir sa correspondance complète malgré ses efforts obstinés, La Terreur a néanmoins produit un solide article, « Armand Lavergne : son entrée dans la vie publique », RHAF, 17 (1963–1964) : 39–54, et édité une brochure retraçant d’un point de vue critique sa vie et ses œuvres, Armand Lavergne (Montréal et Paris, 1968). Dans son ouvrage les Tribulations des conservateurs au Québec : de Bennett à Diefenbaker (Québec, 1973), La Terreur a réservé à La Vergne des pages détaillées qui dévoilent plusieurs informations indispensables à la compréhension de sa carrière dans les dernières années de sa vie. L’historienne Andrée Rivard a ajouté au savoir sur le personnage en présentant en 1989 un excellent mémoire de maîtrise, « le Député Armand Lavergne et son rôle d’intermédiaire (1904–1908, 1930–1935) » (univ. Laval). Pour notre part, nous avons rédigé une notice biographique de La Vergne, « La Vergne, Armand », pour l’Encyclopédie canadienne (accessible en ligne à thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-vergne-armand). D’autres personnes qui ont connu et apprécié La Vergne, dont des journalistes, se sont penchées sur l’homme et sa carrière, peu avant et peu après sa mort. Nous avons lu leurs articles avec un esprit critique aiguisé. Soulignons en particulier l’apport de Louis Dupire, dans « Armand LaVergne », l’Action nationale, 1 (1933) : 348–357 ; celui d’une brochure qui regroupe six courts articles sous le titre Un patriote : Armand La Vergne (Montréal, [1935]) ; et, surtout, celui d’André Laurendeau, dans « Armand La Vergne », l’Action nationale, 5 (1935) : 335–364.
D’autres œuvres ont accordé un espace quelque peu privilégié à La Vergne. Relevons, entre autres, celle de l’avocat Renaud Lavergne, son cousin, qui a produit ses mémoires intitulés Histoire de la famille Lavergne, B. C. Payette, compil. (Montréal, [1970]), lesquels, malgré leurs limites, révèlent des événements et faits parfois inédits entourant le personnage ; celle, éclairante, de l’abbé Lionel Groulx, historien, qui, surtout dans les volumes 2 et 3 de Mes mémoires (4 vol., Montréal, 1970–1974), témoigne de ses relations avec La Vergne et soumet son appréciation de l’homme et de sa carrière ; et celle de l’historien Jean Provencher qui expose brillamment le rôle joué par La Vergne lors des émeutes contre la conscription à Québec en 1918 dans Québec sous la loi des mesures de guerre, 1918 (Montréal, 2014). À ces ouvrages, nous pouvons ajouter, notamment, deux de nos livres, soit Wilfrid Laurier : quand la politique devient passion ([Québec], 2007) et Henri Bourassa : le fascinant destin d’un homme libre (1868–1914) ([Québec], 2013) ; ceux de Robert Rumilly, Henri Bourassa : la vie publique d’un grand Canadien (Montréal, 1953) et Maurice Duplessis et son temps (2 vol., Montréal, 1973), 1 (1890–1944) ; celui d’Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec (2 vol., [Saint-Laurent, Québec], 2000–2004), 2 (1896–1929) ; celui d’Hélène Pelletier-Baillargeon, Olivar Asselin et son temps (3 vol., [Montréal], 1996–2010), 1 (le Militant) ; celui de B. L. Vigod, Quebec before Duplessis : the political career of Louis-Alexandre Taschereau (Kingston, Ontario, et Montréal, 1986) ; celui de Nelson Michaud, l’Énigme du sphinx : regards sur la vie politique d’un nationaliste (1910–1926) ([Sainte-Foy [Québec]], 1998) ; et enfin l’excellent mémoire de maîtrise de Denis Chouinard, « les Jeune-Canada : un mouvement contestataire des années 1930 » (univ. Laval, 1984).
Ancestry.com, « Registres d’état civil et registres paroissiaux (Collection Drouin), Québec, Canada, 1621 à 1968 », Basilique Notre-Dame (Montréal), 1er déc. 1904 ; St-Christophe (Arthabaska), 8 mars 1935 : www.ancestry.ca/search/collections/1091 (consulté le 20 juin 2023).— BAnQ-MCQ, CE402-S2, 22 févr. 1880.— Claude Corbo, Armand et sir Wilfrid : fiction historique ([Montréal, 2022]).
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Réal Bélanger, « LA VERGNE, ARMAND », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 16, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 9 févr. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/la_vergne_armand_16F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/la_vergne_armand_16F.html |
| Auteur de l'article: | Réal Bélanger |
| Titre de l'article: | LA VERGNE, ARMAND |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 16 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 2024 |
| Année de la révision: | 2024 |
| Date de consultation: | 9 févr. 2026 |