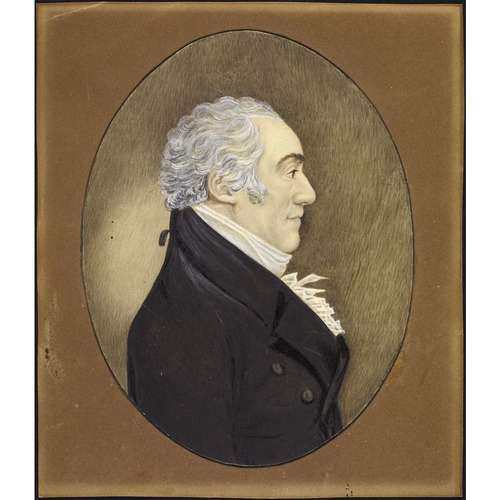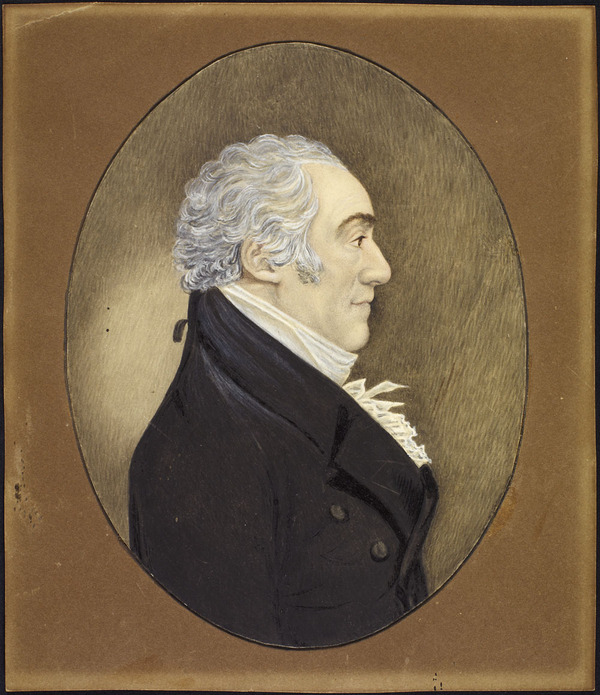
Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 4399116
RICHARDSON, JOHN, homme d’affaires, homme politique, juge de paix, fonctionnaire et officier de milice, né vers 1754 à Portsoy, Écosse, fils de John Richardson et de la fille de George Phyn ; le 12 décembre 1794, il épousa Sarah Ann Grant, nièce de William Grant*, et ils eurent sept enfants ; décédé le 18 mai 1831 à Montréal.
En 1774, après avoir étudié les arts au King’s College d’Aberdeen, en Écosse, John Richardson devint, grâce à sa famille, apprenti à la Phyn, Ellice and Company. Cette société écossaise, bien établie dans le commerce des fourrures, avait alors son siège à Schenectady, dans la colonie de New York. Richardson y arriva en mai et, peu après, la détérioration des relations entre les colonies américaines et la Grande-Bretagne obligea la compagnie à se réorganiser. Son oncle James Phyn s’établit comme fournisseur à Londres et l’associé de celui-ci, Alexander Ellice*, réinstalla le centre des activités nord-américaines à Montréal. Au début de la Révolution américaine, Richardson passa au service de John Porteous, ancien associé de la Phyn, Ellice and Company et important fournisseur des troupes britanniques à New York et à Philadelphie. En 1779, il devint capitaine des fusiliers marins sur le corsaire Vengeance, dont Porteous était le principal propriétaire et dans lequel lui-même détenait des actions. Les lettres qu’il écrivit lors de la première croisière du navire révèlent l’un des traits dominants de son caractère : une confiance excessive en lui-même et en ceux qu’il considérait comme ses compagnons. « Qu’un seul vaisseau se pointe et, loin d’être effrayés, nous le rattraperons vite », lançait-il. L’ivresse de l’aventure donc, mais aussi la duplicité des équipages mis à bord des navires capturés et, surtout, la confusion et les dangers inhérents à la guerre de course apparaissent sous sa plume. Le 21 mai 1779, un navire de la marine royale, le Renown, insoucieux du pavillon britannique que battait le Vengeance, tira sur le bâtiment cinq ou six bordées qui blessèrent plusieurs membres de l’équipage, dont certains mortellement, et qui endommagèrent gravement la coque. Le capitaine du Renown n’exprima aucun regret même une fois que l’identité du Vengeance eut été clairement établie et abandonna à son sort le bâtiment rasé, « cruauté gratuite, écrivit Richardson, et indigne d’un Britannique ».
Dès août 1780, Richardson possédait conjointement avec Porteous et la Phyn, Ellice and Company de Londres, à laquelle il expédiait de l’indigo, du riz et du tabac, un magasin à Charleston, en Caroline du Sud. Ses lettres de là-bas montrent toute l’attention qu’il portait aux affaires, sa connaissance des techniques comptables et son habileté à répondre à l’offre et à la demande de biens de consommation aussi divers que les chapeaux à cornes dernier cri, les fleurs artificielles et les selles de cheval. Elles expriment aussi une haine de la déloyauté, sentiment que Richardson allait manifester à maintes reprises dans le Bas-Canada.
Une fois la paix revenue en 1783, Richardson travailla de nouveau pour la Phyn, Ellice and Company à New York et à Schenectady. En 1787, il fut envoyé à Montréal pour aider son cousin John Forsyth* à réorganiser la société qui avait succédé à l’Alexander Ellice and Company, la Robert Ellice and Company. Celle-ci avait beaucoup trop étendu ses activités au sud de Detroit et de Michillimakinac (Mackinac Island, Michigan), et les forces de son principal actionnaire, Robert Ellice*, déclinaient. De 1787 à 1789, Richardson travailla alternativement à Montréal et dans l’Ouest. En ville, il apprit à connaître en détail les affaires de la compagnie : le commerce des fourrures entre Montréal et le Sud-Ouest, la spéculation sur les lettres de change, la perception, auprès du gouvernement, des compensations destinées aux loyalistes puis leur remise aux bénéficiaires, ainsi que l’acheminement des ravitaillements aux établissements loyalistes et militaires du Haut-Canada. Dans l’Ouest, il supervisait la traite, qui se trouvait dans un état déplorable, faisait rapport à ce sujet et surveillait la construction du schooner de la compagnie, le Nancy, qui devait servir sur les lacs Huron et Michigan. À la mort de Robert Ellice en 1790, Richardson devint associé de la compagnie, qui prit alors le nom de Forsyth, Richardson and Company. Même si les cousins étaient déterminés à éviter les coûteux excès de Robert Ellice, ils ne manquaient pas d’audace. En quelques années, leur compagnie étendit le commerce transitaire, surtout vers Kingston, dans le Haut-Canada, et York (Toronto), augmenta ses investissements dans le transport sur les Grands Lacs, acquit quelques actions dans la North West Company et prit le risque de participer à la Compagnie de la distillerie de Montréal [V. Thomas McCord], qui mit malheureusement fin à ses activités en 1794. En 1792, Richardson avait pris l’une de ses initiatives les plus originales : par l’entremise de la Forsyth, Richardson and Company et de concert avec la Todd, McGill and Company de Montréal [V. Isaac Todd*] et de la Phyn, Ellices, and Inglis de Londres, il avait tenté de fonder une banque. La Canada Banking Company devait être une banque d’émission, d’escompte et de dépôt ; elle aurait pu répondre à un besoin découlant de la rareté, de la diversité et de l’instabilité du numéraire en circulation, mais elle se révéla prématurée. Au cours de cette période comme par la suite, la Forsyth, Richardson and Company fit pression sur les gouvernements impérial et coloniaux pour obtenir des changements politiques favorables au commerce. Par exemple, en 1791–1792, de concert avec d’autres marchands de fourrures, elle s’opposa à l’évacuation des postes militaires que les Britanniques tenaient dans l’ouest des États-Unis depuis la fin de la révolution, ce qui contribua peut-être à reporter leur abandon à 1796.
Dès qu’il commença à résider à Montréal, Richardson se joignit au mouvement des marchands en faveur de l’instauration d’une chambre d’Assemblée élue et de l’introduction du droit commercial anglais [V. George Allsopp* ; William Grant]. En 1787, il se plaignit que le gouvernement faisait sans cesse obstacle aux marchands alors qu’il aurait dû « reconnaître le commerce comme sa base et le soutien au marchand comme l’un des principaux moyens de promouvoir la prospérité nationale ». En mars 1791, Richardson signa, avec des collègues de la colonie et des marchands londoniens intéressés, une pétition contre le projet de loi qui allait devenir l’Acte constitutionnel. Interrogé à la barre de la chambre des Communes, il s’opposa à la division de la colonie, principal but du projet de loi, et au maintien, dans le Bas-Canada, du droit civil français, qui favorisait les débiteurs aux dépens des créanciers.
Même s’il était déçu par la nouvelle constitution, Richardson se présenta, en 1792, aux premières élections générales qui suivirent son adoption. Lui-même et Joseph Frobisher* furent élus par « une forte majorité » dans Montréal-Est, grâce à l’appui d’éminents marchands britanniques comme Thomas McCord et de Canadiens influents comme Joseph Papineau*. Sans tarder, Richardson s’imposa comme le chef du groupe des marchands à l’Assemblée. En février 1793, lors d’un violent débat sur la langue de la législation et des débats, il proposa que seul le texte anglais soit reconnu légalement. Toujours direct dans ses manières, il justifia sa motion par un long discours tout en anglais et déclara de but en blanc que les « plus chers intérêts » des Canadiens seraient favorisés si seulement ils acceptaient « progressivement d’adopter » les coutumes des anciens sujets de Sa Majesté. Son intervention nourrit les passions politiques pendant quelques semaines. Finalement, il gagna : quelque temps après son discours, le gouverneur fut avisé de ne sanctionner que la version anglaise des lois, y compris celles qui touchaient le droit civil même si l’Assemblée avait décrété que la version française prévaudrait dans ce cas. Richardson se révéla infatigable lorsqu’il s’agissait de proposer ou d’amender des projets de loi, de rédiger des adresses à l’intention du gouverneur, de négocier avec le Conseil législatif, d’améliorer le règlement sur les débats et, ce qui est ironique étant donné la suite des événements, d’affirmer que seule l’Assemblée avait le privilège de présenter des projets de loi de subsides. En outre, il était très efficace : on lui doit des lois sur la négociabilité des billets à ordre, l’importation de potasse en provenance des États-Unis, l’estimation des pièces d’or, la prévention de la fraude chez les engagés, la tenue des registres d’état civil et la publication des lois.
Néanmoins, siéger à l’Assemblée était pour Richardson une source de frustrations. Les Canadiens, écrivit-il à Alexander Ellice lors de la première session, tenaient leurs caucus à l’extérieur, quel qu’en ait été le sujet, et essayer de les faire changer d’avis était « comme parler aux vagues de la mer ». Il existait parmi eux, il en était sûr, une faction « contaminée par les principes détestables qui préval[aient] alors en France ». Rien ne pouvait être « aussi ingrat que la situation des députés anglais [...] condamnés à combattre les absurdités de la majorité sans le moindre espoir de réussir ». Il ne se présenta ni aux élections de 1796 ni à celles de 1800.
Dès le début des hostilités contre la France révolutionnaire, la sécurité devint pour Richardson une préoccupation de tous les instants. Ce fut lui qui proposa l’adresse que l’Assemblée adopta à l’unanimité et fit parvenir au lieutenant-gouverneur Alured Clarke en avril 1793, adresse qui promettait une collaboration totale et décrivait l’exécution de Louis XVI comme « l’acte le plus atroce qui ait jamais déshonoré une société ». En 1794, il fut à l’origine d’importantes modifications à la loi sur la milice de même qu’à la loi sur les non-naturalisés, qui suspendait temporairement l’habeas corpus, et il participa au comité montréalais de l’Association, fondée cette année-là pour soutenir le régime britannique. En octobre 1796, au plus fort des émeutes soulevées à Montréal par une nouvelle loi sur les chemins et les ponts, Richardson figura parmi les juges de paix choisis pour remplacer les magistrats qui, de l’avis du gouverneur Robert Prescott*, s’étaient montrés trop timorés envers les émeutiers.
Dans les derniers mois de 1796 et en 1797, à titre de chef du service bas-canadien de contre-espionnage, Richardson intercepta du courrier, fit interroger des personnes soupçonnées de trahison et dirigea une chaîne d’informateurs qui s’étendait de Montréal à la frontière américaine. Il apprit que le ministre de France aux États-Unis envoyait des « émissaires » dans le Bas-Canada pour évaluer la sympathie des habitants envers son pays, étudier la défense de la colonie et établir une cinquième colonne qui soutiendrait une invasion navale prévue pour l’été ou l’automne de 1797. Les preuves recueillies par Richardson servirent à arrêter, en février 1797, trois Montréalais accusés de trahison (ils furent acquittés par la suite), à justifier l’Acte pour la meilleure préservation du gouvernement de Sa Majesté, qui suspendait de nouveau l’habeas corpus et que le procureur général Jonathan Sewell* fit adopter par le Parlement, ainsi qu’à préparer le dossier de la couronne contre David McLane*, qui fut exécuté pour trahison en juillet 1797. Même s’il mettait en doute les énormités que lui racontaient parfois ses informateurs, Richardson, comme la plupart des membres de l’élite dirigeante, surestimait beaucoup le danger : les émeutes déclenchées par la loi sur les chemins et les ponts, pensait-il, avaient été une tentative d’insurrection fomentée par des émissaires ; les Français enverraient une flotte qui pourrait compter 30 000 hommes et qui trouverait un appui concret parmi les habitants et les hommes politiques déloyaux comme Joseph Papineau et Jean-Antoine Panet*, chefs d’un parti de « sans-culottes » à l’Assemblée. En février 1797, Richardson réclama la promulgation de la loi martiale, unique moyen de protéger vraiment les nantis contre « toutes les horreurs de l’assassinat ». Quand les autorités apprirent en juillet 1801 que l’aventurier vermontois Ira Allen avait mis sur pied une société secrète à Montréal, elles chargèrent Richardson de l’enquête. Celle-ci déboucha sur l’arrestation de quelques-uns des meneurs et permit de prouver que la société avait projeté de former dans le Bas et le Haut-Canada une multitude de cellules qui auraient appuyé une invasion à partir du Vermont. Richardson fut également enseigne dans la British Militia of the Town and Banlieu of Montreal à compter de 1794 et il prit en 1801 l’initiative de fonder une association de volontaires armés qui surveillaient attentivement les étrangers, s’entraînaient et, pendant les nuits d’octobre, patrouillèrent les rues de Montréal.
Du côté commercial, la situation de Richardson atteignait, vers le début du siècle, un point critique. Le sud des Grands Lacs n’offrait plus de peaux de castor de première qualité ; les tarifs américains et la colonisation posaient déjà des problèmes évidents. La Forsyth, Richardson and Company s’était donc mise à faire largement de la traite dans le Nord-Ouest. Elle rivalisait notamment avec la North West Company, dont elle avait cessé d’être actionnaire dès 1798. Ce fut particulièrement pour soutenir l’intense concurrence qui se dessinait de ce côté que, la même année, elle s’allia avec la Phyn, Ellices, and Inglis, avec la Leith, Jameson and Company de Detroit et avec six associés hivernants pour fonder une société en nom collectif appelée New North West Company, qui fut également connue après 1799 sous les noms de XY Company et de New Company. En 1800, le fameux explorateur Alexander Mackenzie* ainsi que John Ogilvy* et John Mure, tous deux associés à une société prospère de Montréal, la Parker, Gerrard, and Ogilvy, joignirent ses rangs, ce qui représentait un nouvel apport de capitaux et de savoir-faire ; d’ailleurs, à compter de 1802, on l’appela à l’occasion la Sir Alexander Mackenzie and Company. Sa concurrence avec la North West Company se transforma en guerre économique et divisa en deux camps les Britanniques de Montréal. De 1799 à 1804, les investissements de la New North West Company en équipement annuel triplèrent, passant d’environ £8 000 à près de £25 000. Dès 1804, elle détenait environ un tiers de la traite du Nord-Ouest, et sa part grandissait toujours.
Toutefois, cette concurrence était ruineuse. Libéralement abreuvés de rhum de traite, les Indiens perdaient toute motivation ; les coûts montaient en flèche tandis que la valeur d’échange des marchandises de traite chutait. Comme le dit plus tard Edward Ellice*, fils d’Alexander, la seule question était de savoir quelle compagnie enregistrait les plus lourdes pertes. Les crimes tels la corruption d’employés et le vol de marchandises de traite étaient courants. Les Indiens étaient encouragés à piller les canots rivaux ou à tirer sur eux. Un commis de la New North West Company tua même, d’un coup de feu, un autre commis de la compagnie rivale mais, lorsqu’il fut traduit en justice à Montréal en 1802, on découvrit que les crimes commis sur le Territoire indien n’étaient soumis à la juridiction d’aucun tribunal de l’Amérique du Nord britannique. Faisant état de la situation à la demande de sir Robert Shore Milnes*, lieutenant-gouverneur du Bas-Canada, Richardson conclut que si cette juridiction n’était pas conférée aux tribunaux canadiens, la force pourrait bien en venir à prévaloir sur la justice dans le Nord-Ouest, auquel cas « la traite des fourrures finira[it] nécessairement par être annihilée ». Milnes souligna l’importance de la recommandation de Richardson à lord Hobart, secrétaire d’État aux Colonies, comme le fit Mackenzie. Il en résulta, en 1803, une loi impériale qui plaçait les crimes commis sur le Territoire indien sous la compétence des tribunaux du Bas-Canada (et dans certaines circonstances, du Haut-Canada) et qui habilitait le chef du gouvernement bas-canadien à nommer des magistrats dans l’arrière-pays. Comme les associés hivernants craignaient pour leur vie et que les deux compagnies rivales étaient elles-mêmes menacées de faillite par leur lutte, elles convinrent en 1804 de fusionner. La New North West Company acquit alors le quart des actions de la North West Company réorganisée.
Entre-temps, sans doute grâce à la diversité de ses intérêts et à la solidité de ses appuis londoniens, la Forsyth, Richardson and Company s’était bien tirée d’affaire. En 1803, un marchand d’Albany, dans l’état de New York, évalua le volume de ses exportations à £40 000, ce qui la plaçait selon son estimation au troisième rang des sociétés montréalaises, derrière la North West Company (£150 000) et la Parker, Gerrard, Ogilvy and Company (£85 000). De toute évidence, ses transactions avec le Haut-Canada et le Nord-Ouest représentaient une part importante de son chiffre d’affaires : il semble qu’en 1803 elle envoya autant d’embarcations que la North West Company en amont de Montréal.
Pressé par Milnes, Richardson surmonta ses réticences et se présenta aux élections de 1804. Vainqueur dans Montréal-Ouest, il reprit la direction des députés anglophones. En 1805, il se trouva mêlé à une controverse au sujet du financement de la construction des prisons, la question étant de savoir s’il fallait recourir à la taxation foncière, comme lui-même l’avait préconisé pendant la campagne électorale, ou à des droits sur les importations, qui pèseraient surtout sur les commerçants de fourrures du Nord-Ouest. L’année suivante, les députés marchands et Richardson tout particulièrement tentèrent en vain de faire annuler la loi sur les prisons et d’empêcher la majorité d’ordonner l’arrestation, pour outrage ou diffamation, d’Isaac Todd et des rédacteurs en chef Thomas Cary et Edwards Edwards*, qui avaient tous trois dénoncé cette loi en termes ironiques. En 1807 et 1808, il prôna vigoureusement, mais encore sans succès, des mesures destinées à promouvoir l’immigration dans les Cantons-de-l’Est et à accroître la production agricole. En outre, il se battit en vain pour empêcher l’Assemblée d’adopter un projet de loi qui interdisait aux juges de se présenter aux élections. En dépit d’une polarisation toujours plus marquée des forces politiques, Richardson remporta tout de même quelques victoires : ses projets de loi portant sur une meilleure réglementation du travail des pilotes, sur les travaux de la route entre Montréal et Lachine et sur le financement de l’amélioration de la navigation sur le Saint-Laurent, entre autres, furent adoptés.
En avril 1808, Richardson prononça un long discours pour défendre un autre de ses projets de loi, touchant cette fois la constitution d’une « Banque du Bas-Canada ». Ce plaidoyer, fondé sur le principe d’une monnaie dont la valeur devait être garantie par des biens fonciers, a quelque peu vieilli, mais il demeure un morceau remarquable. Richardson, avec une merveilleuse lucidité, y retraçait l’évolution du papier-monnaie, y exposait les principes généraux du système bancaire et y démolissait nombre d’objections. Il expliquait comment fonctionnait l’escompte à court terme, pourquoi l’émission des billets de banque devait dépasser les réserves liquides, pourquoi les faillites bancaires seraient rares et comment les cas de contrefaçon pourraient être réduits au minimum. En outre, il démontrait avec éclat une contradiction apparente : les banques constituées en sociétés à responsabilité limitée mais dont les investissements et l’émission de billets étaient réglementés s’avéraient plus sûres que les banques privées à responsabilité illimitée. Son discours et son projet de loi furent imprimés pour le bénéfice de la population. Le projet ne put être adopté en raison de la prorogation de l’Assemblée mais, durant la décennie qui suivit, il contribua grandement, avec le discours, à faire accepter le papier-monnaie et les banques par la population.
S’étant aliéné les électeurs canadiens de Montréal-Ouest par ses prises de position controversées à l’Assemblée, Richardson fut battu aux élections de 1808. Toutefois, il ne se trouva pas évincé de la scène politique, car il avait été nommé membre honoraire du Conseil exécutif en décembre 1804 et avait pris son siège le 25 novembre 1805. Conformément à une entente avec Milnes, il n’assistait aux réunions du conseil que lorsqu’il se trouvait à Québec pour la session parlementaire ou par affaires, mais il était disponible pour les travaux en comité à Montréal. Pendant la session de 1808, le gouverneur sir James Henry Craig* le désigna messager officiel du Conseil exécutif auprès de l’Assemblée sur les questions touchant la prérogative royale, titre prestigieux conféré précédemment à John Young* et à James McGill*. Il devint membre régulier du Conseil exécutif en décembre 1811 et le demeura jusqu’à sa mort. En cette qualité, il fut particulièrement influent auprès de gouverneurs inflexibles comme Craig et lord Dalhousie [Ramsay*], tandis que sir George Prevost* et sir James Kempt*, hommes de conciliation, le consultèrent beaucoup moins. Richardson devait notamment remplir la fonction de juge lorsque le Conseil exécutif devenait la Cour d’appel. Même s’il n’avait pas étudié le droit, il en saisissait bien les principes et pouvait absorber rapidement les points techniques d’une affaire. En 1821, il prononça au nom du conseil un jugement qui, autorisait seulement les prêtres ou ministres des Églises « établies » – catholique, anglicane et presbytérienne – à tenir des registres officiels des baptêmes, mariages et sépultures, décision restrictive qui fut corrigée plus tard par plusieurs lois provinciales.
Durant les guerres napoléoniennes, Richardson s’attela de nouveau à conjurer les multiples dangers qui guettaient la colonie. En 1803, des informateurs furent mis au travail dans le Bas-Canada et dans les villes de la frontière américaine pour découvrir les agissements des émissaires. Richardson rapporta des rumeurs venant de Paris selon lesquelles la colonie serait attaquée. L’emploi du temps de Jérôme Bonaparte lors de sa visite aux États-Unis fut relevé avec soin et un incendie suspect à Montréal fit l’objet d’une enquête. En 1804, Richardson rédigea un projet de loi qui prévoyait le versement de primes à ceux qui appréhendaient des déserteurs de l’armée ; le texte, présenté par McGill, fut adopté. À l’instigation de Milnes, il prit de l’argent du service secret pour faire de Jacques Rousse – Canadien expatrié qui, en 1793–1794, avait été espion pour le compte du ministre de France aux États-Unis – un véritable agent double.
Dès 1804, Richardson en était venu à la conclusion que la politique étrangère des États-Unis, dictée par la France, s’orientait vers une guerre contre la Grande-Bretagne et que le traité d’achat de la Louisiane contenait des clauses secrètes dans lesquelles la France avait promis une aide militaire aux États-Unis dans l’éventualité où ils attaqueraient le Canada. Ces opinions, transmises périodiquement au secrétaire civil Herman Witsius Ryland* et sans doute à d’autres fonctionnaires, contribuèrent probablement à faire régner au château Saint-Louis un pessimisme extrême quant à la sécurité de la colonie. Il semble qu’à compter de 1807 Richardson s’occupa moins de renseignements, bien qu’en 1809 il ait servi secrètement d’intermédiaire à John Henry*, espion employé par Craig pour étudier les possibilités que la Nouvelle-Angleterre se sépare du reste des États-Unis en cas de guerre. En 1810, sous ce qu’on a appelé le « règne de la terreur » de Craig, Richardson, tout à fait favorable à l’attitude du gouverneur, fut membre actif d’un comité, formé parmi les membres montréalais du Conseil exécutif, qui arrêta trois partisans du parti canadien accusés de trahison, interrogea de nombreux témoins et conclut, à partir de maigres preuves, qu’un complot napoléonien visant à « préparer l’opinion générale » à l’insurrection avait été éventé à la dernière minute.
Dans la décennie qui suivit sa retraite définitive de la politique électorale, Richardson consacra beaucoup d’attention aux problèmes des marchands du Bas-Canada. En mai 1810, il présida à Montréal un comité apparemment éphémère sur le commerce qui avait probablement été formé, comme celui de Québec l’année précédente [V. John Jones*], pour presser le gouvernement britannique d’améliorer les conditions du commerce et notamment d’assurer aux marchands une meilleure protection contre la concurrence américaine. De 1809 à 1812, il représenta les intérêts des marchands montréalais au sein d’un groupe de pression colonial qui persuada le Parlement britannique d’interdire l’importation, en provenance des États-Unis, de produits étrangers comme les cotonnades et le thé, mais qui ne parvint pas à empêcher les denrées américaines d’entrer aux Antilles. Par ailleurs – et cela menaçait davantage ses intérêts personnels –, les États-Unis affirmaient avec de plus en plus d’autorité que la traite des fourrures dans le Sud-Ouest était de leur ressort et intervenaient contre les marchands britanniques pour favoriser l’ascension de l’American Fur Company de John Jacob Astor. Victimes de tarifs élevés, de saisies, d’embargos et d’autres tentatives d’exclusion, les commerçants montréalais qui faisaient affaire dans le Sud-Ouest – Richardson et William McGillivray étant les principaux – s’étaient rassemblés en 1806 au sein de la Michilimackinac Company [V. John Ogilvy]. En 1810–1811, Richardson et McGillivray, se pliant aux circonstances, négocièrent une fusion avec Astor. Il en résulta en janvier 1811 une entente qui créait la South West Fur Company : Astor en possédait la moitié tandis que la Forsyth, Richardson and Company et la McTavish, McGillivrays and Company, regroupées sous le nom de Montréal Michilimackinac Company, détenaient l’autre moitié. Par la suite, la North West Company acheta le tiers des intérêts de la compagnie montréalaise. Ce furent les sociétés britanniques de la South West Fur Company qui, par l’intermédiaire de Richardson, apprirent en juin 1812 au gouverneur Prévost, commandant en chef des troupes britanniques, que les États-Unis avaient déclaré la guerre. Les commerçants britanniques et canadiens attendaient cette guerre depuis un bon moment : ils espéraient que la Grande-Bretagne pourrait reprendre pour de bon le Sud-Ouest, qu’elle avait abandonné au moment des traités de 1783 et de 1794 et dont elle avait retiré ses derniers soldats en 1796.
Durant la guerre, Richardson et McGillivray eurent une influence considérable sur les événements de l’Ouest. L’appui enthousiaste des représentants, des engagés et des Indiens qui vivaient de la traite avec leurs compagnies permit à une petite troupe britannique commandée par Charles Roberts* de prendre le fort Michillimakinac le 17 juillet 1812. Les deux hommes veillèrent personnellement à convaincre Prevost que la traite du Sud-Ouest avait une grande importance politique et économique et que stratégiquement, pour la maîtriser, il fallait tenir ce fort. Ce fut sur leur recommandation élogieuse et sur celle de James McGill que Prévost chargea le trafiquant et aventurier Robert Dickson de lever une troupe d’Indiens qui, en août 1814, aida Robert McDouall* à défendre le fort. Aussi les deux marchands furent-ils extrêmement attristés d’apprendre que les négociateurs de la paix avaient rendu Michillimakinac aux Américains et de voir que leur interprétation légaliste du traité de Gand – plaidoyer spécial en faveur d’un délai – n’était pas retenue. Mais il y eut pire encore. En 1816, le Congrès des États-Unis interdit aux étrangers de faire la traite avec les Indiens. L’année suivante, Richardson et ses collègues vendirent à Astor, à des conditions désavantageuses pour eux, leurs actions de la South West Fur Company et se retirèrent de la traite du Sud-Ouest.
Au Bas-Canada, durant la guerre, Richardson servit dans les Montreal Incorporated Volunteers et exerça ses fonctions courantes de conseiller exécutif. Ce fut avec consternation qu’il vit Prévost courtiser le parti canadien et négliger ceux qui avaient eu l’audience de Craig. En 1814, Prévost accepta avec réticence que l’Assemblée mette en accusation les juges en chef James Monk et Jonathan Sewell pour avoir, entre autres choses, publié un code de procédure « inconstitutionnel ». Même s’il était convaincu que la politique de conciliation menée par Prévost envers le parti canadien encourageait « les démagogues turbulents et révolutionnaires qui domin[aient] alors l’Assemblée », il empêcha que le gouverneur soit attaqué publiquement, comme le proposait Sewell. Un affrontement ouvert entre Prevost et son Conseil exécutif, qui en tant que Cour d’appel de la colonie appuyait les juges en chef, aurait, affirmait-il, « affaibli [les] moyens de défense [de la colonie...] même dans le domaine militaire ». Il préférait « remettre à un moment plus propice une mesure aussi extrême ». Richardson affirma également qu’il ne fallait pas accepter que l’Assemblée mette seulement les juges en chef en accusation, puisqu’ils avaient eu de l’aide lors de la rédaction de la procédure. « Cette histoire concerne tous les individus de tous les tribunaux, avançait-il. Tenons-nous ou tombons ensemble ! » Enfin, Sewell devait renoncer à user de motifs légalistes pour éviter une audience devant le Conseil privé de Londres ; le meilleur espoir d’assurer la sécurité de la colonie résidait plutôt dans l’exploitation de « l’intempérance de ces anarchistes » du parti canadien. En montrant leur « pied fourchu », Sewell forcerait probablement les ministres à les réprimer en « éliminant de la constitution la partie qui garantissait une Assemblée élue », escomptait-il. L’avis de Richardson sur ces questions et d’autres fut suivi ; Sewell et Monk furent acquittés, même si le Parlement britannique n’entreprit aucune répression constitutionnelle.
La tradition a attribué à Richardson une fameuse série de lettres signées Veritas, qui parurent dans le Montreal Herald d’avril à juin 1815 et qui furent reprises sous forme de pamphlet. Elles attaquaient sans merci la personne de Prevost et sa compétence de général ; l’une d’elles le décrivait comme un officier qui avait « l’extraordinaire malchance de ne jamais tenter une offensive ou de n’y penser que lorsque le moment propice était passé ». Même s’il est plausible que Veritas ait été Richardson – d’autant plus que ces lettres furent publiées tout juste après la guerre –, il existe peu de preuves directes, si ce n’est le souvenir, 58 ans plus tard, d’un homme qui avait été en 1815 commis de la Forsyth, Richardson and Company. En fait, Prevost soupçonna le solliciteur général Stephen Sewell d’être l’auteur de ces lettres.
Après le conflit, les intérêts commerciaux de Richardson subirent une transformation. Déjà moins actif qu’auparavant dans le commerce des fourrures, il le devint moins encore à compter de la fusion de la Hudson’s Bay Company et de la North West Company en 1821. Jusque-là, il avait joué un rôle de premier plan dans la défense des intérêts de la North West Company contre la colonie que lord Selkirk [Douglas*] avait établie et tenté de maintenir à la rivière Rouge. La Forsyth, Richardson and Company intensifia ses exportations de produits de base plus nouveaux tels les céréales et le bois, tout en veillant à faire le plus de commerce possible dans le Haut-Canada, comme le démontre le rôle fondamental de Richardson dans la construction du canal de Lachine. Favorable depuis longtemps à une voie de ce genre, il fut élu le 26 juillet 1819 président d’un comité chargé par la nouvelle Compagnie des propriétaires du canal de Lachine [V. François Desrivières] d’en surveiller le creusage. Celle-ci ne tarda pas à connaître des difficultés et, en 1821, le Parlement de la colonie reprit l’actif de la compagnie et nomma une commission pour mener le projet à terme. Le 17 juillet, après que Richardson, à titre de président de cette commission, eut soulevé la première pelletée de terre, les travaux commencèrent. Lorsque le Parlement cessa momentanément de financer le projet, la Banque de Montréal consentit des avances sur la garantie personnelle de Richardson et de George Garden. Le canal fut pour ainsi dire terminé en 1825.
Richardson et ses associés continuaient à faire pression au nom des cercles d’affaires. En août 1821, une assemblée de marchands montréalais, menacés de ruine par l’« état de dépression et de crise » qui régnait, nommèrent Richardson pour les représenter à un comité qui devait travailler à faire lever toute restriction à l’entrée de la farine et du blé bas-canadiens sur les marchés britannique et antillais. L’année suivante, à Montréal, il présida la réunion de fondation du Committee of Trade, successeur du comité de 1810 ; Thomas Blackwood* fut élu président de l’organisme. En 1823–1824, la Forsyth, Richardson and Company figurait en tête de la liste des maisons de commerce qui obtinrent une réduction de l’accise sur le tabac exporté en Grande-Bretagne par le Haut-Canada. Grâce à John Inglis, associé de la compagnie que dirigeait Edward Ellice à Londres et membre du conseil d’administration de l’East India Company, elle eut à compter de 1824 le monopole de la vente des thés de l’East India Company au Canada, marché lucratif qu’elle conserva jusqu’après la mort de Richardson. En outre, au cours de cette période, Richardson fut, à titre de représentant d’Ellice à Montréal, très occupé à surveiller la gestion d’une immense seigneurie en plein essor, celle de Villechauve, communément appelée Beauharnois. Il fit des pieds et des mains pour qu’Ellice ait le droit, en vertu du Canada Trade Act, d’appliquer dans la seigneurie le régime de la franche-tenure, ce que le Conseil exécutif refusa en 1823 pour des raisons légales ; Ellice lui-même obtint plus tard cette autorisation en invoquant le Canada Tenures Act de 1825. Enfin, il faut ajouter aux nombreuses activités commerciales de Richardson dans les années d’après-guerre son entrée au conseil d’administration de la Compagnie d’assurance de Montréal contre les accidents du feu, au début des années 1820.
C’étaient cependant les finances qui, plus que tout, absorbaient Richardson. En 1817, aiguillonnés par le succès des billets de l’année durant la guerre [V. James Green], neuf marchands, dont Richardson, signèrent les articles d’association et invitèrent la population à souscrire le capital-actions de la Banque de Montréal, première banque permanente de l’Amérique du Nord britannique et ancêtre du réseau des banques privilégiées au Canada. Richardson en était l’inspirateur. Les partisans de la banque citaient abondamment son discours de 1808 ; il fut président du comité fondateur, et les articles d’association, largement inspirés de la charte de la First Bank of the United States, reflétaient ses idées. Même s’il ne siégea jamais au conseil d’administration, il s’intéressa de près aux affaires de cet établissement jusqu’à la fin de sa vie, à titre d’actionnaire. Ce fut sur ses instances que l’on décora la façade du premier édifice de la banque, construit rue Saint-Jacques en 1819, de quatre très belles plaques de terre cuite venant de chez Coade à Londres et représentant l’agriculture, les arts et métiers, le commerce et la navigation. La même année, il se rendit lui-même au ministère des Colonies pour obtenir l’assentiment royal à la constitution de la banque, qui fut finalement accordé en 1822. Il fut élu à l’unanimité président de la très importante assemblée des actionnaires du 5 juin 1826, au cours de laquelle éclata l’affrontement qui se dessinait depuis quelque temps entre de jeunes membres du conseil d’administration, menés par George Moffatt*, et la vieille garde des marchands de fourrures, soit Richardson lui-même, Forsyth et Samuel Gerrard*, président de la banque. Gerrard fut démis de la présidence mais Richardson, qui détenait la plus grosse tranche d’actions avec droit de vote et le plus grand nombre de procurations, parvint à lui épargner une plus grande humiliation et à lui conserver un siège d’administrateur, préservant ainsi l’unité de la banque. De plus, Richardson siégea au conseil d’administration de la Banque d’épargne de Montréal. En 1826, la Forsyth, Richardson and Company se vit confier, en qualité d’agent financier, le mandat de gérer les fonds excédentaires du receveur général du Haut-Canada. Elle s’acquitta de sa tâche avec intégrité et profit jusque dans les années 1840.
En 1816, après avoir refusé à plusieurs reprises de le faire, Richardson entra au Conseil législatif, où il devait défendre avec constance et acharnement toutes les causes des marchands et des conservateurs. En 1821, il convainquit le conseil d’adopter une série de résolutions provocantes qui allaient bien au delà des prétentions de la chambre des Lords en matière de finances publiques et qui tentaient de dicter à l’Assemblée la forme de ses projets de loi de subsides. L’année suivante, dans un discours au conseil, il laissa entendre qu’un noyau secret du parti canadien, émule du Comité de salut public de la France révolutionnaire, s’apprêtait peut-être à déposer le gouverneur lord Dalhousie. L’Assemblée exigea que le conseil le blâme et que le gouverneur le démette de ses fonctions, ce qui fut refusé au nom de la liberté des débats au conseil. Tout au long des années 1820, il dirigea les conseillers – ordinairement majoritaires – qui refusaient catégoriquement que l’Assemblée, comme elle prétendait en avoir le droit, procède à l’affectation des revenus de la couronne. Cependant, il fut presque seul à protester lorsque, en 1825, le conseil approuva une loi de subsides négociée avec l’Assemblée par le lieutenant-gouverneur Francis Nathaniel Burton et il se trouva à la tête d’une minorité de conseillers lorsqu’il attaqua, en 1829, une loi semblable, mise au point par le gouverneur sir James Kempt.
Richardson s’intéressa particulièrement, en 1822, à une proposition d’union du Haut et du Bas-Canada. En qualité de doyen incontesté des hommes d’affaires de la colonie, il présida à Montréal une assemblée publique en faveur de l’Union et y prononça un long discours. Outre qu’elle résoudrait le vieux litige concernant le partage des droits de douane entre les deux provinces, affirmait-il, l’Union permettrait aux marchands bas-canadiens de ne plus être assujettis à la majorité canadienne de l’Assemblée, « toujours mal disposée envers le commerce ». Avec son franc-parler habituel, il fit valoir à ses nombreux auditeurs que la question fondamentale était de savoir si eux-mêmes et leurs descendants « deviendr[aient] étrangers sur une terre britannique » ou si « les habitants d’origine étrangère [...] deviendr[aient] britanniques », solution qui ne pourrait qu’avantager grandement les Canadiens. Sous la direction de Richardson, six membres du Conseil législatif protestèrent lorsque, le 23 janvier 1823, celui-ci résolut de s’opposer à l’Union. Ce soir-là, il communiqua par écrit à Edward Ellice de quoi attaquer Louis-Joseph Papineau* et John Neilson*, que le parti canadien venait de dépêcher à Londres pour combattre le projet d’union. Il souligna, par exemple, que Papineau avait la faiblesse de s’estimer lui-même jusqu’à l’outrecuidance, que Neilson était tellement « républicain » qu’il avait dû un jour se réfugier aux États-Unis et que le parti canadien avait même envisagé de choisir comme délégué Pierre-Stanislas Bédard, emprisonné en 1810 par Craig pour « pratiques traîtresses ». Cependant, en dépit de tous leurs efforts, Richardson et Ellice perdirent la partie : le projet d’union fut abandonné à cause de l’opposition massive des Canadiens.
Richardson contribua grandement à la vie de la communauté. Il fut membre fondateur de la section montréalaise de la Société d’agriculture en 1790. Entre 1793 et 1828, il fut régulièrement affecté, à titre de commissaire du Bas-Canada, à la négociation des droits de douane avec le Haut-Canada. En 1799, il fut nommé trésorier en vue de la construction d’un nouveau palais de justice à Montréal et joua un rôle de premier plan dans la collecte organisée pour soutenir l’effort de guerre de l’Empire. De 1802 à 1807, il fit partie de commissions chargées de différents mandats : démolir les fortifications croulantes de la ville et dessiner les plans de nouvelles rues ; construire une prison et une halle ; améliorer et réparer la route entre Montréal et Lachine ; ériger un monument à lord Nelson. En 1815, il présida une commission qui recueillit des dons pour les familles des soldats tués ou blessés à Waterloo. En 1827, il fut l’un des grands porte-parole de la campagne de souscription en faveur de la construction, à Québec, d’un monument à la mémoire de James Wolfe* et de Louis-Joseph de Montcalm*. En 1818, il devint membre du conseil d’administration de l’Institution royale pour l’avancement des sciences [V. Joseph Langley Mills]. Il fut l’un des maîtres d’œuvre du Montréal General Hospital, fondé en 1819 [V. William Caldwell, 1782–1833], aida l’établissement à se constituer un fonds de lancement et en fut le premier président après sa reconnaissance juridique en 1823. Parmi les nombreuses successions embrouillées qu’il aida à régler figure celle de James McGill, tâche lourde et ingrate si ce n’est qu’elle déboucha sur la création d’une université dans sa ville bien-aimée [V. François Desrivières].
Malgré sa fatigue, Richardson fut à son poste durant la session législative de 1831. Il protesta contre la conciliation des whigs, lutta contre les manœuvres déployées par Papineau pour que le parti patriote, comme s’appelait alors le parti canadien, domine l’Assemblée et s’inquiéta des changements d’orientation qui s’annonçaient au Conseil législatif, dont il devint président le 4 février. Il s’opposa en vain à l’érection de Montréal en municipalité, car il craignait que la ville, gouvernée jusque-là par des juges de paix nommés, ne tombe aux mains du parti patriote si ses administrateurs étaient élus. Il écrivit à Ellice que les Canadiens étaient des « enfants gâtés » qui, après avoir été libérés par la Conquête britannique, tentaient de reprendre l’avantage sur leurs « émancipateurs trop généreux ». Il soulignait que « trop de capitaux britanniques [... étaient] enjeu pour que leur administration soit laissée à une Assemblée canadienne » et il était scandalisé que le pays qui avait dicté sa « loi à l’Europe » puisse « recevoir des ordres des descendants des Français ». Il fallait que le Parlement intervienne pour écraser Papineau et ses amis. À la fin de la session, Richardson présenta des propositions visant à empêcher l’Assemblée d’obtenir l’abrogation du Canada Tenures Act. Selon un conseiller exécutif qui l’appuyait, Andrew William Cochran*, il fut « profondément blessé par la désertion ou l’appui glacial » de ses anciens alliés : « Au milieu des infidèles, lui seul demeur[ait] fidèle. » De retour chez lui, il prit le lit, comme le raconta Cochran, se plaignit de la trahison de ses amis politiques de naguère et sembla « perdre espoir et intérêt en la vie ».
John Richardson mourut le 18 mai 1831. Au port, les pavillons des navires furent mis en berne jusqu’aux obsèques nationales, à la Christ Church, où une plaque fut consacrée à sa mémoire. Les journaux anglophones rappelèrent abondamment, avec raison, qu’il s’était révélé un homme intègre en matière financière et politique et qu’il avait été l’un des grands bâtisseurs de la ville. Une nouvelle aile du Montreal General Hospital, construite l’année suivante, fut baptisée en son honneur. Même après sa mort, Richardson continua à soulever les passions. Papineau refusa ouvertement d’assister aux funérailles. Le Canadien et la Minerve soulignèrent à leurs lecteurs que Richardson avait dirigé dans le Bas-Canada le parti connu sous l’épithète de tory en Angleterre et d’ultra-royaliste en France, qui niait au peuple ses droits légitimes et dont les excès avaient, peu de temps auparavant, plongé l’Europe entière dans la guerre et la révolution.
Les intérêts de John Richardson s’étendaient bien au delà du commerce et de la politique coloniale. Comme l’ensemble de l’élite britannique de Montréal, il avait un sens esthétique évident. Le chirurgien militaire John Jeremiah Bigsby* notait qu’« à une soirée donnée chez M. Richardson le couvert et la table étaient remarquables, la tenue, les manières et la conversation des convives, d’un goût excellent ». Son insatiable curiosité le mena à la présidence de la Société d’histoire naturelle de Montréal, fondée en 1827. Il connaissait fort bien l’histoire ancienne et moderne, le droit, l’économie et la poésie anglaise. Les nombreux commentaires sur la politique britannique, américaine et européenne que l’on trouve dans ses lettres sont en général perspicaces, quoiqu’assez alarmistes. Parmi les économistes, il aimait surtout Adam Smith ; toutefois, il n’adhérait pas sans réserve à la doctrine du laisser-faire, comme l’indiquent la place qu’il laissait à la participation gouvernementale dans son projet de banque en 1808 et ses pressions continuelles en faveur de l’assistance de l’État. Byron était son poète favori, mais il ne l’admirait pas en tant qu’homme et n’approuvait pas ses positions politiques. Ses opinions constitutionnelles sur le Bas-Canada s’inspiraient directement d’Edmund Burke, mais en 1831 il estimait qu’une réforme modérée du Parlement se justifiait, paradoxe apparent qu’Edward Ellice et lord Durham [Lambton*] auraient bien compris. À l’instar de bon nombre d’Écossais de l’élite montréalaise, il était membre de la congrégation de l’Église presbytérienne ainsi que de celle de l’Église d’Angleterre et il se montra généreux envers l’une et l’autre. Il avait beaucoup de cette « dignité et [de cette] distance » qu’il admirait tant chez Craig et qui allaient bien avec sa très grande taille et son port majestueux. Il souhaitait vivre selon des principes, et cela le poussait souvent à une rigidité excessive. Même s’il avait parfois tendance à définir lui-même les intérêts de tous ses coéquipiers, il était remarquablement doué pour le travail d’équipe, ce qui lui donnait une énergie surabondante et engendrait des loyautés féroces et souvent désintéressées. Malheureusement, ceux qui s’opposaient à son groupe, et particulièrement les Canadiens, dont la volonté de survivre demeurait pour lui un mystère, dont il ne pouvait accepter la forme de loyauté à l’Empire, devinrent pour lui des ennemis, et il ne se cacha pas pour dire ce qu’il pensait. Richardson fit beaucoup de bien mais aussi beaucoup de mal.
John Richardson est peut-être l’auteur de : The letters of Veritas, re-published from the Montreal Herald ; containing a succinct narrative of the military administration of Sir George Prevost, during his command in the Canadas [...] (Montréal, 1815).
APC, MG 11, [CO 421 Q, 86–87 ; 107–109 ; 118 ; 132 ; 157 ; 161 ; 166 ; 168 ; 293 ; MG 23, GII, 10, vol. 3 ; 5 ; 17, sér. 1, 3 ; 9–10 ; 13–14 ; 16 ; GIII, 7 (transcriptions) ; RG 1, E1 : 29–36 ; RG 4, A1 : 10262–44628 ; vol. 141–147 ; RG 7, G1, 3 : 259–269 ; 13 : 42 ; RG 68, General index, 1651–1841.— AUM, P 58, U, Richardson à Grant, 16 août, 25 oct. 1819 ; Richardson à Gerrard, 22 avril 1828 ; Richardson et Gregory à McIntosh, 18 oct. 1830.— NLS, Dept. of mss, mss 15113–15115, 15126, 15139 (mfm aux APC).— PRO, CO 42/127.— SRO, GD45/3 (mfm aux APC).— « A British privateer in the American Révolution », H. R. Howland, édit., American Hist. Rev. (New York), 7 (1901–1902) : 286–303.— « L’Association loyale de Montréal », ANQ Rapport, 1948–1949 : 257–273.— B.-C., chambre d’Assemblée, Journaux ; 1792–1815 ; Conseil législatif, Journaux, 1816–1831 ; Statuts, 1793–1831.— L. A. [Call Whitworth-Aylmer, baronne] Aylmer, « Recollections of Canada, 1831 », ANQ Rapport, 1934–1935 : 305.— Corr. of Lieut. Governor Simcoe (Cruikshank).— « Courts of justice for the Indian country », APC Report, 1892 : 136–146.— Doc. relatifs à l’hist. constitutionnelle, 1759–1791 (Shortt et Doughty ; 1921) ; 1791–1818 (Doughty et McArthur) ; 1819–1828 (Doughty et Story).— Douglas, Lord Selkirk’s diary (White).— Mackenzie, Journals and letters (Lamb).— L.-J. Papineau, « Correspondance de Louis-Joseph Papineau (1820–1839) », Fernand Ouellet, édit., ANQ Rapport, 1953–1955 : 191–442.— Reports of cases argued and determined in the courts of King’s Bench and in the provincial Court of Appeals of Lower Canada, with a few of the more important cases in the Court of Vice Admiralty [...], G. O. Stuart, compil. (Québec, 1834).— John Richardson, « The John Richardson letters », E. A. Cruikshank, édit., OH, 6 (1905) : 20–36.— Le Canadien, 1806–1810, 28 mai 1831.— La Gazette de Québec, 7 août 1788, 26 mai 1791, 21 juin 1792, 21 févr. 1793, 17 juill., 11, 25 déc. 1794, 5 nov. 1801, 31 mars 1803, 5 juill., 27 déc. 1804, 14 nov. 1805, 2 janv., 23 oct. 1806, 2, 9 juill., 12 nov. 1807, 3 mars, 12 mai, 1er sept., 24 nov., 22 déc. 1808, 1er juin, 6 juill., 30 nov., 14 déc. 1809, 4 janv., 8, 29 mars, 12 avril, 17 mai 1810, 18, 25 avril, 16 mai, 27 juin, 18 juill. 1811, 28 mai 1812, 28 mai, 2 sept. 1813, 11, 25 juill., 28 nov. 1816, 9 janv., 22 mai, 26 juin, 2 oct. 1817, 29 janv. 1818, 18 févr., 14 juin, 5 août 1819, 6 janv., 27 avril 1820, 12 avril, 18 juin, 25 juill., 27 août, 22 oct. 1821, 27 nov. 1823.— La Minerve, 21 févr., 6, 9 juin 1831.— Montreal Gazette, 1787–1815, 1821–1822, 28 mai, 4, 11 juin 1831.— Montreal Herald, 1811–1815.— Quebec Mercury, 2 févr. 1805, 2 mai 1808.— Almanach de Québec, 1791 : 84 ; 1796 : 83.— Roll of alumni in arts of the University and King’s College of Aberdeen, 1596–1860, P. J. Anderson, édit. (Aberdeen, Écosse, 1900).— F. D. Adams, A history of Christ Church Cathedral, Montreal (Montréal, 1941).— F.-J. Audet, les Députés de Montréal.— A. L. Burt, The United States, Great Britain and British North America from the revolution to the establishment of peace after the War of 1812 (Toronto et New Haven, Conn., 1940).— R. Campbell, Hist. of Scotch Presbyterian Church.— Christie, Hist. of L.C. (1848–1855), 1–3.— D. [G.] Creighton, The empire of the St Lawrence (Toronto, 1956).— G. C. Davidson, The North West Company (Berkeley, Calif., 1918 ; réimpr., New York, 1967).— Denison, Canada’s first bank.— F. M. Greenwood, « The development of a garrison mentality among the English in Lower Canada, 1793–1811 » (thèse de ph.d., Univ. of B.C., Vancouver, 1970).— Hochelaga depicta [...], Newton Bosworth, édit. (Montréal, 1839 ; réimpr., Toronto, 1974).— Innis, Fur trade in Canada (1970).— H. E. MacDermot, A history of the Montreal General Hospital (Montréal, 1950).— R. C. McIvor, Canadian monetary, banking and fiscal development (Toronto, 1958).— Ouellet, Hist. économique ; Lower Canada.— R. A. Pendergast, « The XY Company, 1798–1804 » (thèse de ph.d., univ. d’Ottawa, 1957).— K. W. Porter, John Jacob Astor, business man (2 vol., Cambridge, Mass., 1931 ; réimpr., New York, 1966).— Robert Rumilly, la Compagnie du Nord-Ouest, une épopée montréalaise (2 vol., Montréal, 1980) ; Histoire de Montréal (5 vol., Montréal, 1970–1974), 2.— Taft Manning, Revolt of French Canada.— Tulchinsky, « Construction of first Lachine Canal ».— M. S. Wade, Mackenzie of Canada : the life and adventures of Alexander Mackenzie, discoverer (Édimbourg et Londres, 1927).— J.-P. Wallot, Intrigues françaises et américaines au Canada, 1800–1802 (Montréal, 1965).— M. [E.] Wilkins Campbell, McGillivray, lord of the northwest (Toronto, 1962) ; NWC (1973).— R. H. Fleming, « The origin of Sir Alexander Mackenzie and Company », CHR, 9 (1928) : 137–155 ; « Phyn, Ellice and Company of Schenectady », Contributions to Canadian Economics (Toronto), 4 (1932) : 7–41.— J. W. Pratt, « Fur trade strategy and the American left flank in the War of 1812 », American Hist. Rev. (New York), 40 (1935) : 246–273.— Henry Scadding, « Some Canadian noms-de-plume identified ; with samples of the writing to which they are appended », Canadian Journal (Toronto), nouv. sér., 15 (1876–1878) : 332–341.— Adam Shortt, « The Hon. John Richardson », Canadian Bankers’ Assoc., Journal (Toronto), 29 (1921–1922) : 17–27.— W. S. Wallace, « Forsyth, Richardson and Company in the fur trade », SRC Mémoires, 3e sér., 34 (1940), sect. ii : 187–194.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
F. Murray Greenwood, « RICHARDSON, JOHN (mort en 1831) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 14 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/richardson_john_1831_6F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/richardson_john_1831_6F.html |
| Auteur de l'article: | F. Murray Greenwood |
| Titre de l'article: | RICHARDSON, JOHN (mort en 1831) |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1987 |
| Année de la révision: | 1987 |
| Date de consultation: | 14 déc. 2025 |