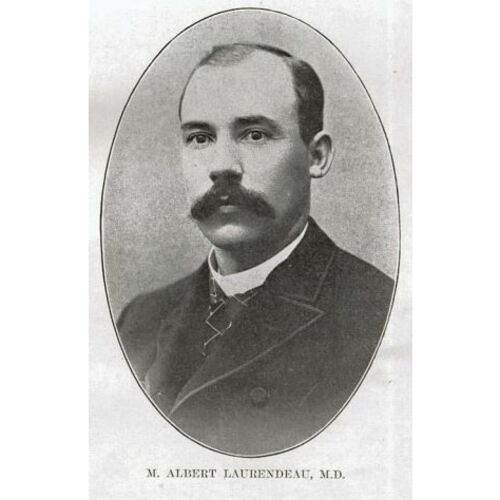Provenance : Lien
LAURENDEAU, ALBERT (baptisé Joseph-Olivier-Albert), médecin, homme politique et auteur, né le 1er mars 1857 à Saint-Gabriel-de-Brandon, Bas-Canada, fils aîné du docteur Joseph-Olivier Laurendeau et de Céline Dostaler ; le 23 septembre 1879, il épousa à Napierville, Québec, Marie-Georgianna Mérizzi ; décédé le 19 août 1920 à Saint-Gabriel-de-Brandon.
Fils d’un éminent généraliste de Saint-Gabriel-de-Brandon, au nord-est de Joliette, Albert Laurendeau fréquenta d’abord l’école du village, puis entra en 1872 à l’école normale Jacques-Cartier à Montréal. Une fois son diplôme obtenu, il étudia à l’école de médecine et de chirurgie de Montréal, alors affiliée au Victoria College de Cobourg, en Ontario. Diplômé et marié en 1879, il commença à pratiquer la médecine avec son père. Quatre enfants naîtraient de son mariage, trois filles et un garçon, Aldéric, qui opterait lui aussi pour la médecine.
Citoyen dévoué, Laurendeau fut maire de Saint-Gabriel-de-Brandon de 1889 à 1892. Naturellement, il consacra surtout sa vie aux malades et à la promotion de la santé publique. On le disait toujours disposé à soigner ses clients chez eux, à donner des leçons d’hygiène aux écoliers et à prôner la tempérance. Il conçut au moins un instrument de médecine, expérimenta divers traitements pour des maladies courantes et décrivit souvent ces innovations soit dans des rencontres professionnelles, soit dans les pages de deux périodiques montréalais, la Clinique et l’Union médicale du Canada. Il s’enorgueillirait particulièrement de n’avoir perdu que 12 des quelque 500 malades qu’il traita dans sa région pendant l’épidémie de grippe espagnole en 1918–1919.
La pratique de la médecine ne prenait pas tout le temps ni toute l’énergie de Laurendeau et ne satisfaisait pas complètement sa curiosité intellectuelle. En outre, elle ne lui rapportait pas assez pour subvenir aux besoins de sa famille. À divers moments de sa vie, comme d’autres médecins de la province de Québec, il fit des affaires – en l’occurrence des opérations bancaires d’escompte et la promotion de la fabrication de fibre de bois et de potasse. Une concurrence féroce et des honoraires insuffisants l’obligeaient à mener ce qu’il appelait, comme Darwin, cette « lutte pour la vie ». Une solution, adoptée par la Société médicale du district de Joliette en 1913, était l’uniformisation des honoraires : 1 ou 2 $ pour une visite à domicile, de 5 à 10 $ pour la réduction d’une fracture simple, de 40 à 60 $ pour une appendicectomie. Avec l’augmentation des revenus viendrait le prestige. « Le médecin doit occuper une position élevée dans la hiérarchie sociale, disait Laurendeau, et il ne peut tenir son rang, commander la confiance, le respect du public, sans avoir des revenus convenables. »
La hausse des honoraires n’était qu’un aspect des propositions de Laurendeau pour une réforme de la profession médicale au Québec. Selon lui, la province avait trop de médecins, sans compter la ribambelle des ramancheurs, guérisseurs et autres « charlatans ». Il préconisait surtout des règlements plus serrés sur l’émission des permis d’exercice, l’application rigoureuse de l’éthique médicale contre les médecins qui, par exemple, vendaient de l’alcool à des fins autres que thérapeutiques, et des normes strictes de formation. Son but, expliqua-t-il en 1910, était de « relever la qualité et d’abaisser la quantité des disciples d’Hypocrate dans [la] province ». La professionnalisation exigeait de l’organisation. Après la première assemblée de l’Association des médecins de langue française de l’Amérique du Nord, tenue à Québec en 1902, Laurendeau avait pris, en 1903, l’initiative de fonder la Société médicale du district de Joliette, dont il fut secrétaire-trésorier. Presque sans interruption de 1904 à 1920, il fut élu au conseil d’administration du Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec, dont il devint vice-président en 1918. À titre de président du comité législatif du collège, il exerça des pressions en faveur de l’adoption d’une nouvelle loi médicale en 1909. Celle-ci augmentait l’autonomie du collège et en étendait les attributions. En outre, elle standardisait les exigences d’admission et les programmes des facultés de médecine au Québec. Bien qu’il ait souhaité une collaboration étroite entre les associations provinciales de médecins du Canada et l’établissement d’un ministère fédéral de la Santé, Laurendeau insistait pour que la Société médicale de Québec conserve son autonomie. « [Nous devons, disait-il, pouvoir] garder intact notre langue, nos usages et coutumes, notre organisation nationale, nos droits en un mot. »
Même après la réforme des programmes en 1909, les écoles de médecine de la province de Québec donnaient plus de place aux études classiques qu’aux études scientifiques. Laurendeau jugeait nécessaire une réorientation radicale. À son avis, l’ensemble du réseau d’enseignement francophone avait pour principale faiblesse de compter trop de collèges classiques et pas assez de collèges techniques, agricoles, industriels et commerciaux. Pire encore, d’après lui, le système n’enseignait pas « [aux] jeunes gens les principes généraux des sciences positives et naturelles – en s’appuyant uniquement sur les procédés et les faits naturels guidée par la raison ». Aux yeux de Laurendeau, la science était la clé de l’avenir de l’humanité et, pour le Québec, une condition essentielle pour survivre dans le monde moderne.
Les conceptions scientifiques de Laurendeau s’étaient formées par des lectures très variées sur les sciences naturelles de la fin du
Malgré son érudition, la Vie était un écrit polémique. Il révélait d’ailleurs une compréhension primaire de la science darwinienne et de sa différence essentielle avec le « transformisme » graduel de Lamarck. Même si Laurendeau avait reçu la permission d’y reproduire ses échanges antérieurs avec l’évêque, il savait sûrement qu’Archambeault réagirait mal à sa tentative de séparer science et religion. S’il espérait que l’évêque poursuivrait le débat, il sous-estimait gravement son adversaire. Pour Archambeault, il n’était plus temps de discuter, mais d’agir.
En mars 1912, l’évêque émit une circulaire condamnant la Vie et interdisant aux laïques de le lire. Dans le journal l’Étoile du Nord, il dénonça sans ambiguïté les erreurs théologiques et philosophiques du livre, la conception fautive de la liberté et de l’intelligence humaines, le refus d’accepter « l’autorité de l’Église en matière scientifique » et les « éloges exagérés des savants et des philosophes athées et matérialistes ». Il exigea de Laurendeau une rétractation. Durant près d’un an, le médecin tint bon, au risque de se voir interdire les sacrements, y compris une sépulture catholique. Finalement, sans doute sous les pressions de son entourage et de sa famille – un de ses frères était jésuite –, il admit ses erreurs et résolut de ne plus écrire. Il espérait que sa décision ne serait pas rendue publique, mais l’évêque proclama sa victoire dans l’Étoile du Nord.
Pendant six ans, Laurendeau se conforma aux volontés de son évêque, sans pour autant renoncer à ses convictions. En 1918, cinq ans après la mort d’Archambeault, il réaffirma publiquement sa foi dans le naturalisme scientifique en admettant qu’il restait « un trouble-fête ». En laissant entendre qu’on ne lui avait jamais vraiment donné l’occasion d’exposer ses vues, il expliqua ses convictions évolutionnistes aux lecteurs de la Clinique et leur dit avoir la certitude que, sans la liberté de pensée, la science véritable ne fleurirait jamais au Québec ; « nous en sommes encore en l’âge médiéval », concluait-il. Le débat qui suivit fut bref. Apparemment, les autorités ecclésiastiques préféraient le silence à une autre controverse.
Les dernières années d’Albert Laurendeau furent paisibles, bien que, comme toujours, il ait été extrêmement occupé, à la fois par ses hautes fonctions dans des associations professionnelles et par l’épidémie de grippe espagnole. Le surmenage pourrait avoir été l’une des causes de la crise cardiaque qui le tua pendant qu’il revenait en automobile d’une visite chez un patient. Son frère Fortunat célébra le service funèbre en l’église paroissiale de Saint-Gabriel-de-Brandon. Ces mots de son collègue le docteur Joseph Gaudreau résument bien sa vie active et souvent tumultueuse : « son originalité consistait surtout à n’être pas souvent de l’avis de tout le monde ».
Le père François Lanoue nous a généreusement donné accès à la correspondance entre Mgr Joseph-Alfred Archambeault et Albert Laurendeau, qui est conservée dans les Arch. de l’évêché de Joliette (Joliette, Québec). Nous tenons à le remercier ainsi que Xavier Gélinas, qui a effectué pour nous des recherches indispensables.
Laurendeau est l’auteur de l’Avenir de la médecine ([Québec ?], 1908), la Vie : considérations biologiques (Saint-Gabriel-de-Brandon, Québec, 1911) ainsi que de nombreux articles publiés dans la Clinique (Montréal), nouv. sér., 1 (1910–1911)–10 (1919–1920) et l’Union médicale du Canada (Montréal), 39 (1910)–48 (1919). À sa mort, des notices nécrologiques ont paru dans le Devoir, 20 août 1920, la Presse, 20 août 1920, l’Étoile du Nord (Joliette), 20 août 1920, la Clinique, nouv. sér., 11 (1920–1921) : 93s. et l’Union médicale du Canada, 49 (1920) : 461–463. [r. c.]
ANQ-M, CE4-6, 23 sept. 1879 ; CE5-23, 3 mars 1857.— Carl Berger, Science, God, and nature in Victorian Canada (Toronto, 1983).— Luc Chartrand et al., Histoire des sciences au Québec (Montréal, 1987).— Denis Goulet et André Paradis, Trois siècles d’histoire médicale au Québec ; chronologie des institutions et des pratiques (1639–1939) (Montréal, 1992).— François Jacob, la Logique du vivant : une histoire de l’hérédité ([Paris], 1970).— Ernst Mayr, One long argument : Charles Darwin and the genesis of modern evolutionary thought (Cambridge, Mass., 1991).
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Ramsay Cook, « LAURENDEAU, ALBERT (baptisé Joseph-Olivier-Albert) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 mars 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/laurendeau_albert_14F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/laurendeau_albert_14F.html |
| Auteur de l'article: | Ramsay Cook |
| Titre de l'article: | LAURENDEAU, ALBERT (baptisé Joseph-Olivier-Albert) |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1998 |
| Année de la révision: | 1998 |
| Date de consultation: | 1 mars 2026 |