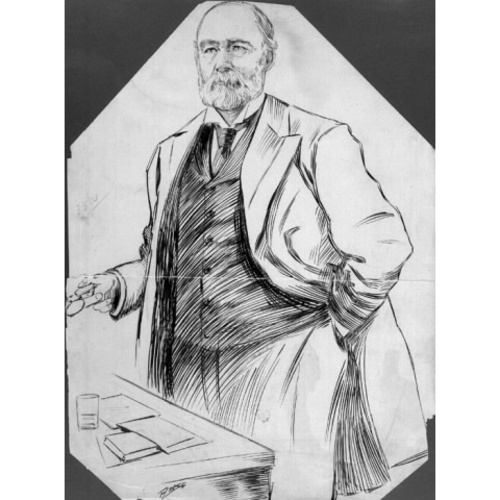Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3623466
ROSS, sir GEORGE WILLIAM, instituteur, fonctionnaire et homme politique, né le 18 septembre 1841 près de Nairn, comté de Middlesex, Haut-Canada, fils de James Ross et d’Ellen McKinnon ; en 1862, il épousa Christina Campbell (décédée en 1872), et ils eurent trois filles et deux fils, puis le 17 novembre 1875, dans le canton de Lobo, Ontario, Catherine Boston (décédée en 1902), et de ce second mariage naquirent un fils et trois filles, et enfin, le 8 mai 1907, à Toronto, Mildred Margaret Peel ; décédé dans cette ville le 7 mars 1914.
En 1831, James Ross, cordonnier à Tain, en Écosse, immigra dans le Haut-Canada avec sa femme, leurs quatre enfants et deux nièces. Il acheta, dans le comté de Middlesex, une terre dans le futur canton d’East Williams. Né en 1841, troisième garçon de la famille, George William Ross sentit peut-être que la réussite de son père était trop modeste pour les avantager, lui et ses sept frères et sœurs. Ou alors, connaissant les épreuves de la vie de fermier en région pionnière, il conclut peut-être que l’agriculture n’était pas son domaine. Dans son adolescence, il quitta sa famille pour étudier et enseigner.
Après avoir obtenu un brevet d’enseignement de troisième classe en 1857, Ross devint instituteur à l’école de rondins où il avait été élève. Deux ans plus tard, il décrocha un brevet de deuxième classe. En 1866, il organisa une « croisade publique » (l’expression est de lui) contre le système des surintendants locaux. Estimant que ce système encourageait les surintendants à être laxistes dans leurs visites scolaires et leurs avis aux instituteurs, il préconisait plutôt une surintendance de comté. En 1867, il quitta l’enseignement et acheta, de William Fisher Luxton*, l’Age de Strathroy. Subsistant pauvrement, il vendit ce journal en 1868 ou en 1869 et acheta une part de l’Expositor de Seaforth, qu’il conserva moins longtemps encore. Nommé surintendant des écoles du canton d’East Williams en 1868, il entra à la Toronto Normal School l’année suivante. Après l’obtention d’un brevet provincial de première classe en 1871, il fut nommé inspecteur de l’est du comté de Lambton. En outre, à compter du début des années 1870, il étudia le droit ; en 1883, l’Albert College de Belleville lui décernerait une licence dans cette discipline.
De 1876 à 1880, Ross appartint au comité central des examinateurs du département de l’Éducation. Ce comité avait été créé pour décerner des brevets aux professeurs, mais Adam Crooks*, le premier des ministres de l’Éducation de l’Ontario, lui avait confié par la suite des fonctions d’administration et d’orientation. Ross présida le sous-comité des écoles modèles, eut la charge de ces établissements à titre d’inspecteur provincial et en prépara le programme. Des critiques conservateurs accusèrent le comité central d’autoriser l’emploi de manuels et de cahiers d’exercices rédigés par ses membres, dont un livre d’exercices de dictée mis au point par Ross.
Même si Ross n’avait pas fait du journalisme longtemps, cette expérience avait affermi son intérêt pour la politique. Il fut mis en candidature en prévision des élections fédérales de 1867 et, aux élections provinciales de 1871, il fit campagne dans la circonscription de Middlesex West pour Alexander Mackenzie*, alors député aux Communes et officieusement chef des libéraux fédéraux. Lorsqu’on proposa à Ross de se présenter dans Middlesex West au scrutin fédéral de 1872, il hésita. Ses chances de promotion lui semblaient meilleures à l’Assemblée législative de l’Ontario. En outre, il s’inquiétait de son inspectorat de comté, car Egerton Ryerson*, surintendant en chef de l’Éducation de l’Ontario, avait mis en doute l’à-propos de sa candidature et pressé Mackenzie de le convaincre de la retirer. Cependant, après son élection, on ne parla plus de conflit d’intérêts.
La vie de député d’arrière-ban ne plaisait guère à Ross. Il participait rarement aux débats et, lorsqu’il prenait la parole, sur le chemin de fer du Pacifique ou la politique tarifaire, il se contentait de réitérer – avec talent, certes – les positions de son parti. Il prit plus d’initiatives à propos de la prohibition. Il fut membre en 1873 et président en 1874 d’un comité spécial favorable à cette solution, mais il eut l’habileté d’admettre qu’aucun parti ne pouvait préconiser sans risque des restrictions plus sévères que ne l’exigeait l’opinion publique. Bien qu’il ait présenté en 1875 une proposition en faveur de la prohibition, il s’opposa à une motion semblable en 1877 en faisant valoir qu’un « travail constant » hors du Parlement ferait mieux avancer la cause. Il défendit donc la loi de Richard William Scott, l’Acte de tempérance du Canada de 1878, qui autorisait les localités à décider si elles imposeraient ou non la prohibition.
Ross demeura 11 ans aux Communes. Son élection en 1882 fut contestée avec succès en octobre 1883. Au lieu d’essayer de regagner son siège, il accepta l’invitation du premier ministre de l’Ontario, Oliver Mowat*, de se joindre à son cabinet à titre de ministre de l’Éducation. En remportant l’élection partielle tenue le 14 décembre 1883, il devint député de Middlesex West. Mowat avait d’abord offert le portefeuille de l’Éducation à George Monro Grant*, directeur du Queen’s College de Kingston, mais Grant avait réclamé que l’éducation soit soustraite à la sphère politique, et Mowat ne voulait pas qu’elle redevienne l’espèce de fief bureaucratique qu’elle avait été sous Ryerson. En Ross, Mowat trouva un ministre acceptable pour le corps enseignant, capable de remporter la victoire dans une circonscription chaudement disputée et capable aussi d’administrer un département de manière à étendre l’autorité de l’État.
Le prédécesseur de Ross, Crooks, malgré ses ennuis de santé et les réticences de son sous-ministre, John George Hodgins, était parvenu à restreindre l’emprise de la bureaucratie départementale. L’une des premières initiatives de Ross consista à édicter en avril 1884 une série de règlements internes qui limitaient le pouvoir de Hodgins en plaçant sous l’autorité du ministre le personnel, les achats, les rapports et la correspondance qui n’était pas strictement interne. Deux lois conçues par Ross et adoptées en 1885, le Public Schools Act et le High Schools Act, stipulaient que tous les règlements sur les écoles et les enseignants étaient sous l’autorité absolue du ministre et soumis à l’approbation de l’Assemblée. Le département allait recruter des fonctionnaires remarquables, dont des éducateurs influents tels, John Millar* et John Seath. Malgré leurs opinions politiques divergentes et le tempérament difficile de nombre d’entre eux, Seath par exemple, ces fonctionnaires acceptaient tous la responsabilité ministérielle.
Sûr de son administration départementale, Ross se consacra à la mise sur pied d’un système libéral, différent du modèle de Ryerson. Pour ce dernier, le système d’éducation se limitait aux écoles publiques gratuites. Les élèves appelés à poursuivre leurs études se prépareraient à l’université et aux professions dans les écoles secondaires moyennant des frais de scolarité. Pour Ross par contre, qui tenait à la promotion au mérite, il fallait un système intégré allant du jardin d’enfants (instauré en 1883 avec l’appui de Crooks) à l’université : c’était « le grand escalier de la connaissance ».
Selon Ross, chaque degré de l’escalier valait d’être atteint, mais il devait aussi préparer l’élève au degré suivant. Dans ce système, les examens départementaux à tous les niveaux prenaient plus d’importance en tant qu’outils d’attestation. Ross était heureux qu’un nombre croissant d’élèves souhaitent passer les examens d’entrée et de sortie même s’ils n’avaient pas l’intention d’aller plus loin. « Tout certificat décerné a une valeur commerciale », disait-il. Avec fierté, il signala que son département avait distribué en 1893 près de 750 000 examens pour divers niveaux d’attestation. L’argument selon lequel l’attribution incontrôlée de diplômes risquait de produire plus d’enseignants, d’avocats ou de médecins que la société ne pourrait en employer l’offensait : il y voyait une réaction élitiste. « Je ne suis pas prêt à admettre qu’il faille limiter les aspirations du fils de fermier ou d’artisan », répliquait-il.
Pour mettre en place l’« échelle éducationnelle », il fallait convaincre les établissements scolaires, les universités surtout, de voir au delà de leurs propres intérêts. Tout en affirmant qu’il incombait à l’État de déterminer si les élèves étaient admissibles à l’université et aux professions, Ross s’employa à instaurer des critères communs d’admission, dont le département reconnaissait certaines composantes pour l’accréditation non professionnelle ou scolaire des enseignants. Dans les règlements de 1885, il rattacha le programme des écoles secondaires aux examens d’admission de la University of Toronto, qu’il considérait comme l’université provinciale. Ensuite, il persuada cet établissement d’accepter les examens des brevets d’enseignement de deuxième et de première classe comme équivalents de ceux du diplôme de fin d’études secondaires et du cours préparatoire à l’entrée à l’université. Ainsi, son département acquit le droit de juger de l’atteinte des critères provinciaux d’après ses propres examens, et non d’après ceux conçus et notés par les représentants universitaires.
En 1884, en vue d’exercer un contrôle, Ross avait entamé des discussions sur la fédération des collèges et des universités. Le premier à lancer l’idée avait été William Mulock*, vice-chancelier de la University of Toronto ; celle-ci réclamait des subventions plus généreuses, et Mulock y voyait un argument supplémentaire à l’appui de cette demande. De son côté, Ross considérait la fédération comme un moyen d’atténuer le caractère confessionnel des universités et collèges ontariens, et il insista sur le fait que l’État ne financerait pas l’enseignement confessionnel. En 1887, il fit adopter une loi sur la fédération. Les établissements confessionnels fédérés, s’ils se trouvaient à Toronto, pourraient recourir à l’université provinciale pour la formation en lettres. Ils assureraient la formation en théologie et dans d’autres matières jugées essentielles à une instruction religieuse. Les sciences et la formation professionnelle seraient réservées à la University of Toronto. En retour, les collèges ne décerneraient pas de diplôme dans d’autres disciplines que la théologie. Le Wycliffe College accepta la fédération en 1889 ; le Knox College et la Victoria University [V. Nathanael Burwash] firent de même l’année suivante. Le St Michael’s College négocia des conditions spéciales. Le Trinity College, le Queen’s College et le Toronto Baptist College (qui prit le nom de McMaster University lorsqu’il reçut une charte en 1887 malgré l’opposition de Ross) refusèrent de se joindre à la fédération.
Les dispositions législatives sur l’éducation des minorités compliquaient l’instauration du système intégré souhaité par Ross. Les conservateurs, favorables à l’unilinguisme anglais, critiquaient vivement les écoles séparées et l’instruction bilingue. La réaction des protestants à la question des biens des jésuites [V. D’Alton McCarthy* ; François-Eugène-Alfred Évanturel*], à la fin des années 1880 et dans les années 1890, renforça leur position. Néanmoins, Ross acceptait le droit aux écoles séparées, garanti par la constitution aux parents catholiques. Sa politique, répétait-il, consistait à « promouvoir l’efficacité » dans le réseau séparé, à en améliorer l’assiette fiscale et à en rendre le fonctionnement plus semblable à celui du réseau public. En 1886, il fit donc des modifications législatives pour faciliter l’affectation, aux écoles séparées, des taxes versées par les contribuables catholiques et les sociétés comptant des actionnaires catholiques. En outre, il veilla à ce que les écoles séparées aient une année scolaire qui concorde avec celle du réseau public et à ce que leurs administrateurs aient des attributions comparables à celles de leurs homologues du réseau public. En faisant valoir que les conseils municipaux négligeaient les catholiques lorsqu’ils procédaient à des nominations, Ross obtint en 1885 une loi permettant aux administrateurs des écoles séparées de nommer un catholique au conseil local des écoles secondaires. Ce faisant, il offrait simplement aux administrateurs des écoles séparées ce qui avait été donné à ceux des écoles publiques.
Les critiques oubliaient aussi la pratique en cours dans les écoles publiques quand ils reprochaient à Ross et à Mowat de ne pas exiger que l’élection des administrateurs des écoles séparées se fasse au scrutin secret. Bien qu’autorisé depuis 1885 lorsque les électeurs des écoles publiques le demandaient, le scrutin secret n’était pas du tout courant. À mesure que les anticatholiques exprimaient leur colère à propos du caractère non démocratique des élections, l’Église subit de plus en plus de pressions, et elle accepta avec réticence le scrutin secret en 1894. Les détracteurs de Ross prétendirent qu’il y avait eu collusion entre les libéraux et les catholiques, mais en fait, Ross avait adopté une solution modérée. Il s’opposait aux revendications des catholiques qui étaient incompatibles avec l’accroissement de l’autorité de l’État, par exemple la nomination d’un sous-ministre des écoles séparées. En outre, il tenait à ce que les manuels utilisés dans ces écoles soient soumis à son approbation, à ce que les enseignants satisfassent aux critères d’accréditation du réseau public et à ce que l’État inspecte ces écoles.
À sa liste de récriminations contre l’éducation des minorités, l’opposition protestante ajoutait l’instruction bilingue. La question des écoles de langue française domina les débats de l’Assemblée au printemps de 1889 et fut l’un des principaux enjeux des élections de 1890. Cependant, Ross refusait de mettre fin à l’enseignement en français. En mars 1889, lorsqu’il déclara que l’éducation devait « assimiler les personnes et les langues des autres nationalités », il n’entrevoyait pas nécessairement un nationalisme unilingue. Si l’usage d’une langue étrangère devenait « un stigmate [...] qui empêch[ait] de jouir de [...] tous les privilèges de la citoyenneté », rappelait-il aux Ontariens, le Canada serait inhospitalier envers les immigrants. Fermement convaincu que la « race anglo-saxonne » resterait dominante au Canada, il ne croyait pas l’unilinguisme essentiel à la création d’une nation de citoyens patriotes. Quand même, reprenant l’argument classique selon lequel l’anglais était la langue de l’État, il avait imposé en 1885 l’étude de l’anglais et l’enseignement en anglais, dans la mesure du possible. Enseigner seulement le français ou (dans certaines régions tel le comté de Waterloo) seulement l’allemand risquait de favoriser le repli sur soi et de nuire au patriotisme. Publiquement, pour des raisons politiques, Ross soulignait que les parents francophones voulaient que leurs enfants apprennent l’anglais. Expliquer comment le programme pouvait satisfaire leur désir tout aussi vif de voir leurs enfants apprendre à lire et à écrire en français était beaucoup plus difficile. Ross attribuait donc à une pénurie de professeurs et de manuels bilingues les lents progrès en anglais constatés jusqu’à la fin des années 1880.
Une enquête menée en 1889 prit la mesure réelle de l’enseignement en français. Elle permit de découvrir des manuels à contenu catholique dans les écoles publiques et révéla que la formation religieuse – catholique dans les écoles publiques de langue française, à la fois catholique et protestante dans les écoles de langue allemande – se donnait pendant les heures de classe, à l’encontre des règlements. En outre, elle conclut que les manuels d’histoire utilisés dans les écoles françaises publiques et séparées étaient « écrits dans un esprit hostile à l’Empire britannique et à l’avènement d’un patriotisme embrassant tout le dominion du Canada ». Ross réagit à l’enquête en rappelant les règlements sur l’instruction religieuse aux administrateurs et inspecteurs et en autorisant l’utilisation des manuels anglais-français employés dans les Maritimes. En 1890, quatre ans après que la fondation en eut été autorisée, une école modèle destinée à la formation des enseignants de langue française ouvrit ses portes à Plantagenet, dans le comté de Prescott.
Une deuxième enquête, en 1893, assura Ross que, tant dans les écoles publiques que dans les écoles séparées, les connaissances des élèves en anglais et l’enseignement dans cette langue s’étaient améliorés. Toutefois, la controverse sur l’instruction religieuse et l’application des règlements à ce sujet avaient poussé 27 écoles des comtés de Prescott et de Russell à quitter le réseau public pour le réseau séparé. Ross déplorait sans doute ce changement, mais un fait était de nature à le réconforter : certains parents catholiques exigeaient une amélioration de l’instruction. Par exemple, les administrateurs des écoles séparées d’Ottawa demandaient une enquête sur leurs écoles. L’enquête de 1893 mena également à une évaluation de l’enseignement donné par les communautés religieuses et vint étayer une revendication des parents catholiques, à savoir que les sœurs et les frères enseignants acceptent le processus d’accréditation imposé aux professeurs laïques.
Bien qu’il ait résisté à l’influence des Églises, Ross considérait l’instruction religieuse comme un élément essentiel de la formation morale. Cependant, il apprit vite que, à cause du sectarisme et des divergences théologiques, faire entrer en classe quelque chose qui visait à promouvoir un « christianisme commun » pouvait être ardu. En décembre 1884, il rendit l’instruction religieuse obligatoire en imposant des prières au début et à la fin des journées de classe ainsi que des lectures bibliques. Bon nombre de protestants et de catholiques se hérissèrent devant le « programme biblique de Ross ». En vue d’en arriver à un consensus, le ministre accepta des suggestions de l’archevêque catholique de Toronto, John Joseph Lynch*, et d’un comité formé de protestants. Mais certains évêques – James Joseph Carbery de Hamilton, James Vincent Cleary* de Kingston et John Walsh* de London – n’étaient pas d’accord avec Lynch. En plus, le journal anticatholique Toronto Daily Mail [V. Christopher William Bunting*] protesta même contre la consultation menée auprès de Lynch et déclara que prendre des extraits des Écritures, c’était mutiler celles-ci. Ross eut beau faire valoir que les lectures favorisaient la compréhension des élèves au lieu de la fausser, des concessions s’imposaient. On apaisa les critiques en privé, on révisa les passages controversés des lectures, on permit aussi de lire la Bible elle-même, on garantit l’exemption des enfants et professeurs catholiques, et un collègue de Ross au cabinet, Christopher Finlay Fraser*, négocia discrètement un compromis avec les évêques mécontents. Malgré ces reculs, Ross continua de viser à ce que le christianisme soit « la base [du] système scolaire », comme il le dit en 1887.
L’instruction religieuse n’était pas la seule méthode d’éducation morale. Selon Ross, les moyens indirects étaient les plus efficaces : l’entourage et les cours influençaient les élèves et leur transmettaient des valeurs. Les manuels autorisés contenaient donc des extraits qui s’adresseraient au « sens moral et religieux » des enfants. La discipline scolaire devait refléter celle de la famille. Les règlements obligeaient donc les enseignants à exercer la discipline de « parents judicieux » et, par leur exemple, leur enseignement et leur autorité, à « inculquer à chaque élève le respect de ces obligations morales qui sous-tendent un caractère bien formé ». Pour promouvoir le civisme, Ross instaura en 1885 une journée où les enfants plantaient des arbres, nettoyaient le terrain des écoles et façonnaient un environnement symbolisant l’idéal de la société ; c’était la fête des arbres.
En 1896, Ross s’enquit, auprès des inspecteurs des écoles publiques, des résultats de l’éducation étatique, c’est-à-dire des directives imposées par le département de l’Éducation depuis 20 ans et des lois de 1871 et de 1891 sur la fréquentation scolaire obligatoire. La moralité des professeurs et des élèves s’était-elle améliorée ? Dans l’ensemble, la réponse fut positive, mais certains se demandèrent si le progrès s’était vraiment produit à l’intérieur des individus. La surveillance des enfants et des enseignants était plus serrée, mais la présence aux cours demeurait irrégulière : seulement 50 % des enfants d’âge scolaire étaient à l’école en 1887. Peut-être conscient des limites de l’éducation morale, Ross instaura des mesures disciplinaires plus punitives. En 1891 par exemple, les commissions de police ou les administrateurs scolaires furent autorisés à nommer des agents de surveillance. Dans son rapport de 1898, Ross se demanda s’il ne faudrait pas des mesures encore plus rigoureuses.
Dans une large mesure, le ministre de l’Éducation Ross ne fit que poursuivre l’œuvre de ses prédécesseurs. L’affirmation de la responsabilité ministérielle, la scolarité obligatoire, le rattachement des cours secondaire et post-secondaire au réseau public, la formation professionnelle des enseignants, la rédaction de manuels sous supervision départementale, tous ces progrès venaient couronner un travail de promotion scolaire auquel une génération d’Ontariens s’était consacrée. À ces réalisations majeures Ross ajouta un certain nombre de mesures précises qui étendirent l’autorité départementale et ministérielle : publication en 1884 d’un arrêté en conseil qui obligeait la University of Toronto [V. sir Daniel Wilson*] à admettre les femmes ; financement des jardins d’enfants et mise au point d’une formation spécialisée pour leurs instituteurs ; instauration de la formation sur la tempérance sur une base facultative en 1885 ; encouragement de la formation manuelle et des arts ménagers ; promotion de l’instruction technique et de l’éducation des adultes. Cependant, l’apport le plus important de Ross fut d’ordre administratif. Par les modifications qu’il apporta, il raccourcit les lois sur l’éducation et se donna, en tant que ministre, le pouvoir d’édicter des règlements départementaux afin de faire de l’échelle éducationnelle un système d’attestation plus efficace.
Dans sa jeunesse, Ross avait pu échapper à la vie rurale et à des perspectives d’avenir étroites grâce aux écoles de l’Ontario. À mesure que l’industrialisation et l’urbanisation transformaient la province, il était convaincu que d’autres pouvaient manifester leur force de caractère – condition préalable à la réussite, selon lui – en relevant les défis du département de l’Éducation, c’est-à-dire en franchissant les étapes d’évaluation et d’attestation du système. Toutefois, d’après le chef conservateur James Pliny Whitney, Ross était si préoccupé par le processus d’attestation que les écoles élémentaires avaient du mal à donner une formation adéquate aux enfants des « classes pauvres », et le département avait été si parcimonieux que le réseau des écoles secondaires et la University of Toronto manquaient de fonds. En 1897, Whitney réorienta donc les critiques de l’opposition vers ces faiblesses de la politique libérale et délaissa les droits des minorités. Par ailleurs, la Dominion Educational Association et d’autres organismes professionnels n’étaient pas toujours ravis par ce que Ross faisait pour peaufiner le système éducationnel de l’Ontario. Par exemple, en réclamant une discipline plus coercitive, il contestait implicitement que le système formait vraiment le caractère des élèves. Ross se défendait avec éloquence en rappelant à ses détracteurs que d’autres provinces avaient adopté le modèle ontarien. « Je pense que nous sommes allés à peu près aussi loin que nous devons aller », conclut-il en 1899. Pour lui, les diplômes honorifiques qui venaient sanctionner ses réalisations étaient sans doute les bienvenus. Il en reçut de la University of St Andrews en Écosse en 1888, du Victoria College en 1892 et de la University of Toronto en 1894. Des honneurs semblables lui seraient décernés par la McMaster University en 1902 et par le Queen’s College en 1903.
Le ministre Ross s’était toujours occupé des détails administratifs de son département, et il affirmait souvent son autorité de manière assez brusque. Une fois qu’il avait adopté une ligne de conduite, il pouvait être opiniâtre et mesquin. Sa campagne contre Hodgins, collaborateur peu commode lui aussi, met en lumière cet aspect désagréable de sa personnalité. Non seulement poussa-t-il Hodgins sur une voie de garage, peut-être par crainte des répercussions politiques de son congédiement, mais il trouva le moyen de l’insulter ; Hodgins finit par démissionner en 1890. Le professeur Eugène Emil Felix Richard Haanel, qui perdit son poste au Victoria College lorsque cet établissement s’affilia à la University of Toronto, se laissa entraîner par Ross dans une vilaine et trop longue querelle à ce sujet. Quand il était question de l’autorité du ministre sur les universités, les relations de Ross avec George Monro Grant et William Mulock, deux hommes tenaces, étaient pénibles. Mulock reprochait à Ross d’agir comme « Bismarck ou Menchikov, et non comme un représentant des citoyens libres du Canada ».
Le 20 octobre 1899, Arthur Sturgis Hardy*, premier ministre de l’Ontario depuis 1896, prit sa retraite. En tant que doyen des ministres, Ross lui succéda tout en assumant la fonction de trésorier de la province. Le contexte était difficile. Sous Hardy, les libéraux avaient perdu beaucoup d’appuis, même si la province était dans une bonne situation économique. Grâce à l’extension des frontières nordiques de la province, à l’affirmation des droits provinciaux sur les terres de la couronne et à la mise en valeur des richesses naturelles, l’assiette des revenus s’était agrandie, ce qui permettait au gouvernement de constituer un surplus. L’ouverture du nord de l’Ontario annonçait une renaissance de l’époque pionnière qui avait soutenu le libéralisme sous Mowat. En même temps, les écoles ontariennes s’efforçaient de cultiver chez les jeunes la discipline personnelle, l’individualisme et le civisme que le libéralisme avait associés au fermier et à l’artisan. Cependant, l’Ontario avait changé : il s’urbanisait, et la population urbaine se concentrait dans les plus grands centres. Malgré cela, Ross orienta graduellement les interventions de son gouvernement vers le Nord, le « Nouvel-Ontario », et vers le secteur des richesses naturelles.
Dans la première année de son mandat, Ross commanda une vaste étude sur les ressources du nord de la province. Cette étude conclut que la vaste zone argileuse du nord-est, la Great Clay Belt, présentait un potentiel remarquable du point de vue de la colonisation. Le premier ministre prononça des discours promotionnels, écrivit aux journaux britanniques pour encourager l’immigration, pressa le gouvernement fédéral de diriger les immigrants agricoles vers le nord et mit sur pied un bureau de colonisation. Pour attirer le capital, son gouvernement continua à distribuer généreusement des permis d’exploitation des richesses naturelles et offrit des subventions à la construction ferroviaire. Les concessions de bois à pâte se vendaient privément, et non à des enchères publiques comme le réclamaient les conservateurs. Les propriétés minières pouvaient être détenues à des conditions adaptées aux moyens financiers et aux intérêts spéculatifs de l’investisseur ; en 1900, le gouvernement élimina les redevances. Le fait que ce dernier devait entreprendre en 1903 la construction puis l’exploitation du Temiskaming and Northern Ontario Railway n’entrait pas nécessairement en contradiction avec son rejet de la régie publique dans d’autres secteurs : ce chemin de fer était analogue aux routes de colonisation construites par le gouvernement et suscitait un appui enthousiaste dans le Nord et dans les milieux d’affaires torontois.
Stimuler l’industrie manufacturière s’avéra plus ardu. En 1900, Ross exigea que l’épinette abattue sur les terres de la couronne pour la fabrication de pâte à papier soit traitée au Canada (le gouvernement Hardy avait exigé la même chose pour le pin). Plusieurs entreprises de pâtes et papiers tentèrent d’établir des installations, mais elles échouèrent, notamment à cause de la récession de 1903 et du tarif américain sur les pâtes, les papiers et le papier journal canadiens. Toujours en 1900, le gouvernement fit modifier le Mines Act en vue de prélever, sur le minerai de nickel, des droits qui seraient remboursés si le raffinage se faisait au Canada. Des capitalistes américains intéressés demandèrent au gouvernement fédéral de refuser de reconnaître la nouvelle loi en faisant valoir que la réglementation du commerce n’était pas de compétence provinciale. Bien que sir Wilfrid Laurier, premier ministre libéral du Canada, ait été d’accord, des raisons politiques le faisaient hésiter à refuser de reconnaître la loi. Il préféra que son ministre de la Justice, David Mills*, fasse simplement connaître les motifs en vertu desquels cela pourrait être fait. Furieux, Ross proposa de soumettre la question aux tribunaux, mais il ne tarda pas à se raviser : contrairement aux arbres abattus sur les terres de la couronne, le minerai était extrait sur des propriétés privées, et les tribunaux pourraient donner tort à la province. Ross aurait pu conclure aussi que le procureur général John Morison Gibson*, également conseiller juridique d’un consortium qui faisait la promotion d’une fonderie à Hamilton, avait exagéré la rentabilité du raffinage du nickel au Canada [V. Andrew Trew Wood*]. Jamais Ross ne soumit la loi aux tribunaux ni ne demanda la sanction du lieutenant-gouverneur.
Les ambitions industrielles de Ross pour le Nord se portaient principalement sur le complexe de Francis Hector Clergue* à Sault-Sainte-Marie, ensemble hydroélectrique, ferroviaire et chimique qui produisait aussi des pâtes et papiers, du fer et de l’acier. Ayant consenti de généreuses primes à cette entreprise, Ross se sentit obligé d’intervenir quand, en septembre 1903, Clergue ne paya pas ses ouvriers et ses créanciers. Le premier ministre fit envoyer des miliciens de Toronto pour contenir les manifestations et, le 1er octobre, il garantit les salaires impayés par la société mère de Clergue. En mars 1904, après la réorganisation de cette société, le gouvernement lui prêta 2 millions de dollars. Interpellé par le chef conservateur James Pliny Whitney, qui déclara que la province pourrait bien se trouver forcée, en fin de compte, de la prendre en charge, Ross écarta cette possibilité. Le gouvernement pourrait toujours vendre la propriété. Pour Ross, la responsabilité de l’État libéral se limitait à créer un climat favorable à l’initiative individuelle.
De même, Ross refusa qu’une usine qui produisait et transmettait de l’énergie hydroélectrique à partir des chutes du Niagara soit sous régie provinciale. Il ne voyait pas pourquoi la province s’endetterait pour un service dont seule une petite partie de la population profiterait. Les concessions susceptibles de rapporter des recettes au trésor public étaient préférables. Des droits avaient été concédés à Niagara en 1892 ; en 1900, le gouvernement signa une deuxième entente, avec un consortium américain. Trois ans plus tard, une troisième concession fut accordée à l’Electrical Development Company, propriété des entrepreneurs torontois William Mackenzie*, Frederic Nicholls* et Henry Mill Pellatt*. Malgré des pressions de la part de manufacturiers et de réformateurs municipaux, Ross refusa de réserver des emplacements pour une centrale électrique détenue par une coopérative municipale, même si une loi adoptée en 1903 autorisait une commission municipale à transmettre de l’énergie à ses propres frais. Ross, pouvait-on penser, cédait à l’influence de milieux d’affaires : à l’époque, il était président de la Compagnie d’assurance sur la vie, dite des Manufacturiers. Cette société souhaitait détenir des actions de l’Electrical Development Company ; Mackenzie et Pellatt appartenaient à son conseil d’administration. De plus, John Morison Gibson avait des intérêts dans une autre société énergétique. Ross ne fit rien pour écarter les soupçons quand, dans les derniers jours de son gouvernement, il concéda les emplacements hydroélectriques restants à l’Electrical Development Company. De toute évidence, la popularité du mouvement en faveur d’une régie publique de l’énergie [V. sir Adam Beck*] le déroutait. Par la suite, dans des discours et des écrits, il tenterait sans grand succès de se débattre avec une nouvelle conception de l’État.
Les dossiers des mines et de l’hydroélectricité ne montrent pas Ross sous son meilleur jour. Peut-être laissait-il à d’autres, Gibson surtout, trop de latitude dans le choix des orientations à prendre. Quand il pouvait choisir ses collaborateurs et maintenir la discipline par l’autorité ministérielle, comme il l’avait fait au département de l’Éducation, il s’en tirait fort bien. Par contre, quand il était le chef d’un groupe d’égaux, il était désavantagé ; il ne pouvait ni ne voulait commander. Dépourvu peut-être pas du sens politique de Mowat ou de Hardy, il abandonnait trop l’initiative au secrétaire de la province, James Robert Stratton, qui n’était guère qu’un agent électoral, et à Gibson l’élitiste, qui méprisait les subtilités du processus démocratique.
Contrairement à la question énergétique, la prohibition aurait été un fardeau pour n’importe quel gouvernement. Bien que favorable depuis longtemps à la tempérance, Ross s’efforçait de ne pas aborder cette question dans ses campagnes électorales. En concluant en novembre 1901 que la loi manitobaine sur la prohibition était constitutionnelle, le comité judiciaire du Conseil privé encouragea la cause prohibitionniste en Ontario. En février 1902, suivant l’exemple du Manitoba, Ross présenta un projet de loi autorisant la prohibition à la condition qu’elle reçoive l’appui d’un nombre égal à la majorité des suffrages exprimés aux élections de 1898. On tint un référendum le 4 décembre 1902 et le nombre de voix s’avéra inférieur à ce qui était exigé. Cinq jours plus tard, dans un discours devant les Fils de la tempérance à Toronto, Ross refusa de prendre d’autres mesures [V. Francis Stephens Spence].
La déception des prohibitionnistes influerait sur les résultats du scrutin de 1905, mais pour l’heure, un autre problème occupait les esprits : les accusations de fraude électorale. Sous Mowat et Hardy, l’Ontario Libéral Association dirigeait un appareil qui réussissait à convaincre les électeurs d’aller voter et aidait les libéraux à garder le pouvoir. Dans les années 1890, cet appareil commença à avoir des ratés. Whitney eut l’habileté de placer la corruption au cœur des débats politiques en protestant inlassablement contre les irrégularités. À la suite d’accusations portées au sujet de l’élection dans Elgin West en 1898, Ross forma une commission d’enquête peu après avoir assumé la fonction de premier ministre. Les commissaires découvrirent que les bulletins de vote avaient été brûlés, ce qui semblait cacher quelque chose de louche. Les accusations portées le 11 mars 1903 par Robert Roswell Gamey, député conservateur de Manitoulin, furent plus dommageables. Après le scrutin de 1902, dit Gamey, un organisateur libéral lui avait offert de l’argent et la distribution des faveurs dans sa circonscription en échange de son appui au gouvernement. Gamey aurait reçu une somme au bureau attenant à celui du secrétaire de la province, Stratton. Bien qu’une commission royale d’enquête formée par Ross ait semé des doutes sur le témoignage de Gamey et exonéré Stratton de tout blâme, les pressions ne se relâchèrent pas. En septembre 1904, au cours d’un procès sur des accusations relatives à l’élection partielle de 1903 dans Saint-Sainte-Marie, on apprit que le vainqueur libéral avait reçu une aide illégale de la part d’une société de Francis Henry Clergue, l’Algoma Central Railway Company. Un vapeur de l’entreprise avait transporté 20 habitants du Michigan pour qu’ils aillent voter sous le nom de mineurs décédés ou absents. Prévenu de ce complot, le candidat conservateur s’était plaint au procureur général Gibson, qui n’avait rien fait.
Les opinions sur la responsabilité de Ross divergeaient. Le reporter Hector Willoughby Charlesworth* le jugeait « sans malice », inconscient du « manque de scrupules [...] de son entourage » tandis que, d’après John Stephen Willison*, il participait aux machinations par désespoir. Tous deux avaient probablement raison. Sans être un homme d’appareil comme Hardy, Ross savait par expérience à quelles extrémités les organisateurs devaient parfois aller pour que leurs candidats gagnent. Il n’avait pas besoin de connaître les dessous de toutes les campagnes ; il devait tout au plus s’assurer que, à la suite des élections, on veillait à ce que les résultats controversés ne causent pas trop de dommages. Toutefois, en prévision du scrutin de janvier 1905, il dut faire maison nette : il accepta la démission de Stratton et rétrograda Gibson. En outre, une nouvelle organisation, la General Reform Association of Ontario, remplaça l’Ontario Libéral Association en novembre 1904, et le secrétaire général de cette dernière, James Vance, fut démis de se-s fonctions d’organisateur. Cependant, ni ces changements, ni l’aveu du premier ministre – « Nous avons péché, nous nous sommes repentis et nous sommes désolés » – ne permirent aux libéraux de garder le pouvoir. Les conservateurs obtinrent une majorité de 40 sièges.
Les mœurs électorales douteuses, la prohibition et la question des écoles séparées sont autant de facteurs qui contribuèrent à la défaite libérale, comme l’admit Ross. En plus, malgré une longue suite de victoires, la présence des libéraux au pouvoir, même avant le court mandat de Ross, reposait sur un suffrage populaire à peine plus élevé que celui de l’opposition. Aux élections de 1902, le Parti libéral avait remporté une majorité de sièges avec moins de la moitié des votes, et un changement dans quelques circonscriptions en 1898 ou en 1902 aurait pu produire des résultats très différents. En outre, même si le gouvernement Ross s’attribuait le mérite de la longue feuille de route des libéraux en matière de législation industrielle, il avait fait assez peu, sauf s’engager à mettre en valeur les richesses naturelles. En dépit de leur utilité, des mesures telles les primes à l’industrie de la betterave à sucre, la promotion de l’industrie du bœuf préparé, la nomination d’un commissaire de la voirie et l’affectation de un million de dollars à l’amélioration des routes n’étaient guère de nature à soulever les partisans. Avec une sagesse rétrospective, Ross déclarerait dans un ouvrage paru à Toronto en 1913, Getting into parliament and after, qu’il ne restait plus rien qui ait été de nature à « évoquer les impressionnantes conceptions de l’État qui attirent les masses ». En Ontario, le libéralisme était à bout de souffle.
Ross dirigea l’opposition durant deux sessions avant d’accepter avec joie un siège au Sénat le 15 janvier 1907. Peut-être parce que certains vétérans du parti doutaient de ses aptitudes administratives et de son engagement envers les « vrais principes réformistes », il ne fut pas nommé au cabinet fédéral, comme il l’aurait souhaité. Toutefois, d’autres honneurs lui échurent : un titre de chevalier en 1910 et la direction des libéraux au Sénat en 1911. Préconisant pour le Sénat un rôle de protecteur des droits provinciaux et de défenseur de l’Empire, Ross dirigerait la campagne d’obstruction du Sénat contre le gouvernement conservateur de Robert Laird Borden* à compter de 1911.
La force de Ross en politique était son éloquence. Il avait la réputation d’être l’un des meilleurs orateurs du Canada et, quoique les versions écrites de bon nombre de ses discours manquent de substance, il était très habile dans les débats parlementaires. Son impérialisme n’était guère plus que l’enthousiasme auquel se laisse aller un politicien sentimental en prenant la parole après un dîner, et l’Empire était un sujet qui émouvait les auditoires canadiens-anglais, surtout dans les années suivant le jubilé de diamant de la reine Victoria et la guerre des Boers. Dans ce registre émotif, l’impérialisme était, pour Ross, un moyen de faire passer le sentiment patriotique qui, selon lui, était essentiel à une solide citoyenneté. À cette fin, en tant que ministre de l’Éducation, il avait compilé pour les élèves Patriotic recitations and Arbor Day exercises (Toronto, 1893). En 1899, il instaura dans les écoles la célébration du Jour de l’Empire [V. Clementina Trenholme]. Dans ses discours, il insistait sur l’unité nationale qui était possible au sein de l’Empire. Tout comme les habitants d’origine anglo-saxonne, celtique et galloise avaient contribué aux grandes réalisations de l’Empire, les gens de diverses origines, disait-il, pouvaient accomplir de grandes choses au Canada. Quand même, il y avait des limites à cette diversité. Dans une allocution prononcée en Angleterre en 1901, Ross se sentit libre d’exprimer des réserves sur l’immigration des doukhobors, des galiciens et des mennonites ; ces gens devraient « passer par un processus de naturalisation ». De retour en Ontario, il déclara : « Nous voulons [...] des gens de notre parenté, des hommes [...] à qui leur éducation a inculqué la foi dans les institutions britanniques. »
Sur le plan concret, bien qu’il ait souhaité un resserrement des liens au sein de l’Empire, Ross doutait que la Grande-Bretagne tienne beaucoup à défendre les intérêts du Canada, surtout dans les négociations avec les États-Unis. La fédération impériale l’intéressait en tant qu’étape finale de la dévolution de la souveraineté, du Parlement britannique à un Parlement impérial de la Grande-Bretagne et des dominions, mais la perspective d’une fédération de ce genre, disait-il, était lointaine. Entre-temps, des mesures plus modestes le satisferaient, par exemple la préférence commerciale et la promotion des investissements et de l’immigration vers le Canada. Le préjugé britannique à l’égard du libre-échange, suggérait-il, pourrait être surmonté en affectant à la défense impériale les recettes des tarifs préférentiels.
À compter de 1909, la question de la défense impériale provoqua de profondes divisions entre les partis. Ross appuya vigoureusement le projet de loi concernant le Service de la marine du Canada, présenté par Laurier en 1910. Ce projet prévoyait la création d’une petite marine canadienne qui contribuerait à la défense de l’Empire en cas d’urgence. Après la défaite de Laurier en 1911, le Sénat, dominé par les libéraux, s’opposa avec obstination au programme législatif du gouvernement Borden et rejeta ou modifia l’un après l’autre les projets de loi. Celui qui portait sur l’aide à la marine eut des répercussions particulièrement importantes. N’entrevoyant aucune urgence qui justifierait une subvention de 35 millions de dollars à la marine royale et fâchés que Borden n’ait rien fait en vue de créer une marine canadienne, les libéraux firent traîner le débat aux Communes du 5 décembre 1912 au mois de mai 1913, soit jusqu’au moment où le gouvernement employa la clôture pour faire adopter le projet. Le leader conservateur au Sénat, James Alexander Lougheed*, négocia une entente avec Ross : le gouvernement accepterait un amendement prévoyant des crédits pour une marine canadienne si le Sénat adoptait le projet. Ross avait souhaité un engagement plus ferme en faveur d’une marine indépendante, mais en privé, il favorisait le projet de loi, y voyant une « contribution pour la protection que la Grande-Bretagne [...] a[vait] apportée [au Canada] durant 150 ans ». En outre, il était devenu insatisfait de la politique navale de Laurier et avait parlé de quitter le parti à cause de la position de celui-ci sur la réciprocité. Furieux que les Communes aient été bâillonnées, les autres sénateurs libéraux et Laurier refusèrent tout compromis. Ross accepta la position de son parti et, à la tête de l’opposition au Sénat, força le retour du projet de loi devant les Communes le 30 mai 1913.
Comme Ross l’avait craint, on se mit à réclamer une réforme du Sénat à cause de la défaite du projet de loi. Quand la Chambre haute rejeta l’idée de nommer au Sénat un plus grand nombre de représentants de l’Ouest, idée proposée par le premier ministre Borden, celui-ci envisagea sérieusement de tenir un référendum sur l’électivité du Sénat. Pour défendre son point de vue, Ross rassembla des idées qu’il avait exprimées en diverses occasions et les publia sous le titre The Senate of Canada [...] (Toronto, [1914]). Ce livre ne contenait pas que de la rhétorique partisane ; il avançait une justification idéologique crédible. Le Sénat, affirmait Ross, ne pouvait être réformé que par une entente entre les provinces qui avaient créé la Confédération.
En s’opposant à la réforme du Sénat comme il s’était opposé à la régie publique, Ross adoptait des positions qui semblaient contraires à l’opinion démocratique. Dans sa société idéale, les hommes prenaient individuellement des initiatives et récoltaient le fruit de leurs efforts. « [C’est] un fait, déclara-t-il au Sénat en mai 1913, que les hommes qui ont le mieux réussi dans nos professions et dans les affaires ont été élevés dans une ferme jusqu’à un certain âge et que, avec cette force mentale et physique, acquise grâce à leur milieu, ils ont été mieux en mesure d’affronter les problèmes et les difficultés. » Telle avait été son expérience. Cependant, au début du xxe siècle, la proportion de la population née dans une ferme était de plus en plus petite, et les valeurs associées au milieu agricole avaient perdu une grande part de leur attrait politique.
Le débat sur la marine fut la dernière grande campagne de sir George William Ross. Le rhumatisme dont il souffrait depuis les années 1880 l’obligeait parfois à s’absenter du Sénat. Au printemps de 1913, il eut une pneumonie bénigne. Le 24 janvier 1914, il s’effondra au cours d’une allocution au Sénat. Transporté d’urgence à Toronto, il resta à l’hôpital jusqu’à sa mort, le 7 mars. Il laissait dans le deuil sa troisième femme, Mildred Margaret Peel, deux fils et six filles.
Les discours que sir George William Ross a prononcés au Parlement fédéral sont reproduits dans les Débats, 1875–1883, de la Chambre des communes, et dans les Débats, 1907–1914, du Sénat. On trouve ses rapports à titre de ministre de l’Éducation de l’Ontario dans Ontario, Legislature, Sessional papers, 1884–1900. Les autres publications de Ross, y compris des allocutions, des articles et des livres, traitent de l’éducation, de la prohibition et de la tempérance, de questions concernant l’Empire, et de la réciprocité. La plupart de ces publications parues jusqu’en 1900 sont répertoriées dans le Répertoire de l’ICMH et dans Canadiana, 1867–1900.
Les ouvrages suivants sont particulièrement dignes de mention : Scotland and her memories : address delivered at Montreal, on Hallowe’en, October 31st, 1890 (Toronto, 1891) ; The schools of England and Germany ([Toronto ?], 1894) ; The school system of Ontario (Canada) : its history and distinctive features (New York, 1896) ; The universities of Canada, their history and organization : with an outline of British and American university systems ([Toronto], 1896 ; publié aussi dans une annexe au rapport de 1896 du ministre de l’Éducation) ; « Education in Ontario since confederation », dans Canada, an encyclopædia (Hopkins), 3 : 174–179 ; Addresses delivered by the Hon. G. W. Ross during his recent visit to England and at the meeting on his return (s.l, [1901 ?]) ; « The future of Canada », dans Canadian politics ; with speeches by the leaders of reform and progress in Canadian politics and government, J. R. Long, édit. (St Catharines, Ontario, 1903) ; The Liberal platform discussed by Hon. G. W. Ross at Barrie (s.l., [1904 ?]), 177–187 ; Reply to the manifesto of the executive committee of the Ontario branch of the Dominion Alliance ([Toronto], 1904) ; Shall Canada be always a dependency of the empire ? : extension of the address delivered at the banquet tendered to Viscount Milner by the National Club, Oct. 28th, 1908 ([Toronto ?, 1908 ?]) ; Reciprocity ; address delivered to members of the Toronto Board of Trade at luncheon, November 3rd, 1910 ([Toronto], 1910) ; Opposes reciprocity treaty : Sir Geo. W Ross in speech before Toronto Board of Trade urges many reasons why Canada should not sign a trade treaty with the United States ([Toronto, 1911 ?] ; exemplaire conservé aux AO, Pamphlet Coll., 1911, no 11) ; et son autobiographie, Getting into parliament and after (Toronto, 1913).
AN, MG26, B ; G ; MG 27, II, D14 ; MG29, D38 ; E29.— AO, RG 2 ; RG 3-1.— Globe, 5 sept. 1877.— Mail (Toronto), 22, 25 août, 6 sept. 1877, publié par la suite sous le titre Toronto Daily Mail, 19 févr. 1885 ; 17–18 nov., 1er, 4, 7, 11 déc. 1886.— D. S. Cameron, « John George Hodgins and Ontario education, 1844–1912 » (mémoire de m.a., Univ. of Guelph, Ontario, 1976).— Douglas Dart, « George William Ross – minister of education for Ontario, 1883–1899 » (mémoire de m.a., Univ. of Guelph, 1971).— A. M. Evans, Sir Oliver Mowat (Toronto, 1992).— Chad Gaffield, Language, schooling, and cultural confict : the origins of the French-language controversy in Ontario (Kingston, Ontario, et Montréal, 1987).— R. D. Gidney et W. P. J. Millar, Inventing secondary education : the rise of the high school in nineteenth-century Ontario (Montréal et Kingston, 1990).— C. W. Humphries, « The Gamey affair », OH, 59 (1967) : 101–109 ; « Honest enough to be bold » : the life and times of Sir James Pliny Whitney (Toronto, 1985).— Nelles, Politics of development.— Ontario, Legislature, Sessional papers, 1878–1882, rapports du ministre de l’Éducation, 1876–1881 ; commission royale d’enquête concernant les accusations de Gamey, Report (Toronto, 1903).— Margaret Ross, Sir George W Ross : a biographical study (Toronto, 1923).— R. M. Stamp, « Empire Day in the schools of Ontario : the training of young imperialists », REC, 8 (1973), no 3 : 32–42 ; The schools of Ontario, 1876–1976 (Toronto, 1982).— B. D. Tennyson, « The cruise of the Minnie M. », OH, 59 : 125–128.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
David G. Burley, « ROSS, sir GEORGE WILLIAM », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 30 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/ross_george_william_14F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/ross_george_william_14F.html |
| Auteur de l'article: | David G. Burley |
| Titre de l'article: | ROSS, sir GEORGE WILLIAM |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1998 |
| Année de la révision: | 1998 |
| Date de consultation: | 30 déc. 2025 |