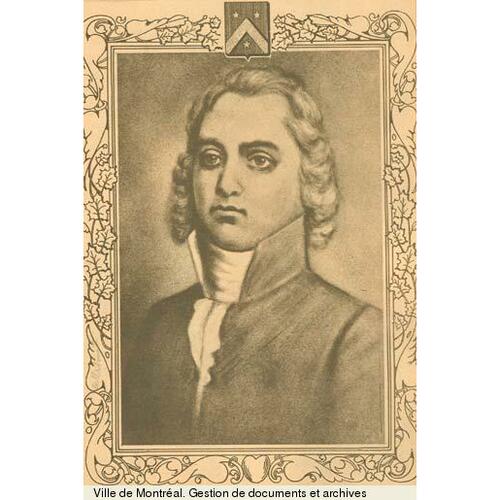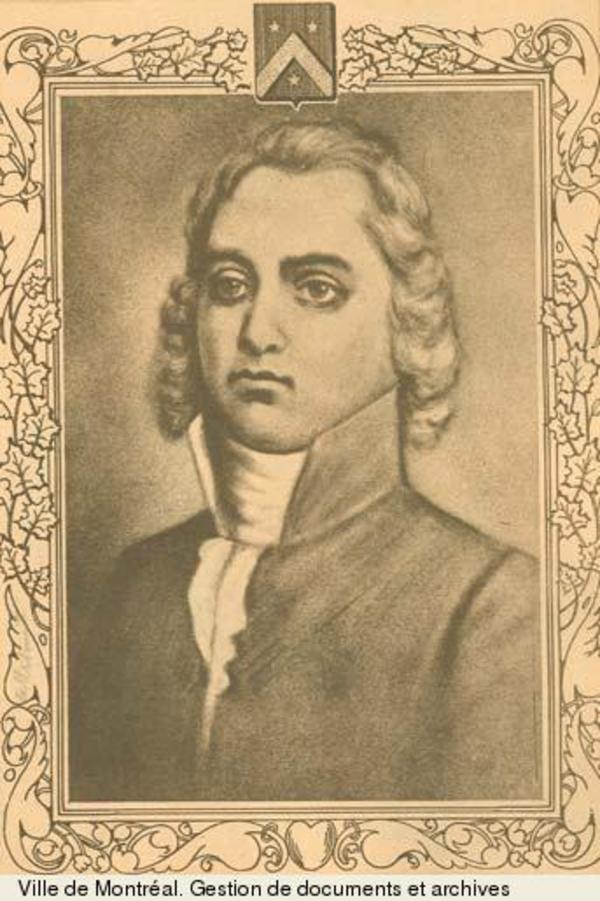
Provenance : Lien
AILLEBOUST DE COULONGE ET D’ARGENTENAY, LOUIS D’, « ingénieur versé dans le métier des armes », gouverneur et lieutenant général de la Nouvelle-France, né vers 1612 à Ancy-le-Franc, dans la province de Champagne, d’Antoine d’Ailleboust, conseiller ordinaire du prince de Condé, et de sa seconde femme, Suzanne Hotman, veuve de Jean de Manthet d’Argentenay, inhumé le 1er juin 1660 dans la paroisse Notre-Dame, à Montréal.
Son grand-père, Jean d’Ailleboust, fut l’un des premiers médecins de Henri IV, qui l’anoblit. Louis était le neveu de Charles d’Ailleboust, évêque d’Autun (et non d’Auxerre). Son grand-père maternel était le célèbre François Hotman, jurisconsulte, écrivain et ardent calviniste (1524–1590). Ægidius Fauteux nous apprend, en citant le Journal de voyage de Montaigne, que celui-ci, à « l’exemple de tous les autres savants et lettrés, [...] s’arrêta à Bâle [en Suisse, où s’était réfugié François Hotman] en 1580, pour lui rendre visite ».
Louis d’Ailleboust eut un frère, Nicolas, né du premier mariage de son père, et une sœur, Catherine, qui fut peut-être la fille de Suzanne Hotman. Nicolas fut le continuateur de la lignée, et c’est son fils qui fut le premier d’Ailleboust à faire souche au Canada. Catherine devint religieuse à l’abbaye de Saint-Pierre de Reims.
Louis d’Ailleboust, dont nous ne connaissons ni l’enfance ni la jeunesse, habitait en 1638 à Paris, rue de Bièvre, paroisse de Saint-Étienne-du-Mont. Il avait la réputation d’être un habile ingénieur militaire. Il comptait 26 ans. Le 6 septembre de la même année, il signait dans sa paroisse son contrat de mariage devant Me Philippe Perrier, à l’hôtellerie Aux deux Anges. Sa fiancée, Marie-Barbe de Boullongne, y logeait pour l’instant en compagnie de sa mère, née Eustache Quéan (Quen), veuve de Florentin de Boullongne, de Ravières, en Champagne. Comme cet endroit était tout près d’Ancy-le-Franc, place natale de Louis d’Ailleboust, le biographe Ernest Gagnon en a déduit que les fiancés étaient vraisemblablement des amis d’enfance.
Le jeune ménage s’installa à Paris, rue des Morfondus, dans le vieux quartier de Saint-Étienne-du-Mont. Trois ans plus tard, Barbe d’Ailleboust entendit son mari former devant elle d’étonnants projets d’avenir. Il brûlait du désir de s’en aller en Nouvelle-France travailler à la conversion des infidèles. On lui avait parlé d’une expédition prochaine ayant pour but la fondation d’un poste d’évangélisation dans l’île de Montréal. Une société de gentilshommes et de pieux ecclésiastiques était devenue propriétaire de l’île et veillait à l’embarquement et aux divers besoins d’une recrue dirigée par un brave et dévôt gentilhomme, Paul de Chomedey de Maisonneuve. Très délicate de santé, la jeune femme souffrait d’une maladie jugée incurable par les médecins. Elle ne pouvait certes songer à suivre son mari dans un pays aussi lointain et semé de périls.
Mais devant l’insistance de son époux, il lui vint à l’esprit de prier Dieu de lui rendre la santé. Elle promettait en retour d’accompagner son mari en Nouvelle-France et d’y partager ses travaux d’apostolat. Elle consulta son directeur. Il l’approuva entièrement. Ce jésuite n’était nullement étonné des perplexités, puis de la décision de la jeune femme, car il était aussi le confesseur et le confident de Louis d’Ailleboust. La guérison fut obtenue, selon un passage des Véritables motifs.
Louis d’Ailleboust hâta les préparatifs de voyage. Il apprit que la sœur aînée de sa femme, Philippine-Gertrude de Boullongne, accourue à Paris à la nouvelle de la guérison et du vœu extraordinaire de Barbe, se décidait, elle aussi, à partir pour le Canada.
Sur le conseil de son directeur, Louis d’Ailleboust rendit visite, accompagné de sa femme et de sa belle-sœur, au jésuite Charles Lalemant, procureur de la mission canadienne. Ayant été missionnaire en ce pays dès 1625, le religieux pouvait les renseigner sur ce que serait leur vie de colons et d’apôtres. Mais, avant tout, le père conseilla à ces recrues d’entrer dans la Société Notre-Dame de Montréal, ce qu’ils firent à la première occasion.
Louis d’Ailleboust et ses compagnes se rendirent à La Rochelle au printemps de 1643. Ils s’embarquèrent les derniers jours de mai sur l’un des trois vaisseaux partant pour la Nouvelle-France. Une recrue de 40 hommes s’y en allait afin d’apporter une aide vigoureuse au petit poste terriblement exposé de Montréal. La traversée fut longue, orageuse. Deux des navires n’arrivèrent à Québec que le 15 août suivant. On atteignit Ville-Marie en septembre.
En ce coin du pays, on vivait dans une attente anxieuse. Le gouverneur Huault de Montmagny, lors de la visite qu’il fit en juillet à M. de Maisonneuve et à ses colons, avait annoncé de bonnes nouvelles concernant les envois annuels de France. On pouvait en espérer beaucoup, car même le roi s’intéressait aux Montréalistes. M. de Montmagny lui-même avait reçu de lui une missive qui les lui recommandait de façon pressante. En plus, le roi leur offrait, pour leur colonie d’outre-mer, un navire de 350 tonneaux, la Notre-Dame.
L’arrivée de la recrue ramena dans les cœurs la confiance et la joie. M. de Maisonneuve avait grand besoin, pour la sécurité de tous, du secours d’un lieutenant tel que d’Ailleboust, d’un homme au courant des usages de la vie militaire. Et, ce qui était mieux encore, ce lieutenant serait bientôt l’habile ingénieur qu’il espérait, pouvant entreprendre les travaux de fortifications dont l’urgence s’imposait. Les Iroquois, depuis qu’ils avaient fait la découverte du petit poste, à la fin du printemps, ne cessaient de le harceler. Au mois de juin précédent, il y avait eu à Ville-Marie quatre morts et des blessés. De son côté, Jeanne Mance aurait maintenant auprès d’elle deux femmes agréables, charitables et sachant soigner les malades. Leur présence compenserait pour le départ imminent de Mme de Chauvigny de La Peltrie, rappelée à Québec, et de Charlotte Barré, sa dame de compagnie.
À Ville-Marie, Louis d’Ailleboust fit d’abord construire quatre bastions et remplacer par un solide mur d’enceinte la palissade de 1642. En outre, il conseilla fortement aux habitants de Ville-Marie de semer du bon blé français, car « la maigre récolte de pois et de blé d’inde » qu’il avait eue sous les yeux, à son arrivée à Montréal, ne suffisait vraiment plus aux besoins des colons, dont le nombre avait augmenté.
En 1645, M. de Maisonneuve dut partir pour la France et confia la direction du poste à M. d’Ailleboust, qui le remplaça de 1645 à l’été de 1647. À son retour de France, M. de Maisonneuve lui communiqua un message important et inattendu : la Compagnie des Cent-Associés, de même que la Société Notre-Dame de Montréal, le rappelait incontinent en France. En effet, on avait résolu de remplacer M. de Montmagny, après 11 ans de bons services comme gouverneur. Le Conseil du roi avait d’abord choisi M. de Maisonneuve comme successeur, mais ce dernier avait décliné l’offre en faveur de Louis d’Ailleboust, Ainsi, l’année suivante, d’Ailleboust reviendrait pourvu de sa commission. On imagine la satisfaction des Montréalistes. Un des colons distingués de Montréal allait devenir, à l’automne de 1648, le chef du pays.
D’importants changements accompagneraient du reste cette nomination. En effet, sur la recommandation de la Compagnie des Cent-Associés, Mazarin, qui avait nommé M. d’Ailleboust successeur de M. de Montmagny le 2 mars 1648, limitait la durée de son office à trois ans seulement. Cette décision affecterait tous les gouverneurs à venir. Conformément à l’édit du 5 mars 1648, le gouverneur inaugurerait, dès son entrée en fonction, la nouvelle administration coloniale. Désormais, il présiderait un conseil de cinq membres, dont les attributions s’étendraient à la discussion et au vote des lois locales, des affaires commerciales, des questions de paix et de guerre, des sentences judiciaires au civil et au criminel, des règlements de police et de finances. L’édit instituait également un camp volant composé de 40 soldats qui apporteraient un secours immédiat aux lieux menacés par les Iroquois. Le nouveau gouverneur allait donner le commandement de ce camp volant à son neveu, Charles-Joseph d’Ailleboust Des Muceaux, un jeune officier qu’il venait d’emmener de France.
Une existence débordante d’activité s’offrit à Louis d’Ailleboust dès son installation au château Saint-Louis, à Québec, dont la construction avait été commencée l’année précédente. Mme d’Ailleboust et sa sœur Philippine y entrèrent aussi après un séjour ininterrompu de cinq années à Ville-Marie.
M. d’Ailleboust mit beaucoup d’empressement à combattre les Iroquois. Il avait fait à Ville-Marie l’expérience douloureuse de cette guerre. En 1648 et 1649, ce fut la destruction presque totale des Hurons ; ce fut aussi l’ère des grands Martyrs jésuites. En 1650, Montréal fut durement et sans cesse assiégé ; le « livre des morts » s’ouvrait chaque jour. Les Montréalistes furent contraints de se réfugier au fort et d’y vivre « plus étroitement renfermés que dans les moindres monastères de France ». Pourtant, ce gouverneur prévoyant avait multiplié et redoublait sans cesse les gestes de secours. Le plus urgent comme le plus important de ses premiers actes administratifs avait été l’organisation du camp volant. Ce groupe de hardis militaires s’était mis en campagne dès le printemps de 1649. Il fut jugé d’une telle efficacité que le gouverneur décida, deux ans après, de porter son effectif à 70 hommes.
Dès la fin de mai 1649, M. d’Ailleboust se rendait à Ville-Marie. Il était accompagné de 12 soldats, escorte qui allait devenir régulière dans la suite. M. de Maisonneuve se porta au-devant de lui, en barque, et le rejoignit au courant Sainte-Marie. Le gouverneur annonça à M. de Maisonneuve que la Compagnie des Cent-Associés ajoutait six soldats à sa garnison particulière. Son traitement, en conséquence, était porté de 3 000 à 4 000#. Ces avantages avaient certes été demandés par M. d’Ailleboust, car c’était déroger à l’arrêt du 5 mars 1648. Durant son séjour en ce lieu, le gouverneur tint à mettre officiellement les Jésuites en possession de leur seigneurie de Prairie-de-la-Magdelaine.
En 1650, on songea en tous lieux à venir en aide à la nation huronne dont les derniers survivants, poursuivis et traqués par les Iroquois, semblaient voués au massacre. Les Hurons qui purent y échapper se réfugièrent en très petit nombre à Ville-Marie, poste trop exposé à la furie iroquoise. Durant l’été, plus de 300 Hurons arrivèrent à Québec sous la conduite du père Ragueneau. Ils furent secourus et nourris par le gouverneur, les Jésuites, les Hospitalières, les Ursulines et quelques autres personnes durant tout l’hiver 1650–1651. Des trois tribus huronnes descendues ainsi à Québec, une seule, celle de la Corde, ne voulut point, au printemps, quitter Québec, implorant la protection de M. d’Ailleboust et demandant à se fixer non loin du fort Saint-Louis. Les descendants de cette tribu se trouvent aujourd’hui à Lorette, près de Québec.
Vers la fin de l’année 1650, le gouverneur faisait ériger à Trois-Rivières de nouvelles fortifications. M. Gagnon a publié le document contenant les instructions très précises données en cette occasion par M. d’Ailleboust à Pierre Boucher*, commandant de la place. Ces fortifications, dues à la vigilance extrême du gouverneur envers tout ce qui pouvait entraver la marche sanguinaire des Iroquois, « sauva en effet le bourg d’une destruction complète lors de l’investissement de 1653 par cinq cents Agniers ».
On le voit, le militaire, l’ingénieur, l’architecte égalaient, chez M. d’Ailleboust, l’administrateur et le politique. Effectivement, c’est le politique qui tenta de reprendre les négociations amorcées en 1647 par son prédécesseur, M. de Montmagny, à l’effet de conclure avec les colonies de la Nouvelle-Angleterre un traité d’alliance offensive et défensive, en plus de l’union commerciale que désiraient les marchands de Boston, de Plymouth, du Connecticut et de New Haven. Mais comme M. d’Ailleboust jugeait que le traité commercial ne devait pas être signé sans que le fût aussi le traité militaire, les autorités de la Nouvelle-Angleterre hésitèrent, puis finalement se refusèrent à toute alliance à cause de la dernière condition du gouverneur. Ce fut un échec, mais la prudence de M. d’Ailleboust demeure louable. Il n’avait que trop de raisons de suspecter les intentions d’un voisin aux vues commerciales non sans égoïsme.
Le gouverneur aborda également la question de la traite de l’eau-de-vie avec les Amérindiens. Il donna des ordres sévères pour faire cesser ce trafic au poste de Tadoussac.
Trois années durant, Louis d’Ailleboust de Coulonge, deuxième gouverneur en titre de la Nouvelle-France, fit face avec une fermeté et une clarté de jugement peu communes à toutes les difficultés et à tous les périls. Les agissements des Iroquois ne le prirent jamais au dépourvu. Même quand ces ennemis parlaient de paix, il demeurait sceptique et se montrait encore plus vigilant. Il parvenait souvent à dépister leurs ruses et les combattait alors avec cette vaillance qui en imposait aux Amérindiens. Cette intrépidité de chef voilait cependant beaucoup d’angoisses ; car les secours de France devenaient chaque année nettement insuffisants. Aussi le père de Charlevoix* remarque-t-il avec raison qu’en remettant, le 13 octobre 1651, au nouveau et faible gouverneur Jean de Lauson, les rênes du gouvernement, « M. d’Ailleboût laissa sans regret une place, où il ne pouvoit être, que le témoin de la désolation de la Colonie, & dont on ne le mettoit point en état de soûtenir la Dignité ».
D’Ailleboust et sa femme se retirèrent en 1651 dans leur propriété de Coulonge, située à une lieue de Québec, et où l’on avait accès par ce qu’on appelait déjà la Grande Allée. Le gouverneur avait acheté la terre de Coulonge, le 17 octobre 1649, de Nicolas Gaudry, dit Bourbonnière. Il y bâtit une demeure et s’employa, les années suivantes, à agrandir et embellir son domaine. « Le nom de Coulonge, écrit Gagnon, était pour lui à la fois un nom de terre et un nom de famille. Louis d’Ailleboust est appelé « sieur de Coulonge » dans un acte passé en 1643, immédiatement avant son premier départ de France pour le Canada. Cet acte est conservé aux Archives de l’Hôtel-Dieu de Québec ».
Une fois rendu à la vie privée, M. d’Ailleboust ne cessa point sa vie publique. En 1652 et en 1653, le gouverneur de Lauson lui concédait, au nom de la Compagnie des Cent-Associés, le fief d’Argentenay et l’arrière-fief Saint-Vilmé. Argentenay était encore pour d’Ailleboust un nom de famille. Sa demi-sœur, fille du premier mariage de sa mère, s’appelait Dorothée de Manthet d’Argentenay et avait épousé Nicolas d’Ailleboust, frère aîné de Louis. Un petit village de Champagne portait aussi le nom d’Argentenay, et un autre bourg, non loin, celui de Saint-Vilmé.
En 1653, M. d’Ailleboust fut élu syndic et marguillier de la paroisse de Québec. En outre, de concert avec Jean-Paul Godefroy et Jean Bourdon, « il établit un poste de pêche à Percé, et y envoya un vaisseau avec instructions de transporter les produits du voyage à Saint Christophe aux Antilles. »
Il faut nous garder de croire que cet associé de Montréal se soit jamais désintéressé de l’œuvre de Ville-Marie. Il y séjournait souvent et logeait dans sa maison, élevée dans l’enceinte du fort. M. de Maisonneuve demeurait toujours le meilleur ami qu’il eût en Nouvelle-France.
Ce fut encore sous l’administration de M. de Lauson que Louis d’Ailleboust fut nommé directeur général de la traite des pelleteries en Nouvelle-France, « charge que rendaient particulièrement difficile, les intérêts oposés de la Grande compagnie et de la Compagnie des Habitants », créée en 1645.
En 1655, M. d’Ailleboust et son neveu Charles-Joseph accompagnèrent M. de Maisonneuve en France. Il s’agissait d’assurer, avec le secours de la Société Notre-Dame, la permanence de l’établissement de Ville-Marie, et « la réalisation des projets de M. Olier, touchant le côté spirituel aussi bien que le côté temporel de l’entreprise ». Le fondateur de la Compagnie de Saint-Sulpice, alors très malade, reçut néanmoins avec joie la visite de ses co-associés de Montréal. Il promit de s’occuper sur-le-champ du choix de quatre membres de sa compagnie pour « la desserte permanente de l’île de Montréal ».
M. d’Ailleboust dut prolonger de près de deux ans son séjour en France, tout comme M. de Maisonneuve. Quelques semaines avant qu’il s’embarque, la Compagnie des Cent-Associés remettait à d’Ailleboust des lettres patentes érigeant sa terre de Coulonge en fief et châtellenie, en reconnaissance de ses nombreux services.
Le 17 mai 1657, MM. de Maisonneuve, d’Ailleboust ainsi que trois sulpiciens sous l’autorité de l’abbé de Queylus [V. Thubières], premier supérieur de Saint-Sulpice à Montréal, montèrent, à Saint-Nazaire, sur le navire en partance pour le Canada. Les voyageurs, après une traversée orageuse, débarquèrent à l’île d’Orléans le 29 juillet. Au milieu d’août, les quatre sulpiciens, que les Jésuites avaient retenus comme hôtes quelques jours dans leur résidence, s’installaient à Ville-Marie.
Louis d’Ailleboust, qui avait suivi ses compagnons de voyage à Montréal, revint à Québec le 12 septembre (JJ (Laverdière et Casgrain), 220) où il avait été rappelé par Charles de Lauson de Charny, alors gouverneur intérimaire de la Nouvelle-France. Celui-ci, dans un document signé le 26 août 1657 (MSRC, XXVI (1932), sect. I : 91), lui avait remis les pouvoirs jusqu’à l’arrivée au pays du nouveau gouverneur, Pierre de Voyer* d’Argenson. Charles de Lauson, qui avait récemment perdu sa femme, désirait devenir prêtre et vivre dans une retraite absolue. C’était demander à M. d’Ailleboust « un acte de dévouement et d’abnégation » très pénible, car nul mieux que ce gentilhomme connaissait les terribles difficultés auxquelles il allait se mesurer de nouveau sans y apporter le moindre remède. M. d’Ailleboust reprit la lourde tâche du gouvernement. Ce ne furent en effet que pourparlers officiels, assemblées de notables, de Hurons et d’Algonquins, tous appelés en consultation. Puis, soudain, tout effort diplomatique cessait. La nouvelle parvenait à Québec qu’on massacrait au loin, dans les bourgades iroquoises, et même à Ville-Marie, tandis qu’on parlait hypocritement de paix au fort Saint-Louis. Heureusement, les 50 délégués iroquois alors en visite à Québec purent être arrêtés et emprisonnés, devenant ainsi de précieux otages contre les perfidies futures.
Le 13 mars 1658, M. d’Ailleboust, accompagné de l’abbé Vignal, posait, en qualité de gouverneur, la pierre angulaire de « l’église du Petit Cap » (aujourd’hui Sainte-Anne de Beaupré). Profitant de la circonstance, M. d’Ailleboust voulut surveiller lui-même la construction des redoutes s’élevant par son ordre sur la côte de Beaupré. Car, de plus en plus, les Iroquois parlaient de massacrer non seulement les Hurons et les Algonquins – sinistre besogne déjà accomplie – mais aussi tous les colons de la Nouvelle-France.
Un peu avant les cérémonies du Petit-Cap, M. d’Ailleboust dut rassurer les Hurons de la tribu de la Corde qui craignaient sans cesse que le gouverneur, cédant à la pression iroquoise, ne leur ordonne d’aller vivre auprès des Iroquois, qui promettaient solennellement de les traiter comme des frères. Le gouverneur fit donc ériger un petit fort où Hurons et Algonquins se réfugieraient sous la garde des canons du château Saint-Louis. On nomma cette construction, « de forme quadrangulaire dont chaque face avait une étendue de cent cinquante pieds, le fortin des Hurons ».
Le 11 juillet 1658, M. d’Ailleboust remettait les clefs du fort à d’Argenson, le nouveau gouverneur. Quelques semaines plus tard, n’ayant pu s’entendre avec ce haut titulaire, il partit pour Ville-Marie accompagné de sa femme, de l’abbé de Queylus et d’une soixantaine de colons.
Dès son arrivée, M. de Maisonneuve le priait de fortifier « le point culminant » du coteau Saint-Louis et de jeter les bases de la future citadelle de Montréal.
Il dut cependant retourner à Québec l’année suivante. Il désirait se trouver parmi les premiers à rendre hommage au premier évêque de la Nouvelle-France, Mgr François de Laval*, qui débarqua à Québec le 16 juin 1659. En septembre, M. d’Ailleboust séjournait encore dans la capitale, car on le vit, à la demande de l’évêque et du gouverneur, s’entremettre à l’amiable afin de régler une contestation qui s’élevait entre ceux-ci. Il s’agissait de la situation des bancs où prenaient place à l’église ces hauts personnages. M. d’Ailleboust s’en tira fort bien, à la satisfaction des deux parties.
Louis d’Ailleboust de Coulonge ne laissa aucun enfant. Il fut inhumé dans la paroisse Notre-Dame, à Montréal, le 1er juin 1660, au cimetière de l’hôpital qui s’élevait sur l’emplacement de la place d’Armes actuelle. Le blason de sa famille était de gueules au chevron d’or, accompagné de trois étoiles d’or, deux en chef, une en pointe.
AHDM, AHDQ (Papiers d’Ailleboust et autres documents), AJM, AJQ, APC, APQ, Archives du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, ASQ.— Charlevoix, Histoire de la N.-F.— Dollier de Casson, Histoire de Montréal.— JJ (Laverdière et Casgrain).— JR (Thwaites).— Morin, Annales (Fauteux et al.).— [Jean-Jacques Olier ?] Les véritables motifs de Messieurs et Dames de la Société de Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France, éd. H.-A. Verreau (« MSHM », IX, 1880).— Ord. comm. (P.-G. Roy), I : 10–12.— E. R. Adair, France and the beginnings of New France, CHR, XXV (1944) : 246–278.— A. Fauteux, La Famille d’Aillebout (Montréal, 1917).— Emest Gagnon, Feuilles volantes et pages d’histoire (Québec, 1910).— Amédée-E. Gosselin, Notes et documents concernant les gouverneurs d’Ailleboust, de Lauzon et de Lauzon-Charny, MSRC, XXVI (1932), sect. I :83–96.
Bibliographie de la version révisée :
Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de Montréal, CE601-S51, 1er juin 1660.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Marie-Claire Daveluy, « AILLEBOUST DE COULONGE ET D’ARGENTENAY, LOUIS D’ », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 9 févr. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/ailleboust_de_coulonge_et_d_argentenay_louis_d_1F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/ailleboust_de_coulonge_et_d_argentenay_louis_d_1F.html |
| Auteur de l'article: | Marie-Claire Daveluy |
| Titre de l'article: | AILLEBOUST DE COULONGE ET D’ARGENTENAY, LOUIS D’ |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1966 |
| Année de la révision: | 2014 |
| Date de consultation: | 9 févr. 2026 |