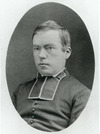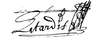Dugua de Monts et Champlain, ainsi que d’autres Français et 20 matelots, partirent, le 18
France entre 1643 et 1645, inhumé à Champlain le 28 octobre 1708.
Arrivé au pays en 1662 ou peu avant, en compagnie de ses parents et
-Associés pour assumer le commandement, advenant le décès de Champlain. Ses lettres de provision avaient été
décida d’attendre à Port-au-Mouton son second navire ; Ralluau et Champlain saisirent cette occasion pour
. Champlain rapporte une violente querelle au sujet de la religion entre le ministre et « nostre curé », qui se battirent à coups de poing. Ce « curé » était vraisemblablement
Champlain, « ses obseques furent celebrées avec toute la solemnité que l’état du païs le pouvoit permettre ». Il fut enseveli dans la chapelle de Québec
Le Caron et de Champlain, et arriva à Québec en juillet. Il demeura un an au couvent de
Du Gua de Monts et Champlain établirent dans l’île Sainte-Croix en 1604. On a dit qu’il
fiscal et greffier. Il sera aussi notaire et, à son premier acte connu, celui du 19 mars 1687, il s’intitule « notaire royal et garde-notes au Cap-de-la-Madeleine, Champlain, Batiscan et
Champlain, ne croyant pas son récit, arrêta le suspect, il le pria de bien traiter cet homme en attendant de nouvelles preuves. Erouachy passa l’hiver parmi les Abénaquis et, en avril 1629, il
Champlain qui, racontant les événements de 1629, écrivait de Pierre Raye, d’Étienne Brûlé et de Marsolet
.
Il était venu au Canada vers 1613, selon Champlain, qui, en 1628, parle de lui avec éloges. Couillard fut
bien possible qu’il y soit venu dès 1623. Dans ses Voyages, en effet, Champlain parle, cette année
. »
L’année suivante paraissait la première édition canadienne des Œuvres de Champlain. Cette édition que Laverdière mettait au point depuis 1864 serait, au dire de Narcisse-Henri-Édouard
.
Tôt en 1758, le gouvernement de la colonie confia à d’Olabaratz la tâche délicate d’assurer la défense navale du lac Champlain. Ce dernier supervisa alors la construction de trois chébecs avec le
Samuel de Champlain, qui agit dans ce voyage comme géographe et cartographe [V. Champlain
FLÉCHÉ, JESSÉ (aussi appelé Jossé Flesche (Biard), Josué Fleche (Champlain), Fleuchy
en compagnie de Champlain et du père Le Caron. Son séjour s’y prolongea quatre ans durant lesquels, tout
l’exemple de Champlain, adopte trois jeunes Amérindiens. En mai 1637, il obtient, conjointement avec Jean
Champlain. Elle épousa d’abord Claude Étienne, en 1640, puis Médard Chouart Des Groseilliers, le 3 septembre 1647. Charles