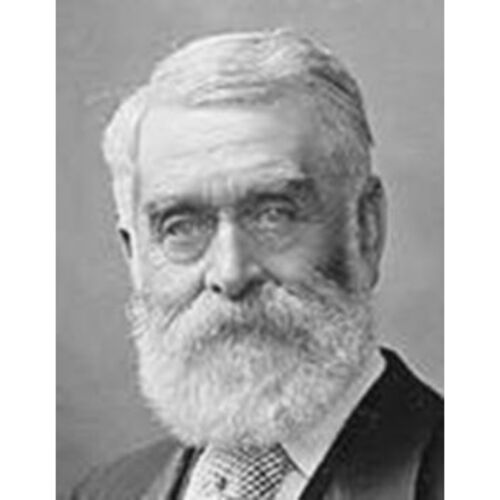Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons
WHITEWAY, sir WILLIAM VALLANCE, avocat et homme politique, né le 1er avril 1828 à Buckyett près de Totnes dans le Devon, Angleterre, fils benjamin de Thomas Whiteway et d’Elizabeth Vallance ; en 1862, il épousa Mary Lightbourne, des Bermudes (décédée en 1868), et ils eurent une fille, puis en 1872, Catherine Anne Davies, de Pictou, Nouvelle-Écosse, et ils eurent six enfants ; décédé le 24 juin 1908 à St John’s.
Comme les Whiteway étaient depuis longtemps liés au commerce avec Terre-Neuve, il n’est pas étonnant que le jeune William ait été envoyé dans cette colonie après des études à la Totnes Grammar School et dans une école privée de Newton Abbot. Arrivé à St John’s en 1843, il entra en apprentissage chez un marchand mais décida par la suite de faire son droit. Le barreau de Terre-Neuve l’admit en 1852.
Au début de sa carrière, William Vallance Whiteway présentait des traits on ne peut plus conformistes. Très lié à l’élite marchande, anglican actif, franc-maçon convaincu, il soutenait le Parti conservateur de Hugh William Hoyles* et tenait un cabinet d’avocat prospère. Parmi ses clients figurait Charles James Fox Bennett*, un des plus éminents marchands de la colonie et promoteur de sa première mine de cuivre, celle de Tilt Cove. Lorsque Whiteway entra en politique, en 1859, il se présenta sous le parrainage de Bennett dans le district de Twillingate and Fogo, où se trouvait Tilt Cove. C’est au cours de cette période qu’il acquit la conviction que Terre-Neuve avait un grand potentiel minier et agricole et qu’il se soucia, en tant que député d’une lointaine région nordique, de lui assurer de meilleures communications avec l’extérieur tout au long de l’année.
En 1865, Whiteway reçut des preuves tangibles de la reconnaissance du nouveau gouvernement conservateur de Frederic Bowker Terrington Carter* : le titre de conseiller de la reine et la présidence de la Chambre d’assemblée. Il était alors en pleine ascension, s’étant déclaré favorable au projet confédératif peu après la publication des Résolutions de Québec en décembre 1864. Bennett, principal porte-parole du camp adverse, était furieux de sa prise de position. Leurs prises de bec divertissaient les lecteurs de la presse de St John’s mais sapaient les chances de réélection de Whiteway. En 1869, Bennett et le négociant du district s’étant ligués contre eux, lui-même et son co-candidat subirent une cuisante défaite. L’année suivante, Bennett accéda au poste de premier ministre.
Whiteway appuyait la Confédération parce qu’il estimait qu’elle multiplierait les chances de la colonie de diversifier son économie et de prospérer, tout en brisant son isolement. Étant donné son ambition, il n’est pas exclu que la perspective d’évoluer sur une scène politique plus vaste l’ait aussi attiré. Cependant, une fois que les Terre-Neuviens se furent prononcés contre la Confédération, en 1869, il cessa de se faire le champion de cette cause et se concentra sur la politique coloniale. Bien que temporairement hors de l’Assemblée, il continuait de militer au Parti conservateur et appartenait à un groupe de pression déterminé à faire tomber le gouvernement Bennett coûte que coûte. À cette fin, les conservateurs proclamèrent qu’il n’était plus question de faire entrer Terre-Neuve dans la Confédération, tout en lançant des attaques sectaires contre le gouvernement destinées à rappeler aux protestants que Bennett s’appuyait sur le vote catholique. Au scrutin de 1873, la majorité de Bennett fut grandement réduite et Whiteway fut réélu, cette fois dans Trinity Bay. Au début de 1874, la majorité de Bennett ayant fondu, Carter redevint premier ministre. À l’automne, son parti fut reporté au pouvoir, et Whiteway devint solliciteur général.
Sa principale tâche consistait à préparer le plaidoyer que Terre-Neuve allait présenter devant la commission des pêches à Halifax en 1877 [V. sir Albert James Smith*]. Ce tribunal devait estimer la valeur vénale de l’écart entre les droits de pêche dont bénéficiaient les Américains dans les eaux de l’Amérique du Nord britannique en vertu du traité conclu à Washington en 1871 et ceux dont les sujets britanniques bénéficiaient dans les eaux américaines. Whiteway prit part à l’élaboration du dossier et le défendit habilement devant le tribunal. Il réclamait une indemnité de 2 880 000 $ pour la colonie. Elle obtint finalement un million de dollars, ce qui valut à Whiteway des remerciements officiels et le titre de chevalier en 1880. Son argumentation reposait en grande partie sur la valeur que représentait l’accès aux réserves d’appât de Terre-Neuve pour les flottes de grande pêche étrangères. À compter de ce moment, il considéra que l’appât pouvait être un argument puissant non seulement dans les négociations avec les États-Unis mais aussi avec les Français, dont la présence à Saint-Pierre ainsi que sur le littoral ouest et nord-est de Terre-Neuve (région connue sous le nom de côte française) ne cessait d’irriter les Terre-Neuviens. Tant Whiteway que Carter étaient convaincus que la prospérité de la colonie dépendait de la modification des droits ancestraux de la France, surtout depuis que les levés d’Alexander Murray* laissaient supposer la présence, sur la côte française, d’importantes richesses naturelles. Le gouvernement Carter réclamait le pouvoir de nommer des magistrats rémunérés et d’accorder des concessions foncières sur cette côte, exigences auxquelles le ministère des Colonies réagissait avec une extrême prudence.
Whiteway était si mécontent que, au grand dam du gouverneur sir John Hawley Glover*, il lança des allusions aux inconvénients du lien impérial et aux avantages possibles de l’annexion aux États-Unis. Ce faisant, il ne voulait probablement que rappeler à Londres l’insatisfaction de la colonie. Selon lui, le gouvernement britannique n’était que trop disposé à sacrifier les intérêts de Terre-Neuve à ceux de pays plus puissants, et tout au long de sa carrière, il allait exprimer son ressentiment à ce sujet.
En avril 1878, Whiteway devint premier ministre. Il était déterminé à faire impression et voyait grand. Si l’avenir de Terre-Neuve reposait sur la mise en valeur des ressources terrestres, deux choses s’imposaient. D’abord, il fallait construire un chemin de fer qui traverserait l’île afin de briser l’isolement de l’intérieur. Ensuite, il fallait conclure avec la France une entente qui permettrait le développement industriel de la côte ouest. Whiteway voulait aussi que St John’s devienne un port de première importance et préconisait d’y construire un grand bassin de radoub. Pour réaliser ces projets, Terre-Neuve avait besoin de la collaboration du gouvernement impérial, qui seul pouvait traiter avec la France et qui, espérait-on, contribuerait à la construction du chemin de fer et du bassin pour des raisons stratégiques. Whiteway alla défendre sa cause à Londres en 1879. Le ministère des Colonies lui prêta une oreille attentive, ne fût-ce que parce qu’il se montrait moins intransigeant que bien des Terre-Neuviens sur la question de la côte française. Au cours d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères de France, il impressionna l’ambassadeur de Grande-Bretagne par sa « compétence, [son] tact, [sa] modération même ». Mais cette rencontre ne déboucha sur rien de concret, et le gouvernement britannique refusa son aide pour la construction du bassin et du chemin de fer sous prétexte que ces ouvrages étaient de portée coloniale et non impériale.
Londres finit quand même par faire quelques concessions. En 1881, le gouvernement colonial obtint le droit exclusif de nommer des magistrats rémunérés sur la côte française et fut autorisé à y accorder des concessions foncières à titre conditionnel. Au moment du scrutin de 1882, les colons de la côte ouest purent voter. Ce processus d’intégration de la côte dans la structure administrative de la colonie avait commencé sous le gouvernement Carter, et Whiteway aurait aimé le compléter en reliant les deux côtés de l’île par un chemin de fer. Mais le gouvernement britannique, outre qu’il refusait toute assistance financière, hésitait à permettre l’installation d’un terminus sur la côte ouest. Whiteway se résigna donc à proposer de construire un chemin de fer sur la côte est, espérant que, un jour ou l’autre, cette ligne pourrait faire partie d’un réseau transinsulaire. En 1880, son projet qui consistait à relier St John’s et la baie de Halls par un chemin de fer à voie étroite fut accepté. On lança les appels d’offres, on entreprit des levés en vue de déterminer le tracé, et un vif débat public éclata, présage de nouvelles dissensions politiques. Les premières critiques vinrent des rangs conservateurs, donc des partisans mêmes de Whiteway. Quelques-uns des plus gros marchands de poisson exprimèrent en effet de sérieuses réserves à propos de cette « expérience si nouvelle, si coûteuse, si contraire à [leurs] habitudes ordinaires et à [leurs] besoins et, en même temps, si irrémédiable dans ses résultats, bons ou néfastes ». Ils craignaient que l’entreprise mène la colonie à la faillite et à la Confédération, et affecte gravement leurs affaires entre-temps.
Whiteway et ses partisans favorables au chemin de fer ne s’inquiétaient pas outre mesure, car ils pouvaient compter sur l’appui de l’opposition libérale, alors dirigée par Joseph Ignatius Little. Dès le début de 1881, le gouvernement étudiait deux soumissions. Whiteway défendait celle qu’Albert L. Blackman avait présentée au nom d’un syndicat new-yorkais alors qu’Ambrose Shea, libéral influent, soutenait le soumissionnaire canadien. Le gouverneur Glover et d’autres soupçonnaient Whiteway de se trouver en conflit d’intérêts. Les capitalistes de Blackman, disaient-ils, étaient ceux-là mêmes qui, peu de temps auparavant, avaient financé la création de la Newfoundland Consolidated Copper Mining Company, dont Whiteway était l’un des administrateurs locaux et qui tirerait profit du chemin de fer. Niant ces accusations avec véhémence, le premier ministre expédia l’adoption de la soumission de Blackman au cabinet, puis à l’Assemblée, non sans provoquer de houleux débats qui cristallisèrent les nouveaux alignements politiques. Les marchands l’ayant piqué par une pétition contre le chemin de fer, il se fit populiste en promettant de « hisser la classe ouvrière à sa juste place dans le corps politique ».
Le syndicat de Blackman, sous le nom de Newfoundland Railway Company, commença les travaux en 1881. L’année suivante, il conclut deux autres ententes avec le gouvernement. La première lui donnait une charte qui l’autorisait à construire, d’un bout à l’autre de l’île, une ligne directe de largeur normale qui ferait partie de la « Short Line », réseau reliant Montréal aux ports de l’Atlantique. En vertu de la seconde, il construirait un bassin de radoub à St John’s. Les débats qui précédèrent les élections de 1882 portèrent essentiellement sur ces trois marchés de grande envergure. Les conservateurs de Whiteway, maintenant officiellement alliés aux libéraux, clamaient les mérites de la nouvelle « politique du progrès ». En face d’eux, ils avaient l’informe New Party de James Johnstone Rogerson. Exclusivement protestant et voué aux intérêts des marchands, ce parti s’efforçait de convaincre les électeurs que les orientations de Whiteway étaient peu sages et dangereuses. Il échoua, et Whiteway récolta une imposante majorité. Sa position semblait inexpugnable.
Pourtant, son deuxième ministère allait s’écrouler moins de trois ans plus tard. Il s’avéra que les capitaux et l’efficacité faisaient défaut au syndicat de Blackman. Dès la fin de 1882, la compagnie de chemin de fer connaissait des difficultés financières ; au printemps de 1884, la construction de la ligne principale fut interrompue ; la faillite suivit de près. Le marché de construction du bassin fut transféré à un autre entrepreneur et la ligne directe ne fut jamais mise en chantier. En plus, la colonie entrait dans une période de profonde crise économique. Le New Party se mobilisa en vue d’une attaque concertée, affirmant qu’il fallait suspendre les travaux onéreux, dont le chemin de fer, et s’occuper en priorité du secteur des pêches, aux prises avec une rude concurrence sur les marchés européens de poisson salé. Convaincu que ce problème provenait en grande partie de l’expansion de la pêche étrangère subventionnée sur le Grand Banc, le New Party préconisait de porter un coup aux terre-neuvas français en interdisant l’exploitation de l’appât en provenance de la côte sud de l’île. Whiteway, par contre, estimait toujours que la mise en valeur de l’intérieur et de la côte ouest comptait davantage et que mieux valait s’entendre avec la France que lui livrer une guerre économique. D’ailleurs, dès 1883–1884, le gouvernement Whiteway et le ministère des Colonies discutaient d’une entente en vertu de laquelle la France desserrerait son emprise sur la côte française en échange de l’accès à l’appât terre-neuvien. Par la suite, la France accepta un projet de convention qui allait dans ce sens. Pour le New Party, c’était une politique suicidaire. Ses dirigeants mobilisèrent donc l’opinion protestante contre la dépendance de Whiteway par rapport au soutien catholique.
La chose fut d’autant plus facile que l’émeute survenue à Harbour Grace en décembre 1883 avait exacerbé les tensions religieuses. Dix-neuf catholiques furent arrêtés et inculpés du meurtre de quatre orangistes. Leur acquittement à l’issue de deux procès au cours desquels Whiteway représenta la couronne fit voler en éclats la coalition conservatrice-libérale. Au début de 1885, les députés orangistes déposèrent un amendement qui qualifiait ces procès de « honteux déni de justice ». Dès lors, deux mobiles guidèrent la conduite de Whiteway : sa volonté de surnager et son anticatholicisme latent. Apparemment, il jugea que la meilleure chance de s’en tirer était de larguer ses partisans catholiques et de se proposer comme chef d’un parti protestant unifié. Il rédigea donc un amendement qui évitait de critiquer la Cour suprême mais contenait des formules offensantes pour les catholiques. Ses partisans catholiques – dont Shea et Robert John Kent* – passèrent dans l’opposition, sans qu’il parvienne pour autant à rallier tous les protestants autour de lui. Il y eut plutôt une série de tractations et de compromis qui débouchèrent sur la formation du Parti réformiste et sur la nomination, comme moyen terme, de Robert Thorburn à sa tête. Whiteway démissionna de son poste de premier ministre au début d’octobre 1885 en acceptant de ne pas se présenter aux élections suivantes à la condition d’avoir un siège au Conseil législatif et le poste de juge en chef. Beaucoup lui reprochèrent d’avoir abandonné son parti et de ne pas avoir eu le courage de se porter candidat. Ces critiques n’étaient pas dénuées de fondement, mais il faut se rappeler que, à l’automne de 1885, Whiteway était isolé politiquement et que faire campagne ne lui aurait pas apporté grand-chose.
Whiteway n’accéda ni au tribunal ni à la Chambre haute, et il se mit bientôt à piaffer en coulisse. Pourtant, il ne semblait pas vraiment résolu à retourner tout de suite sur la scène publique. En juillet 1887, Robert Bond* et Alfred Bishop Morine*, qui siégeaient dans l’opposition à titre de whitewayistes indépendants, le sommèrent de se décider. S’il ne refaisait pas de politique active, ils chercheraient d’autres alliés ou tireraient leur révérence. En septembre, il annonça son retour.
Bond espérait que Whiteway prendrait la direction d’un parti revivifié, mais le Néo-Écossais Morine, porté aux intrigues, tenait davantage à obtenir son acquiescement à une combine dont le but était de faire entrer Terre-Neuve dans la Confédération. Poussé par Morine, sir Charles Tupper* se rendit à St John’s en octobre 1887 et discuta de la question tant avec le gouvernement Thorburn qu’avec Bond et Whiteway, qui tous deux, apparemment, se montrèrent favorables à l’idée. On espérait qu’une coalition regroupant le parti de Whiteway et l’aile confédératrice du Parti réformiste, aile dont le membre le plus éminent était James Spearman Winter*, pourrait convaincre la colonie d’entrer dans le dominion. Le complot s’écroula en 1888 : Bond conclut que le parti ne ferait pas preuve de sagesse en s’associant à la Confédération et pressa Whiteway de résister à l’influence de Morine. Tupper dit à sir John Alexander Macdonald* que, en changeant d’avis, Whiteway avait porté un coup fatal à la cause. Certes, son revirement avait beaucoup nui, mais on ne saurait y voir l’unique raison de l’échec du plan. Peu d’hommes politiques terre-neuviens étaient prêts à risquer leur carrière pour réaliser l’union avec le Canada.
Whiteway aurait pu se présenter à une élection complémentaire à l’automne et retourner à l’Assemblée. Il choisit plutôt de s’employer à bâtir un parti en prévision du scrutin de 1889. Comme le vieux Parti libéral catholique avait finalement rendu l’âme en 1886, Whiteway reprit l’étiquette libérale. Néanmoins, le manifeste et les slogans provenaient en droite ligne des campagnes conservatrices de 1878 et de 1882. « Votez pour l’ami de l’ouvrier et l’apôtre du progrès », clamait l’Evening Telegram. Le Parti libéral mena une campagne attrayante en promettant d’achever le chemin de fer ; le gouvernement réformiste était impopulaire. Whiteway remporta donc une belle victoire. C’était la première fois que des élections générales se faisaient au scrutin secret à Terre-Neuve. Selon des gens de l’époque, cette méthode favorisa l’expression d’un préjugé de classe que les libéraux attisèrent en tirant à boulets rouges sur les marchands.
Le scrutin eut lieu au début de novembre, mais la passation des pouvoirs se fit plus d’un mois après. Le parti et le cabinet de Whiteway se composaient d’hommes assez peu chevronnés – lui seul avait occupé un poste dans l’exécutif – et lui-même n’avait plus l’énergie ni l’autorité d’antan. L’effondrement de son précédent gouvernement et les années qu’il avait passées hors de la politique active l’avaient rendu opportuniste, semble-t-il. Il avait tendance à se reposer sur ses collègues, par exemple Bond et Augustus William Harvey. En plus, son parti était porté aux luttes de factions. Le gouvernement manquait donc de résolution, surtout dans les affaires extérieures délicates. Depuis que le New Party avait rejeté le projet de convention négocié par Whiteway et que le Bait Act de 1887 était entré en vigueur [V. Robert Thorburn], la côte française était un brandon de discorde. La grande question était alors de savoir si les pêcheurs français – ou n’importe quels pêcheurs, en fait – avaient le droit de prendre des homards sur cette côte et de les y mettre en conserve. S’appuyant sur son expérience, le gouvernement britannique escomptait que Whiteway serait plus conciliant que ses prédécesseurs, mais il se montra aussi entêté, et ce pour deux raisons. D’abord, Bond et Harvey étaient très puissants dans le parti, et tous deux s’opposaient à ce que d’autres concessions soient faites aux Français. Ensuite, Whiteway devait compter avec les déclarations chauvines de la Patriotic Association, formée expressément par le Parti réformiste pour embarrasser le nouveau gouvernement à l’occasion de la signature d’une entente entre l’Angleterre et la France sur la pêche au homard, en mars 1890 – entente qui, sous sa forme définitive, n’avait pas reçu l’approbation de la colonie et semblait faire des concessions à la France. La situation se compliqua lorsqu’on se rendit compte qu’aucune loi n’habilitait le gouvernement britannique à appliquer les traités relatifs à la côte française.
Le ministère des Colonies tenta de persuader Terre-Neuve d’adopter un projet de loi à cette fin, mais toute chance de coopération s’évanouit quand, cédant aux pressions du Canada, le gouvernement britannique refusa de sanctionner un projet de traité de réciprocité négocié par Bond avec les États-Unis dans les derniers mois de 1890. Whiteway n’avait jamais été un champion du libre-échange, mais il joignit sa voix à la clameur furieuse qui s’éleva de St John’s, et son gouvernement riposta en refusant de délivrer aux bateaux canadiens des permis d’approvisionnement en appât.
Les Canadiens réagirent à leur tour en évoquant de nouveau l’entrée de Terre-Neuve dans la Confédération [V. George William Howlan], mais en vain. De son côté, le gouvernement impérial s’apprêtait à adopter une loi qui ferait entrer en vigueur les traités avec la France. Dès qu’elle apprit la nouvelle, l’Assemblée terre-neuvienne s’empressa d’envoyer une délégation à Londres afin d’empêcher l’adoption de ce qu’à Terre-Neuve on désignait du nom évocateur de « loi coercitive ». Le 23 avril 1891, Whiteway, chef de la délégation, prononça devant la Chambre des lords un discours habile qui, de toute évidence, fut bien accueilli. Il proposait d’adopter une mesure temporaire pour la saison de 1891 et de déterminer entre-temps la teneur d’une loi permanente. Même si à St John’s, où Bond multipliait les appels au patriotisme, l’Assemblée ne se laissa pas facilement convaincre que c’était le meilleur compromis possible, la proposition finit par être acceptée. Néanmoins, le différend entre Terre-Neuve et le Canada n’était pas réglé, et en décembre 1891, les deux voisins se lancèrent dans une guerre tarifaire.
Si le discours de la Chambre des lords fut l’un des plus beaux moments de la carrière de Whiteway, la session de 1892 lui infligea ce qui fut probablement sa pire humiliation. Après avoir passé la plus grande partie de l’été de 1891 à négocier, à Londres, un avant-projet de loi permanente, il se heurta à son cabinet, qui refusait d’adopter ce texte au nom du gouvernement tout autant que du parti. Abandonné par ses collègues et par tous les membres de la délégation de Londres sauf Harvey, Whiteway dut présenter le projet en son propre nom. Les députés le rejetèrent sous prétexte qu’il faisait trop de concessions à la France et donnait un caractère définitif à une situation que, dans l’intérêt de la colonie, on devait pouvoir modifier. Whiteway eut beau rappeler à la Chambre qu’elle s’était engagée à adopter une loi permanente et la prévenir que, si elle persistait dans son intransigeance, le gouvernement impérial n’accepterait pas de garantir à Terre-Neuve un prêt de développement, on ne l’écouta pas. Whiteway ne pardonna jamais à Bond son rôle déterminant dans cette affaire.
Whiteway dut donc éprouver quelque morne satisfaction en voyant, au cours de cette même session de 1892, la fin de la politique revancharde de Bond à l’endroit du Canada. Le dominion et la colonie acceptèrent de revenir à la situation telle qu’elle existait avant sa modification en attendant d’en discuter au cours d’une conférence. Toutefois, la réunion tenue à Halifax en novembre 1892 ne fut guère fructueuse. Les représentants de Terre-Neuve, sous la direction de Whiteway, refusèrent d’aborder la question de la Confédération ; les Canadiens continuèrent de s’opposer à ce que Terre-Neuve négocie un traité distinct de réciprocité avec les États-Unis. En somme, Terre-Neuve apprit que, en matière d’affaires extérieures, sa politique serait subordonnée aux intérêts canadiens aussi bien qu’impériaux. Whiteway trouva la pilule amère.
Pourtant, en dehors des hauts milieux politiques, on ne s’intéressait guère aux subtilités des affaires extérieures. Ce qui comptait bien davantage pour la masse des électeurs, c’était que la construction du chemin de fer avait repris, comme l’avait promis le gouvernement Whiteway. En 1890, il avait conclu un marché avec le Montréalais Robert Gillespie Reid en vue de l’achèvement de la ligne qui devait mener à la baie de Halls. En 1893, il en conclut deux autres avec lui : l’un prévoyait que le chemin de fer serait prolongé jusqu’à Port-aux-Basques, sur le littoral ouest, et l’autre, que Reid exploiterait le réseau durant dix ans. La reconstruction de St John’s après l’incendie de 1892 (qui avait détruit le cabinet d’avocat de Whiteway) contribua aussi au maintien de taux d’emploi assez élevés. S’il surmontait ses déchirements internes et faisait front commun, le gouvernement était donc en position de remporter les élections de 1893. Comme Whiteway était populaire auprès des électeurs, personne ne contestait son leadership. La campagne fut coûteuse et dure, mais les libéraux l’emportèrent haut la main.
Les tories de l’opposition avaient alors Morine pour stratège. Au début de 1894, ils passèrent à l’offensive en intentant des poursuites pour corruption contre Whiteway et 16 autres libéraux. À l’issue de l’audition de la première cause, deux députés furent invalidés parce qu’ils avaient tripoté des fonds publics pour influencer les électeurs. Whiteway était indigné que le tribunal ait jugé corrompue une pratique courante et entrevoyait que tous les accusés risquaient de perdre leur siège. Il demanda donc au gouverneur, sir John Terence Nicholls O’Brien, d’accepter soit la dissolution, soit un projet de loi d’amnistie pour les accusés. Comme O’Brien refusait d’intervenir, le gouvernement Whiteway démissionna le 11 avril. Un gouvernement minoritaire tory dirigé par Augustus Frederick Goodridge prit la relève. L’Assemblée fut prorogée pour une période indéfinie même si les subsides n’avaient pas été votés, et la justice suivit son cours.
Pendant quelques mois, Whiteway se montra si peu digne que, selon O’Brien, on murmurait que « la rage et la rancune » lui avaient fait « perdre la raison ». À la mi-juin, on le vit à la tête d’un foule criarde qui défilait dans la rue Water, à St John’s, parce que les droits de douane continuaient d’être perçus même si la loi des subsides était arrivée à échéance. Seule l’arrivée de policiers à cheval empêcha une explosion de violence, mais après cet incident, le climat politique s’apaisa. Le gouvernement perdit la majorité qu’il avait acquise à la fin des procès d’élections, car les scrutins complémentaires de l’automne se soldèrent par une victoire des candidats libéraux (non pas ceux qui avaient été invalidés, dont Whiteway, puisqu’il leur était interdit de siéger durant cette législature). Les tories tinrent le coup jusqu’en décembre, puis démissionnèrent après la faillite des deux banques de la colonie [V. James Goodfellow*]. Daniel Joseph Greene forma un gouvernement libéral qui présenta une loi habilitant les députés invalidés à se présenter à nouveau. Une fois que le gouverneur, humilié, eut approuvé cette loi, Greene démissionna. Dès le 8 février 1895, Whiteway était de nouveau à la tête du gouvernement. Par la suite, il se trouva un siège vacant dans Harbour Grace.
Terre-Neuve se trouvait dans une situation désespérée. L’effondrement bancaire avait désorganisé le commerce, temporairement mais gravement, et les coffres du gouvernement étaient presque à sec. Incapable d’obtenir un emprunt et refusant de se soumettre à l’enquête d’une commission royale – préalable à toute aide impériale – le gouvernement Whiteway dépêcha une délégation à Ottawa à la fin de mars pour discuter de la Confédération. Elle était dirigée par Bond, car Whiteway souffrait, semble-t-il, de « dépression nerveuse grave et [de] complications internes » dues à la tension intellectuelle et au surmenage, ce qui n’était guère étonnant, vu les événements de l’année précédente et le fait qu’il avait perdu 26 000 $ dans la débâcle bancaire. La parcimonie de la Grande-Bretagne et la prudence du Canada firent échouer les négociations. Finalement, dans l’espoir d’éviter la déroute complète et l’intervention impériale, Bond se rendit à Montréal afin de solliciter un emprunt. Avec l’aide de Robert Gillespie Reid, il réussit ce qui, de l’avis de bien des gens, était impossible. Grâce à ce coup de maître, il était assuré de succéder à Whiteway, alors âgé de 67 ans.
La position politique du gouvernement libéral se détériora dans les deux années suivantes. La situation économique demeurait difficile ; inventorier les conséquences de l’effrondrement bancaire s’avérait long et controversé. Les doyens du parti étaient divisés, le nouveau gouverneur, sir Herbert Harley Murray, était hostile. C’était comme si le cœur n’y était plus. Pendant que Whiteway assistait à Londres aux célébrations du jubilé de diamant de la reine et à la Conférence coloniale, en 1897, Bond et Edward Patrick Morris* ne firent presque rien en prévision des élections de l’automne. Les libéraux employèrent donc sensiblement la même propagande que dans les campagnes précédentes. Les électeurs, cette fois, en avaient assez. Le chemin de fer était presque terminé, le prix du poisson était à son plus bas depuis 45 ans et, lorsqu’ils entendaient les libéraux promettre une Terre-Neuve renouvelée, ils n’y croyaient plus. Les tories de James Spearman Winter, eux, firent une campagne pleine d’imagination et remportèrent une confortable majorité. Whiteway fut battu dans sa vieille circonscription de Trinity Bay.
II ne se retira pas avec grâce et dignité, mais demeura chef en titre du Parti libéral jusqu’en octobre 1899. Bond, qui avait dirigé le parti à la Chambre, prit alors la succession dans des circonstances obscures : certains prétendaient que le vieil homme était parti de son plein gré, d’autres, qu’il avait été évincé. Quoi qu’il en soit, une fois que Bond fut devenu premier ministre, en 1900, Whiteway ne tarda pas à ouvrir les hostilités. Il intenta une poursuite de 21 000 $ au gouvernement pour divers services rendus au fil des ans et, en novembre 1901, il fit connaître son intention de revenir sur la scène publique. Le fait qu’il soutint un candidat tory à une élection complémentaire en 1902 annonçait qu’il allait s’opposer au gouvernement. Il prétendait que c’était en raison de la façon dont Bond avait procédé à la révision de l’impopulaire marché ferroviaire négocié par Winter et Morine avec Reid en 1898, mais on peut difficilement éviter de conclure qu’il était mû par un profond ressentiment envers Bond et son ancien parti. Il s’en prit aux conditions de l’entente de 1904 sur la côte française et à la politique forestière de Bond. Incapable de s’entendre avec les autres groupes d’opposition, il s’apprêta à diriger un parti indépendant aux élections de 1904. Finalement, il appela ses partisans à se joindre à ceux d’autres hommes politiques pour former le United Opposition Party, qui présenta plusieurs anciens premiers ministres. Le parti fut battu, ainsi que tous les ex-premiers ministres. Quant à Whiteway, il se classa dernier dans Harbour Grace, ce qui était une triste fin de carrière.
Des événements tragiques marquèrent aussi sa vie privée. En 1899, la fille qui était née de son premier mariage était morte en Afrique du Sud, et il s’était rendu là-bas pour ramener sa dépouille. De 1905 à 1908, il perdit aussi trois des six enfants de son second mariage. Il s’éteignit en 1908 à l’âge de 80 ans, après un demi-siècle de vie publique et 14 ans à titre de premier ministre, record inégalé parmi les hommes politiques terre-neuviens d’avant la Confédération.
Jusqu’au déboulonnement des rails en 1989, le Newfoundland Railway fut le principal monument qui rappelait la carrière de William Vallance Whiteway. Construire un chemin de fer qui donnerait accès à l’intérieur de la colonie afin que Terre-Neuve puisse mettre en valeur ses ressources terrestres et, ainsi, diversifier son économie, fut l’un des leitmotivs de sa carrière. La détermination avec laquelle il tint tête à ceux, nombreux, qui étaient hostiles ou sceptiques, fit en sorte que le chemin de fer fut construit et que St John’s eut un premier bassin de radoub. Dans le même ordre d’idées, il voulait, à propos de la côte française, une nouvelle entente qui permettrait le développement économique du littoral ouest. Avec beaucoup d’habileté, il obtint des concessions de Londres et prit part à la négociation du projet anglo-français de convention de 1885. Mais, vers cette année-là, sa politique fut vaincue par la crise où s’engouffra Terre-Neuve durant les deux dernières décennies du xixe siècle, et dès lors, il fut un chef moins sûr de lui. La dissension régna dans ses gouvernements, et on lui reprocha souvent sa faiblesse. Au début des années 1890, il aurait aimé quitter la politique pour devenir juge en chef ou gouverneur colonial. On ne lui offrit cependant aucun de ces postes et, hésitant à se retirer de la politique pour redevenir simple avocat, il s’accrocha jusqu’à connaître une humiliante défaite et une vieillesse pleine d’amertume. Certains prétendaient qu’il restait parce que la politique lui donnait la possibilité de gagner de l’argent (accusation étayée par le fait que, malgré les pertes subies dans la faillite bancaire, il laissa une succession évaluée en 1908 à 76 000 $) et parce qu’il aimait les acclamations de la foule. C’est possible. Pourtant, il ne faudrait pas oublier que Whiteway entretenait une vision sincère, quoique exagérement optimiste, de l’avenir de Terre-Neuve et que, derrière l’amer personnage public des dernières années, il y avait un homme que l’on aimait beaucoup pour son charme, son humour et sa sociabilité, et pour son long dévouement à l’Église anglicane et à la franc-maçonnerie. Whiteway n’était pas de ces avocats ni de ces hommes politiques qui impressionnent par leur éclat, et ses ambitions dépassaient ses aptitudes. Néanmoins, il laissa sa marque dans l’histoire de Terre-Neuve, ne serait-ce que parce qu’il fut le premier à formuler des visions de prospérité future que reprirent par la suite beaucoup d’hommes politiques, notamment Joseph Roberts Smallwood*, qui de toute évidence se situait dans la tradition libérale inaugurée par Whiteway.
Un recueil des observations de Whiteway réimprimé à partir de journaux a été publié à St John’s vers 1904 sous le titre de Duty’s call ; Sir William Vallance Whiteway states his position.
AN, MG 26, D, Monroe à Middleton, 1892.— Arch. du ministère des Affaires étrangères (Paris), Corr. consulaire, corr. politique, Terre-Neuve, II : 178 (mfm aux AN).— Arch. privées, papiers de sir Robert Bond, Bond et Morine à Whiteway, 25 juill. 1887 ; Bond à Whiteway, 30 août 1888 ; Morris et Horwood à Bond, 29 juin 1895 ; R. E. P. Cecil, 6e marquis de Salisbury (Hatfield, Angleterre), papiers de R. A. T. Gascoyne-Cecil, 3e marquis de Salisbury, Salisbury à Lyons, 17 juill. 1879 ; Lyons à Salisbury, 4 août 1879.— British Library (Londres), Add. ms 43556 (papiers Ripon) : 143.— Centre for Newfoundland Studies, Memorial Univ. of Nfld (St John’s), Arch., COLL–26 (papiers W. V. Whiteway.— Maritime Hist. Arch., Memorial Univ. of Nfld, Keith Matthews coll., Ser. I, Whiteway name file.— PANL, GN 1/3/A, note by Carter, 24 nov. 1885.— PRO, CO 194/191–227 ; PRO 30/6, 37 : 375.— Supreme Court of Newfoundland (St John’s), Registry, Probate records for W. V. Whiteway.— Colonist (St John’s), 22 sept. 1887.— Courier (St John’s), 10, 17 mars, 17 avril 1860.— Daily News (St John’s), 23 nov. 1901, 25 juin 1908.— Day-Book (St John’s), 4, 7 mars 1865.— Evening Herald (St John’s), 28 janv., 3 mai, 30 oct. 1899, 11 août 1900.— Evening Telegram (St John’s), 21 mars 1895, 27 juin 1908.— Morning Chronicle (St John’s), 9–15 nov. 1865, 13 févr. 1869.— Newfoundlander, 15 déc. 1859 ; 2 févr., 13 avril, 20 juill. 1865, 1er, 5 févr. 1866.— Newfoundland Express (St John’s), 19 avril 1862, 10 mars 1863.— Public Ledger, 15, 29 mars, 2 avril, 24 juin 1881.— Royal Gazette and Newfoundland Advertiser, 12 janv. 1860.— Telegraph (St John’s), 6 nov. 1867, 22 déc. 1869.
D. J. Davis, « The Bond–Blaine negotiations, 1890–1891 » (thèse de
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
James K. Hiller, « WHITEWAY, sir WILLIAM VALLANCE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 mars 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/whiteway_william_vallance_13F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/whiteway_william_vallance_13F.html |
| Auteur de l'article: | James K. Hiller |
| Titre de l'article: | WHITEWAY, sir WILLIAM VALLANCE |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1994 |
| Année de la révision: | 1994 |
| Date de consultation: | 1 mars 2026 |