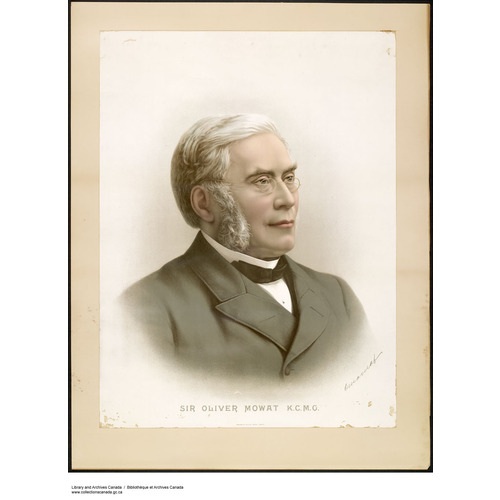Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3000532
MOWAT, sir OLIVER, avocat, homme politique, juge et fonctionnaire, né le 22 juillet 1820 à Kingston, Haut-Canada, fils de John Mowat* et de Helen Levack ; le 19 mai 1846, il épousa à Toronto Jane Ewart, fille de John Ewart*, et ils eurent trois fils et quatre filles ; décédé dans la même ville le 19 avril 1903.
Les parents d’Oliver Mowat étaient tous deux originaires de Caithness, en Écosse. Vétéran de la guerre d’Espagne, John Mowat arriva dans la province du Canada avec l’armée britannique en 1814 ; à sa démobilisation, il se fixa près de Kingston, qui était alors le principal centre commercial du Haut-Canada. Au moment de la naissance d’Oliver, il était copropriétaire d’un magasin général dans cette ville.
Oliver Mowat eut plusieurs instituteurs et fut élevé dans la religion presbytérienne : comme sa famille, il fréquentait l’église St Andrew. « Dans ma jeunesse, rappela-t-il plus tard, j’ai étudié avec beaucoup d’ardeur les preuves du christianisme [...] et suis parvenu à la conclusion que le christianisme n’était pas une fable adroitement imaginée, mais la vérité même. » Le presbytérianisme d’autrefois évoque ordre et mesure, mais dans la jeunesse de Mowat, l’Église d’Écosse dans le Haut-Canada faisait partie d’un ensemble mouvant où l’on retrouvait des presbytériens dissidents, des baptistes et des congrégationalistes, sectateurs champions de la conscience individuelle, adeptes d’une foi questionneuse et sympathisants du réformisme politique. Même avant le schisme qui, en 1844, donna lieu à la création de l’Église libre, des tendances semblables travaillaient l’Église d’Écosse [V. Robert Burns*]. Leur influence se manifesterait chez Mowat dans le cheminement intellectuel qui allait faire de lui un réformiste convaincu ; dans son engagement, au cours de sa première campagne électorale, à se conduire en « homme politique chrétien » ; dans ses constants efforts, en politique, pour agir conformément à ses principes ; et peut-être aussi dans le contraste que des commentateurs de l’époque discernaient entre son naturel conservateur et sa politique réformiste.
Mowat passa l’examen d’admission de la Law Society of Upper Canada en novembre 1836. De janvier 1836 à novembre 1840, il fut stagiaire au cabinet de John Alexander Macdonald* à Kingston. Puis, en novembre 1841, après trois trimestres de stage à Toronto chez un spécialiste de l’equity, Robert Easton Burns*, il fut reçu au barreau. Il s’associa à Burns ; en 1844, Philip Michael Matthew Scott VanKoughnet* se joignit à eux. Burns les quitta en 1845, mais Mowat et VanKoughnet restèrent ensemble encore deux ou trois ans. En 1850- 1851, Mowat s’associa à son beau-frère Thomas Ewart et à John Helliwell, après quoi il exerça seul jusqu’en 1856.
En 1841, Mowat avait confié à un ami, Alexander Campbell*, de Kingston, sa crainte de ne « jamais être quelqu’un ». Sa décision de faire de l’equity à Toronto, au lieu d’être simple avocat à Kingston, atteste son ambition. La Cour de la chancellerie du Haut-Canada n’existait que depuis 1837 et les avocats qui y plaidaient formaient un petit groupe sélect. Le plus souvent, en equity, il s’agissait de déterminer et de faire respecter des droits de propriété. C’était donc un domaine appelé à prendre de l’expansion à mesure que l’économie provinciale se développerait. Dès 1850, Mowat était le praticien d’equity le plus occupé de la province et l’on faisait appel à lui pour des litiges dont l’enjeu était des plus élevés. Le comité judiciaire du Conseil privé, en Grande-Bretagne, confirma au moins deux de ses victoires. En juillet 1854, Mowat estima ne pas avoir gagné moins de 3 500 £ (14 000 $) de revenu net dans les 12 derniers mois. Son cabinet avait assez de travail pour occuper cinq stagiaires.
C’est le procès qui suivit « l’affaire des 10 000 £ », surtout, qui le rendit célèbre. En 1853, cinq contribuables de Toronto retinrent les services de Mowat et de VanKoughnet pour réclamer au maire, John George Bowes*, la restitution de la part de bénéfice qu’on le soupçonnait d’avoir récoltée en spéculant sur des débentures municipales avec la complicité du copremier ministre Francis Hincks*. En lisant l’interrogatoire auquel Mowat soumit Bowes en cour, on voit que, sous des dehors aimables, il pouvait être caustique et agressif, et l’on comprend mieux pourquoi il reconnut en 1858 : « Je ne peux m’exprimer avec beaucoup de vigueur, à moins d’avoir un adversaire et [d’entendre] des choses auxquelles je ne souscris pas tout à fait. » VanKoughnet et lui invitèrent la Cour de la chancellerie à juger Bowes en fonction d’une norme sévère de responsabilité publique, norme que l’accusé avait manifestement enfreinte. Le scandale jeta un lourd discrédit sur Hincks et contribua beaucoup à la fin de son gouvernement. Tant la Cour d’appel de la province que le comité judiciaire du Conseil privé confirmèrent le jugement prononcé contre Bowes.
En même temps que grandissait sa renommée, Mowat s’intéressait de plus en plus à la vie publique et aux affaires de sa profession. En 1847, il entra au conseil d’administration de l’Upper Canada Bible Society (dont il allait être vice-président de 1859 à sa mort) et, en 1851, à celui de la toute nouvelle Anti-Slavery Society of Canada. On le pressa plusieurs fois d’accepter une charge de conseiller presbytéral à l’église écossaise St Andrew de Toronto, à laquelle il était resté attaché après le schisme de 1844, mais il refusait, alléguant n’avoir pas assez étudié la théologie pour être en mesure d’adhérer de tout cœur à la Confession de Westminster. En 1852, il entra au conseil de la University of Toronto et présida le comité d’étude du projet controversé de réforme universitaire présenté par le gouvernement. La loi de 1853 sur l’université, qui reconstituait le conseil, le priva de sa qualité de membre. Cependant, il allait être nommé de nouveau au conseil en 1857 et en faire partie jusqu’à son accession au poste de premier ministre de l’Ontario en 1872.
Élu en 1853 conseiller de la Law Society of Upper Canada, Mowat ne tarda pas à jouer un rôle de premier plan dans l’organisme. En 1854, il dirigea le comité qui resserra les critères d’admission au barreau ; les nouveaux critères, connus sous le nom de « règlement Mowat », allaient s’appliquer longtemps. Deux ans plus tard, il présida le comité qui acquit, pour la bibliothèque de la société, un premier gros fonds d’ouvrages américains de droit. La conférence qu’il donna pour aider les praticiens haut-canadiens à les consulter parut dans l’ Upper Canada Law Journal. Fait conseiller de la reine en janvier 1856, il entra en février à la commission de révision et de refonte des lois provinciales. C’est à ce moment qu’il commença à réorganiser son cabinet afin de pouvoir consacrer plus de temps aux affaires publiques.
En 1857 et en 1858, Mowat fut échevin à Toronto. Il appartint aux deux principaux comités permanents du conseil municipal, celui des finances et celui des chemins de fer ; en 1857, il était également commissaire du port. À titre de président du comité des promenades et jardins publics, il promut l’aménagement de parcs municipaux, car des habitations, des commerces et des chemins de fer envahissaient les lieux de détente traditionnels de Torontois, soit le bord du lac Ontario et la réserve de la garnison. Il fit aussi œuvre durable en instituant des règles administratives qui visaient à assurer la responsabilité financière du conseil, et à prévenir la fraude et les conflits d’intérêts chez les conseillers et les employés municipaux.
En janvier 1857, au lendemain de son élection à l’échevinage, Mowat assista à un congrès organisé par George Brown* et fut nommé au comité central d’une organisation, formée par les congressistes, la Reform Alliance. Étant donné ses antécédents et ses relations, son entrée au Parti réformiste avait de quoi surprendre. Le milieu des affaires de Kingston, où son père s’était enrichi, était conservateur par tradition. Mowat lui-même avait servi dans la milice de Frontenac pendant la rébellion de 1837–1838. En 1857, son ancien employeur, Macdonald, dirigeait le Parti libéral-conservateur, alors au pouvoir, son ex-associé VanKoughnet était ministre, et le gouvernement auquel tous deux appartenaient venait tout juste de séculariser les réserves du clergé, concession certainement suffisante pour un presbytérien qui avait refusé de suivre les schismatiques de l’Église libre. Par contre, Brown était un polémiste invétéré dont les prises de position passionnées en faveur du schisme l’avaient d’abord incité quelque peu à garder ses distances. Tout cela aurait pu ou dû incliner Mowat à choisir le Parti libéral-conservateur, et Macdonald ne fut pas le seul à l’accuser, en 1857, d’avoir rejoint les rangs de l’opposition par ambition plutôt que par principe.
Certes, Mowat était ambitieux, mais pour lui, la politique était beaucoup une affaire de principes. Son adhésion au Parti réformiste représentait l’aboutissement d’une réflexion qui l’avait depuis longtemps éloigné du courant conservateur dominant, si jamais il y avait appartenu. Dès décembre 1843, au cours de la crise qui avait suivi la démission du gouvernement de Louis-Hippolyte La Fontaine* et de Robert Baldwin*, il avait proclamé qu’il n’était « ni radical, ni tory, ni whig, même si les radicaux qui [le] connaiss[aient] [le] pren[aient] pour un tory, et les tories, pour un radical ». « Cela, avait-il précisé, provient de ce que, à l’occasion, je résiste à certaines des absurdités qui ne manquent pas de sortir de la bouche des hommes politiques, de quelque parti qu’ils soient. » À son avis, les conservateurs avaient tort de prétendre que le chef réformiste Baldwin mettait en péril le lien impérial. Pourtant, il s’abstint de voter aux élections générales de 1844 parce que, jusque-là, il avait « été trop paresseux pour étudier la politique et [que], tant qu[‘il ne l’aurait] pas étudiée, [il était] résolu à ne pas voter ». En 1854, à Toronto, il accorda son suffrage à deux conservateurs qui faisaient la lutte à John George-Bowes, mais il n’y avait pas de candidat réformiste. La même année, après une conversation avec VanKoughnet, il n’avait toujours pas de credo politique : « De toute évidence, disait-il, avant de parvenir à une conclusion éclairée, il ne faut pas seulement discuter, mais aussi lire et réfléchir. »
En raison de la désintégration du Parti réformiste sous la direction de Hincks, les affiliations partisanes étaient d’une fluidité inhabituelle. Un moment, Mowat caressa le projet de faire carrière à titre d’indépendant, mais il se ravisa bien vite. « Tout homme doit choisir son camp, dit-il à Alexander Campbell en 1858. Il contribue alors à définir les orientations de ce camp. Ses motions reçoivent l’appui de son parti. Il a davantage le pouvoir de faire le bien, si [faire] le bien est son but. Il adhère au seul principe sur lequel semble pouvoir reposer un gouvernement libre : la distinction des partis. » S’il adhéra au Parti réformiste, ce fut en grande partie parce qu’il était convaincu que le ministère de George-Étienne Cartier* et de Macdonald était prêt à tout pour conserver le pouvoir. Il citait en exemple la sécularisation des réserves du clergé, à laquelle Macdonald et VanKoughnet s’étaient un temps opposés avec véhémence. Leur appui à la loi de 1855 sur les écoles séparées, préconisée ardemment par Bowes, dut l’influencer aussi. Les lettres qu’il adressa à Campbell à cette époque sont les premiers documents où s’exprime, à l’endroit de Macdonald, une méfiance qui n’allait jamais le quitter. « Notre ami Macdonald ne prétend pas au patriotisme, écrivait-il en janvier 1858. En privé, il en rit, comme vous avez dû l’entendre vous-même. » Un tel gouvernement corrompait les hommes publics et la population elle-même ; chacun avait le devoir de s’y opposer.
En décembre 1857, Mowat s’était trouvé à la fois candidat à l’échevinage à Toronto et candidat à l’Assemblée de la province du Canada dans la circonscription d’Ontario South. Apparemment, son investiture dans Ontario South était imprévue. Voyant que les libéraux-conservateurs avaient choisi le receveur général Joseph Curran Morrison*, les réformistes de la circonscription avaient remplacé leur candidat par quelqu’un de plus prestigieux et de plus apte à rallier leurs membres. Dans son discours d’investiture, Mowat se déclara partisan de la non-confessionnalité du système publie d’enseignement et du principe de la représentation parlementaire basée sur la population (rep by pop). En outre, il s’engagea, en termes généraux, à réformer l’appareil gouvernemental et à simplifier les lois. Le discours s’achevait par la promesse, devenue célèbre, d’agir « dans l’esprit et avec les intentions qui conviennent à un homme politique chrétien ». Mowat battit Morrison par plus du double des voix. C’était la première des cinq élections successives qu’il allait remporter dans cette circonscription avant d’accéder à la magistrature en 1864. L’hostilité religieuse qui marqua le scrutin n’allait pas être oubliée de sitôt. Par la suite, on affirmerait que Mowat avait fait campagne avec ce slogan : « Votez pour la reine et Mowat, non pour le pape et Morrison. »
Déjà, en 1857, Mowat conseillait secrètement Brown sur les mesures nécessaires pour punir et prévenir tant la corruption chez les promoteurs ferroviaires que les conflits d’intérêts chez les fonctionnaires et les députés de l’Assemblée législative. De 1858 à 1864, il s’imposa comme le bras droit de Brown à l’Assemblée. En 1858, il proposa d’amender la réponse au discours du trône afin d’affirmer les droits du Canada sur les terres de la Hudson’s Bay Company. En août de la même année, il fut secrétaire de la province dans le gouvernement de Brown et d’Antoine-Aimé Dorion*, qui ne dura que deux jours. Au congrès réformiste de 1859, il aida Brown à convaincre les délégués d’opter à la fois pour l’application du principe de la représentation proportionnelle à la population et pour une fédération canadienne à la forme délibérément indéfinie plutôt que de renoncer à ce principe en faveur d’une dissolution de l’Union. En apprenant en 1864 qu’on lui avait offert un siège à la Cour de la chancellerie, Brown dirait : « J’ai peur qu’il ne l’accepte et ne me laisse tomber. »
En 1860, étant donné que les Chambres étaient sur le point de s’installer à Québec et que, s’il acceptait un poste au cabinet, il devrait quitter Toronto pour une période indéterminée, Mowat mit fin à la deuxième des brèves associations qu’il avait nouées entre 1856 et 1859 avec des avocats et en forma une plus durable avec un praticien de Hamilton, James Maclennan. Aux élections générales de 1861, il se présenta dans Ontario South et, en plus, défia John Alexander Macdonald dans Kingston, mais celui-ci le battit à plate couture. Même s’il pouvait être aussi combatif à l’Assemblée que devant un tribunal, il se montra prudent (d’aucuns diraient pusillanime) en refusant de diriger le caucus réformiste en l’absence de Brown, d’abord en 1861, lorsque celui-ci fut malade, puis en 1862, après qu’il eut perdu son siège. Après la défaite du ministère Cartier-Macdonald au Parlement, en mai 1862, ce fut à John Sandfield Macdonald* que le gouverneur général, lord Monck*, demanda de former un gouvernement. Sandfield, estima alors pouvoir se passer de Mowat.
De toute façon, Mowat n’aurait pas accepté de faire partie d’un gouvernement qui s’était engagé à écarter la question de la représentation proportionnelle à la population – ce qui était le cas de celui de Sandfield. Toutefois, il justifia la décision du caucus réformiste d’appuyer le gouvernement dans l’ensemble tout en continuant de prôner cette forme de représentation et l’abolition des écoles séparées. La représentation proportionnelle à la population, dit-il à Brown en mai 1862, ne pourrait pas donner de majorité en Chambre. La perspective de voir les conservateurs revenir au pouvoir lui était insupportable, et il espérait que les nouveaux ministres mettraient au jour assez de preuves d’« iniquité administrative » pour ruiner leurs prédécesseurs. Quand même, il déplorait que Sandfeld, en abandonnant la rep by pop, ait laissé tomber « le grand trait distinctif de la politique de l’opposition haut-canadienne ». Lorsque le caucus décida, par 11 voix contre 10, de ne pas soulever la question, il convainquit plusieurs de ses collègues de proclamer que, si quelqu’un en parlait en Chambre, ils défendraient ce principe de représentation.
La première session de Mowat à l’Assemblée, celle de 1858, coïncida avec l’amorce d’une réaction contre une loi populiste que Baldwin avait fait adopter en 1850, l’Acte pour refondre et amender les lois relatives aux jurés. Avec d’autres, Mowat combattit, en vain, le projet de loi qui le modifiait, et auquel il reprochait d’avoir été conçu pour faciliter la manipulation du choix des jurés. Il s’opposa aussi à un projet de loi qui donnait aux recorders le pouvoir de condamner sommairement, sans jury. Les propositions qu’il fit pour apaiser le mécontentement du barreau à l’égard de la loi de Baldwin ne portaient que sur les litiges civils : par exemple, se passer de jury si les parties y consentaient et ne pas exiger de verdict unanime s’il y avait un jury. La première de ces propositions acquerrait force de loi en 1868 sous l’égide de Sandfield Macdonald, alors procureur général et premier ministre de l’Ontario. En 1873, Mowat lui-même, qui occuperait ces deux fonctions, irait plus loin en laissant au juge, dans la plupart des affaires liées à la propriété, le droit de décider s’il y aurait ou non jury. Par la suite, il changea d’avis à propos de la règle de l’unanimité, et elle fut abolie seulement en 1895, après qu’il eut encore changé d’avis.
En 1854, Mowat avait pressé John Alexander Macdonald, procureur général depuis peu, d’appliquer dans le Haut-Canada les réformes comprises dans les lois britanniques de 1852 et de 1854 sur la procédure de common law et lui avait offert d’exécuter lui-même le travail de rédaction. Cette offre montre que, déjà, il s’intéressait à la réforme des institutions judiciaires et de la procédure, ce dont allait témoigner concrètement le Judicature Act de 1881. Toutefois, comme l’annonçait son discours électoral de 1857, la plupart des propositions législatives qu’il fit de 1858 à 1863 visaient à réformer le droit de propriété. L’une d’elles a un intérêt particulier du point de vue historique : un projet de loi présenté en 1859 qui autorisait les constructeurs de barrages de moulins à inonder des terres situées en amont moyennant le versement d’une indemnité. Les lois de ce genre étaient courantes aux États-Unis, et il en existait une dans le Bas-Canada. Cependant, Macdonald considérait que ce projet de loi empiétait indûment sur les droits de propriété garantis par la common law dans le Haut-Canada et il en empêcha l’adoption avec l’aide des députés bas-canadiens. À titre de premier ministre, il invoquerait les mêmes raisons, dans les années 1880, pour attaquer le Rivers and Streams Act de Mowat.
En mai 1863, l’Assemblée battit le gouvernement de Sandfield Macdonald et de Louis-Victor Sicotte*, et Sandfield fut autorisé à le dissoudre. Désireux de renforcer sa position en prévision des élections générales, il consulta Brown et Mowat, qui avaient tous deux fini par admettre qu’aucun gouvernement ne pourrait faire accepter le principe de la représentation proportionnelle à la population. Brown refusa d’entrer au cabinet mais recommanda Mowat, qui devint maître général des Postes le 16 mai. Sandfield, qui s’était allié aux « rouges » bas-canadiens d’Antoine-Aimé Dorion, remporta les élections par une faible majorité. Au cours des dix mois où il exerça sa fonction, Mowat conclut de nouveaux contrats pour le transport du courrier avec le chemin de fer du Grand Tronc et la Compagnie des bateaux à vapeur océaniques de Montréal. Afin d’aider à calmer ses principaux créanciers, le Grand Tronc avait exigé un tarif où entrait l’équivalent d’une énorme subvention. En 1861, Mowat avait refusé de représenter la compagnie en justice parce qu’il tenait à conserver son indépendance. Cette fois, il rédigea un rapport dans lequel il faisait valoir en termes vigoureux qu’elle n’avait pas droit à une subvention, refusa de soumettre la question à l’arbitrage parce que la décision risquait d’être favorable au chemin de fer et usa du pouvoir statutaire du gouvernement pour fixer, par arrêté en conseil, un tarif beaucoup plus bas que celui que réclamait la compagnie. Quant au tarif qu’il consentit à la compagnie de vapeurs pour le transport du courrier entre le Canada et la Grande-Bretagne, il dépassait à peine la moitié du tarif de l’ancien marché.
Mowat quitta sa fonction le 29 mars 1864, à la démission du ministère Sandfield Macdonald-Dorion. En mai, il appuya la motion dans laquelle Brown proposait de former un comité spécial sur la crise constitutionnelle qu’engendraient les tensions entre le Haut et le Bas-Canada et sur l’instabilité politique qui en résultait. Il signa le rapport majoritaire du comité, qui préconisait « des changements en vue d’un régime fédératif soit pour le Canada seulement, soit pour l’ensemble des provinces de l’Amérique du Nord britannique ». Le 14 juin, l’Assemblée adopta une motion de censure à l’endroit du gouvernement de sir Étienne-Paschal Taché* et de John Alexander Macdonald. Sur ce, Brown obtint des chefs conservateurs qu’ils s’engagent à donner suite à la recommandation du comité spécial, mais il refusa de se rendre à leur exigence, à savoir d’entrer au gouvernement avec deux de ses collègues. Mowat soutint Brown au caucus. Cependant, le caucus s’étant prononcé majoritairement contre eux, Brown, William McDougall et Mowat (de nouveau à titre de maître général des Postes) entrèrent au gouvernement le 30 juin 1864. En raison de ses fonctions départementales, Mowat ne put pas faire partie de la délégation qui se rendit à Charlottetown en septembre afin de sonder les opinions sur une fédération des colonies de l’Amérique du Nord britannique, mais il participa à la conférence de Québec en octobre. Selon James Young*, il fut le délégué qui contribua le plus à « formuler [les] décisions [de la conférence] en langage constitutionnel et juridique ». Il présenta une résolution qui définissait les pouvoirs législatifs des provinces et deux résolutions qui habilitaient les autorités du dominion à réserver la sanction (droit de réserve) des lois provinciales ou à refuser de les reconnaître (droit d’annulation).
La contribution de Mowat aux Résolutions de Québec est importante eu égard au rôle qu’il allait jouer dans la controverse des droits provinciaux. Depuis les années 1930, la plupart des commentateurs spécialisés soutiennent que l’interprétation de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 (la loi impériale renfermant le pacte confédéral) qu’il défendit à titre de premier ministre et procureur général de l’Ontario, de 1872 à 1896, se démarquait radicalement du dessein original de la Confédération. En particulier, ils trouvent contradictoire que, après avoir appuyé le droit de veto fédéral en 1864, Mowat ait critiqué l’exercice répété, par le gouvernement Macdonald, de son droit d’annulation à l’égard de la loi ontarienne sur les cours d’eau (Rivers and Streams Act) dans les années 1880 et se soit converti à l’idée de l’abolition du droit de veto fédéral. On doit donc souligner qu’il n’y a aucune incohérence entre sa position sur le refus de reconnaître la loi sur les cours d’eau et ce que l’on sait de sa contribution à la conférence de Québec ou des commentaires qu’il fit sur la conférence dans les années subséquentes. Il est difficile de savoir exactement ce qu’il pensait de l’entente de Québec au moment de sa conclusion : comme il accéda au tribunal un mois après, il ne put pas en parler, ni dans le cadre des débats sur la Confédération qui suivirent la conférence, ni ailleurs. Lorsque la question devint controversée, dans les années 1880, il reconnut que le gouvernement fédéral avait, légalement parlant, le droit absolu de refuser de reconnaître n’importe quelle loi provinciale, tout comme le gouvernement impérial avait, légalement parlant, le droit absolu de refuser de reconnaître n’importe quelle loi du dominion. Cependant, il faisait valoir que, pour les participants de la conférence de Québec, il allait de soi que le droit de veto fédéral serait soumis aux mêmes restrictions que le droit du gouvernement impérial d’opposer son veto aux lois des colonies ayant un gouvernement responsable. C’est pourquoi il soutenait que, du point de vue constitutionnel, le refus de reconnaître le Rivers and Streams Act n’était pas plus acceptable que la non-reconnaissance impériale d’une loi fédérale semblable.
Qui dit gouvernement responsable dit autonomie. Parce qu’elle s’appuyait sur l’idée que les provinces ont un gouvernement responsable, la position de Mowat embête les spécialistes qui soutiennent que le pacte confédéral réduisait l’autonomie provinciale au profit de la puissance du gouvernement central. Pourtant, le fait que la Confédération fut conçue sur le modèle de l’Empire – argument couramment avancé pour prouver que les Pères de la Confédération tenaient à un gouvernement central fort – impliquait en soi que les provinces étaient autonomes et avaient un gouvernement responsable. Il y avait cohérence entre la position de Mowat et le modèle impérial, le libellé des résolutions pertinentes (libellé qui fut repris dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique) et les directives sur l’exercice du droit d’annulation que Macdonald lui-même donna en tant que premier ministre en 1868. Et, surtout, cette position était fidèle au grand principe qui n’avait cessé de guider le réformisme haut-canadien depuis les années 1820, principe qui légitimait la Confédération elle-même aux yeux des réformistes : l’accession de la collectivité haut-canadienne à l’autonomie politique.
Le 14 novembre 1864, Mowat devint vice-chancelier à la Cour de la chancellerie du Haut-Canada. On ne tarda pas à remarquer qu’il ne se laissait pas facilement arrêter par les détails de la procédure. Règle générale, ses jugements étaient concis et sobres. Ils consistaient largement en citations de précédents jurisprudentiels (presque toujours d’origine anglaise) appuyées par de brefs énoncés des principes établis par ces précédents. C’était le cas du jugement qu’il prononça en 1865 dans une affaire sur la relation entre fiduciaire et bénéficiaire, Clarke c. Hawke. Le traitement que la common law réservait aux femmes mariées lui semblait « passablement barbare », et il était l’un des deux juges de l’Ontario (l’autre étant Adam Wilson*) qui plaidaient en faveur d’une interprétation souple de l’Acte pour assurer en propre aux femmes mariées certains droits de propriété de 1859, dont il avait préconisé l’adoption au Parlement.
Sur le plan historique, sa cause la plus intéressante fut peut-être Dickson c. Burnham, en 1868, dans laquelle un propriétaire terrien poursuivait le propriétaire d’un moulin pour avoir inondé sa propriété. Même s’il avait déjà tenté de légaliser pareils empiétements, Mowat appliqua cette maxime de sir William Blackstone, qu’il cita : « Au regard du droit, la propriété privée a une telle importance que l’on ne saurait autoriser la moindre infraction à son endroit, même pour le plus grand bien de la collectivité. » Toutefois, il signala que le Parlement avait sanctionné des violations du droit de propriété pour faciliter la construction de canaux et de chemins de fer, et qu’il ne voyait pas pourquoi on ne ferait pas de même pour des moulins et des manufactures. Lui-même, en tant que premier ministre, dérogerait à la maxime de Blackstone en faisant adopter la loi sur les cours d’eau. Son hésitation, dans l’affaire Dickson, à imiter les juges américains, qui avaient tendance à modifier le droit afin de promouvoir un bien collectif reconnu (la croissance économique dans bien des cas), illustre l’opinion généralement admise au sein de la magistrature haut-canadienne et voulant que de tels changements relèvent du Parlement.
Peu après l’accession de Mowat au tribunal, le juge James Robert Gowan, de Barrie avait fait observer à Macdonald : « J’imagine que Mowat aurait préféré attendre dans l’espoir que les circonstances lui donnent une chance d’être [juge en chef] du H[aut-]C[anada] – à présent, ses chances d’avoir une autre promotion sont plutôt minces, je suppose. » Gowan avait raison de penser que la vice-chancellerie ne satisfaisait pas les ambitions de Mowat, mais tort de croire qu’il aspirait à devenir juge de common law. Ce que Mowat voulait, c’était le titre de chancelier– « grand objet de l’ambition d’un avocat d’equity qui aime sa profession », nota-t-il en mai 1868 dans une lettre à Macdonald. Il avait accepté le second rôle parce que c’était le seul moyen de quitter la politique, disait-il, et il l’avait fait uniquement après avoir demandé et obtenu de Macdonald la garantie que, ce faisant, il ne sacrifierait pas ses chances d’accéder à la chancellerie si cette fonction se libérait. Il ne révélait pas pourquoi il avait voulu quitter la politique en 1864, mais sa femme était très malade à l’époque.
Mowat écrivit cette lettre à Macdonald parce qu’il avait découvert que celui-ci avait l’intention d’offrir la chancellerie à Edward Blake*. Son informateur était probablement le chancelier en poste, son ex-associé VanKoughnet, que Macdonald voulait nommer juge en chef du Haut-Canada après William Henry Draper*. VanKoughnet voulait être juge en chef, mais il lui répugnait de laisser la place à Blake sans le consentement de ses confrères de la chancellerie. Comme ils ne souhaitaient pas que Blake, beaucoup plus jeune qu’eux, leur bloque la voie de la chancellerie, Mowat et le vice-chancelier principal, John Godfrey Spragge*, persuadèrent VanKoughnet de rester en poste jusqu’à l’adoption du projet de loi de Macdonald sur la Cour suprême, qui allait ouvrir des possibilités d’avancement dans l’appareil judiciaire de l’Ontario.
Macdonald put bien se plaindre en septembre de leur « égoïste vanité », on comprend que Mowat ait agi de cette façon s’il croyait avoir reçu de Macdonald la promesse d’être le prochain chancelier. Toutefois, il était le seul à se considérer comme le candidat idéal à cette fonction, cet avis n’étant du moins pas partagé parmi les bonzes du monde judiciaire ontarien. Draper, qui prétendait parler au nom des autres aussi bien qu’en son propre nom, le soupçonnait d’être un « maniaque de l’equity », [qui] en appliquerait les principes à l’extrême en esquivant aussi promptement les lois positives que les règles de common law ». VanKoughnet, lui, préférait Blake et Spragge à Mowat, et il fit remarquer à Macdonald que, de l’avis général, un tribunal composé de Spragge, de Mowat et de John Wellington Gwynne (de toute évidence le prochain vice-chancelier) manquerait d’ascendant. À la mort de VanKoughnet, en 1869, Macdonald nomma Spragge chancelier seulement après avoir offert le poste à Blake, car il doutait que le tribunal ait suffisamment d’autorité sans lui.
Dans sa lettre de 1868, Mowat avait dit à Macdonald que son salaire de vice-chancelier se révélait insuffisant et qu’il songeait à démissionner pour retourner à la pratique du droit. Spragge, cependant, infirme et âgé de 14 ans de plus que Mowat, ne représentait pas un obstacle aussi sérieux à l’avancement que Blake et, vers cette époque, les juges des tribunaux supérieurs de l’Ontario commencèrent à recevoir un supplément de salaire de la province. Mowat garda donc son siège.
Le 25 octobre 1872, sur les instances de Blake, de George Brown et d’Alexander Mackenzie*, Mowat accepta de devenir premier ministre et procureur général de l’Ontario. Il démissionna de la vice-chancellerie le lendemain. Jamais encore, au Canada, un juge n’avait quitté son siège pour diriger un parti politique, et ses adversaires politiques lui reprochèrent ce geste. Mais, comme il prenait automatiquement la tête du Parti réformiste en devenant premier ministre, il pouvait invoquer une justification inattaquable du point de vue constitutionnel : « Sa Majesté a le droit d’appeler à son conseil n’importe lequel de ses sujets, qu’il se trouve à exercer une fonction judiciaire ou autre. » De même, il recourut à des formules constitutionnelles pour éviter d’avoir à donner des motifs personnels et pour atténuer l’aspect partisan de sa décision. « Je ne recherchais ni ne désirais cette position, dit-il, et, personnellement, j’hésitais à l’accepter, mais je n’ai pu trouver aucune raison suffisante qui eût justifié un refus de ma part. » Comme aucun événement, dans les huit dernières années, n’avait modifié ses opinions politiques, il avait décidé de former « un gouvernement authentiquement réformiste ».
On en est donc réduit aux conjectures sur ce qui poussa Mowat à accepter le poste, mais on le devine aisément. Depuis les élections générales qui s’étaient tenues dans le dominion à l’été de 1872, la majorité de John Alexander Macdonald s’était affaiblie. Obligés, par une loi qu’ils avaient eux-mêmes fait adopter, de choisir entre un siège à la Chambre des communes et un siège à l’Assemblée provinciale, Blake et Mackenzie, respectivement premier ministre et trésorier de l’Ontario, avaient opté pour la scène fédérale. Cependant, le gouvernement de la province était encore fragile : Blake et Mackenzie avaient évincé celui de Sandfield Macdonald seulement dix mois auparavant en remportant un vote de censure par une majorité d’une seule voix. Aucun réformiste de l’Assemblée n’avait à la fois assez d’ancienneté et de talent pour remplacer ces deux hommes, et tant que John Alexander Macdonald demeurait premier ministre du pays, il était souhaitable de maintenir un gouvernement réformiste fort à Toronto. Depuis que Macdonald avait renégocié les modalités financières de l’appartenance de la Nouvelle-Écosse au dominion, en 1869 [V. Archibald Woodbury McLelan*], et depuis qu’il avait refusé de reconnaître certaines lois ontariennes, les réformistes doutaient de son adhésion à ce qui, pour eux, était l’esprit du pacte confédéral. Leurs soupçons s’aggravèrent lorsque, en 1872, Macdonald affirma implicitement la préséance constitutionnelle du dominion sur les provinces en contestant la prérogative des lieutenants-gouverneurs de nommer des conseillers de la reine. Ils ne digéraient pas non plus sa résistance aux prétentions de l’Ontario sur les territoires situés au nord des lacs Huron et Supérieur.
Mowat partageait sans aucun doute ces inquiétudes, mais on peut lui supposer des motifs plus personnels. Son retour en politique était-il avantageux sur le plan financier ? Cela n’est pas évident. Il gagnait bien moins en tant que premier ministre qu’en tant que vice-chancelier, mais il reprit la pratique du droit avec James Maclennan. De toute façon, cesser de jouer, selon lui, le rôle de second violon ne le chagrinait peut-être pas outre mesure, et se voir écarté de la chancellerie par Macdonald dut accentuer sa vieille méfiance envers lui. On peut penser également qu’il avait envie de se battre. « Aussi doux qu’il ait semblé au repos, allait rappeler sir George William Ross*, c’était un mamelouk quand il s’emportait, et [alors] il frappait avec toute la détermination de quelqu’un qui veut à tout prix réduire son adversaire à l’impuissance et le désarmer. » Cet homme qui affirmait déployer tous ses talents d’orateur en présence d’un opposant et qui dit à Macdonald en 1868 avoir « encore assez d’énergie pour reprendre [sa] place dans les joutes professionnelles qu[‘il] aim[ait] tant autrefois et aimer[ait] sûrement encore » se découvrait peut-être des besoins et des ambitions que le travail de juge ne comblait pas. Aucune fonction en Ontario n’était plus honorable que celle de premier ministre, déclara-t-il, et pour qui voulait servir la population, elle offrait plus de possibilités que la vice-chancellerie. Elle lui donnerait également l’occasion de se lancer dans la joute la plus longue et peut-être la plus emballante de sa carrière.
Le 29 novembre 1872, Mowat fut élu sans opposition dans Oxford North ; il allait représenter cette circonscription jusqu’en juillet 1896. Dès la session qui s’ouvrit six semaines plus tard, il prouva qu’il était remarquable organisateur et fin politique. Par un recours ingénieux à l’excédent financier de la province, le Municipal Loan Fund Debts Act de 1873 réglait, d’une manière aussi équitable que stimulante pour l’économie, le problème jusque-là insoluble de l’endettement des municipalités à l’endroit du gouvernement. L’Administration of Justice Act instituait des réformes majeures tout en écartant une idée de Blake qui choquait la plupart des juges et avocats de la province, à savoir fusionner d’un seul coup les tribunaux ontariens d’equity et de common law.
Quant aux mesures les plus controversées de la session, des projets de loi privés visant à constituer juridiquement les associations orangistes de l’est et de l’ouest de l’Ontario, Mowat les fit progresser avec une habileté caractéristique. Il permit à son caucus de voter librement, mais après l’adoption des projets de loi, il avisa le lieutenant-gouverneur William Pearce Howland de les réserver pour les soumettre à l’étude du gouvernement fédéral. Ainsi, il se déchargeait sur Macdonald du fardeau de l’épineuse décision de leur donner ou non force de loi. Macdonald refusa de faire quelque recommandation que ce soit, mais le délai donna à Mowat le temps de désamorcer la contreverse. En 1874, Mowat présenta une loi cadre sur la constitution juridique des œuvres de charité et sociétés de bienfaisance, loi dont l’ordre d’Orange pourrait se prévaloir sans paraître bénéficier d’une considération particulière de la part du gouvernement provincial. Il camoufla en outre cette loi en l’intégrant à deux vastes réformes : une réforme globale du droit relatif à la constitution en société, qui comprenait une loi du même genre sur les sociétés par actions, et une rationalisation des subventions gouvernementales destinées aux œuvres de charité privées.
Le règne de Mowat coïncida avec une période où les villes et les industries connurent une croissance rapide, mais où la crise économique et la dépopulation frappèrent les campagnes, et surtout les régions de peuplement le plus ancien, qui formaient les bastions du Parti réformiste. Comme ce parti, par tradition, se présentait comme celui des fermiers, pareille conjoncture lui posait des problèmes particuliers ; Mowat réalisa tout un exploit en demeurant si longtemps au pouvoir. Il y parvint en veillant constamment à concilier les principaux groupes sociaux, en usant à fond, mais sans malhonnêteté, du pouvoir gouvernemental à des fins électorales et en ne cessant pas de dépeindre le Parti libéral-conservateur comme l’outil des bien nantis et des ennemis de l’Ontario. Jusqu’en 1890, ces méthodes ne lui permirent jamais de remporter plus qu’une très faible majorité, mais ses victoires successives démoralisèrent tellement les conservateurs qu’ils ne furent guère en mesure de profiter de la crise agricole qui, en 1894, fit perdre aux réformistes une bonne partie de leurs appuis ruraux.
À l’arrivée des réformistes au pouvoir, le budget de la province présentait un excédent confortable. Ajouté aux paiements statutaires du gouvernement fédéral et aux recettes du florissant commerce du bois, ce surplus permettait au gouvernement d’avancer prudemment sur la voie de l’expansion sans beaucoup recourir à l’imposition et au crédit. Mowat, désireux de créer un consensus proréformiste, exploita cette bonne fortune en pratiquant une judicieuse stratégie : user du pouvoir pour stimuler l’économie provinciale et atténuer les effets de la croissance urbaine et industrielle. Pour activer l’économie, le gouvernement subventionna généreusement la construction ferroviaire, investit dans le drainage des terres et aménagea des chemins de colonisation dans les régions qu’il voulait peupler. L’Ontario School of Agriculture and Experimental Farm de Guelph devint le foyer de la modernisation et de la diversification du secteur agricole [V. William Johnston*]. En 1888, le département de l’Agriculture, qui jusque-là relevait du trésorier de la province, eut son propre ministre, Charles Alfred Drury. Deux autres établissements de formation professionnelle naquirent à Toronto dans les années 1870 : l’Ontario School of Art et la School of Practical Science. Le Bureau de l’industrie, créé en 1882 pour recueillir et publier des données utiles aux fermiers et aux manufacturiers, desservit bientôt également les secteurs de l’exploitation forestière, des mines et des finances. Dans les années 1890, pour faire face à la croissance du secteur minier, le gouvernement fonda le Bureau des mines, dont il confia la direction à Archibald Blue*, et prit des initiatives en matière d’éducation, par exemple en fondant à Kingston la School of Mining and Agriculture.
Mowat tenait tellement à encourager les investissements qu’il était toujours attentif aux intérêts des capitalistes, surtout à ceux des exploitants forestiers et miniers, à qui son gouvernement n’imposait que des charges très basses, quand il n’y renonçait pas complètement. Cependant, il prenait soin de porter une attention égale aux préoccupations des travailleurs. Cette ligne de conduite s’inscrivait dans la logique de la prétention du Parti réformiste au rôle de parti du peuple – le Parti conservateur ne défendant censément que des intérêts particuliers – mais Mowat attribuait aussi son impartialité au sens de la justice sociale qu’il disait tirer de ses convictions chrétiennes. Quelle qu’en ait été l’origine, son attitude était politiquement astucieuse : depuis déjà longtemps, le suffrage de la classe ouvrière avait du poids dans les circonscriptions urbaines, et l’industrialisation était en voie d’accoître son importance dans l’ensemble de la province. Mowat marqua donc son accession au pouvoir, en 1872, en abandonnant les poursuites pour conspiration intentées contre les meneurs de la récente grève des typographes de Toronto [V. James Beaty*]. En 1879, il tenta en vain de rallier les réformistes d’Ottawa derrière Daniel John O’Donoghue, le chef ouvrier qui représentait la ville à l’Assemblée depuis 1874. Puis, en 1885, la construction du nouvel édifice du Parlement, à Queen’s Park, commença enfin : on était en pleine dépression économique, et les leaders ouvriers avaient réclamé qu’on lance les travaux pour créer de l’emploi.
Mowat manifesta son souci des préoccupations ouvrières non seulement par des gestes ponctuels de cette sorte, mais aussi par une variété de mesures – certaines proposées d’abord par l’opposition – qui profitèrent aux ouvriers tant dans leur lieu de travail qu’à l’extérieur. Une série de lois qui leur accordaient un privilège foncier accrut progressivement leur garantie d’être payés pour le travail accompli. En 1874, une loi mit une partie de leur salaire à l’abri de la saisie pour dettes. La même année, on adopta des règlements de sécurité pour les conducteurs de batteuse. L’Ontario Factories Act de 1884 vint réglementer les heures de travail des femmes et des jeunes dans l’industrie et instaura le premier système d’inspection de sécurité au Canada. En 1886, le Workmen’s Compensation for Injuries Act modifia substantiellement, pour la première fois, les règles de common law qui dégageaient virtuellement les employeurs de toute responsabilité dans les accidents de travail. À ces mesures de protection s’ajoutèrent des réformes politiques qui accroîtraient le poids électoral des travailleurs. Le droit de vote fut élargi en 1874, en 1877 et en 1885, pour être finalement accordé à tous les hommes adultes en 1888. En outre, dans le but d’assainir les mœurs électorales, le gouvernement institua le scrutin secret et améliora à la fois le système d’enregistrement des électeurs et la procédure judiciaire qui servait à combattre la corruption.
En 1876, le gouvernement abolit le conseil de l’Instruction publique, organisme apolitique, et créa un département de l’Éducation qu’il dota d’un ministre. Sous la direction d’Adam Crooks*, le département combattit une grave pénurie d’instituteurs en ouvrant des dizaines d’écoles modèles ; ainsi, quoique moins rigoureuse, la formation des enseignants était plus décentralisée que du temps où l’Ontario ne comptait que deux écoles normales. On encouragea les autodidactes en subventionnant les municipalités pour qu’elles ouvrent des bibliothèques municipales. Dans les années 1880, le successeur de Crooks, George William Ross, poursuivit l’uniformisation du système scolaire, notamment en imposant des manuels rédigés sous la supervision de son département. Il encouragea la fondation de jardins d’enfants, et développa l’enseignement secondaire et post-secondaire jusqu’aux limites de ce que le gouvernement jugeait politiquement acceptable. En 1891, il fit adopter un projet de loi imposant la fréquentation scolaire aux enfants de 8 à 14 ans. Quant aux écoles séparées, que la constitution protégeait, le gouvernement Mowat les considéra comme un fait accompli, et tant sous Crooks que sous Ross, il s’efforça de les améliorer.
Le gouvernement ne fut pas inactif non plus dans le domaine de la sécurité sociale. Il habilita les femmes à devenir tutrices légales de leurs enfants et prit des mesures pour contraindre les hommes délinquants à subvenir aux besoins de leur famille. Sous l’autorité de John Joseph Kelso*, surintendant de l’enfance abandonnée, il encouragea la création de sociétés d’aide à l’enfance, et il mit sur pied un réseau de foyers nourriciers pour les enfants maltraités. On réduisit progressivement la main-d’œuvre enfantine dans l’industrie et le commerce de détail. On fit des efforts pour séparer les arriérés mentaux des aliénés et pour leur donner toute la formation qu’ils étaient capables d’acquérir. Dans le domaine de l’hygiène publique, on fonda, sous la direction de Peter Henderson Bryce*, un bureau provincial dont le mandat était de recueillir des statistiques dans le domaine de la santé et de pratiquer diverses formes de prévention. À compter de l’adoption du Public Health Act, en 1884, chaque municipalité dut mettre sur pied son propre bureau de santé, qui relèverait du bureau provincial.
En qualité de procureur général, Mowat institua toute une variété de réformes qui visaient à offrir de nouveaux services juridiques et à accélérer les recours sans entamer l’autorité du barreau. Parmi ces réformes, certaines portaient spécifiquement sur l’appareil judiciaire ; le Judicature Act vint les couronner en 1881 en mettant enfin un terme à la traditionnelle séparation entre common law et equity. Toutefois, le Juror’s Act de 1879 ne modifiait pas le système de sélection des jurés que Mowat avait dénoncé au moment de son introduction en 1858, même si des députés radicaux de son caucus s’étaient prononcés pour cette modification en Chambre. En matière de droit positif, on peut citer, parmi les réformes les plus importantes de Mowat : sa loi cadre de 1874 sur la constitution juridique des sociétés et deux lois, en 1881 et en 1885, qui donnaient ingénieusement à la province les bénéfices concrets du droit des faillites, même si, selon l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, légiférer sur les faillites était du ressort du gouvernement fédéral.
Au fil de ses longues années de pouvoir, le gouvernement Mowat fit adopter un nombre impressionnant de projets de lois, mais cette profusion s’explique en partie par le penchant du premier ministre pour les réformes à la pièce. Prudence : tel était le mot d’ordre dans son gouvernement, et lui-même aimait mieux permettre que contraindre. De temps en temps, il y avait donc des lois inutiles. On ne recourut presque jamais à celles qui, en 1873 et en 1890, vinrent faciliter l’arbitrage des litiges entre patrons et ouvriers. L’Industrial Schools Act de 1874, qui autorisait les conseils scolaires des villes à ouvrir des pensionnats pour la formation des enfants défavorisés, demeura lettre morte durant une décennie, soit jusqu’à ce qu’une nouvelle loi leur permette de déléguer ce pouvoir aux œuvres de bienfaisance privées. Il fallut attendre presque trois ans la proclamation de la loi de 1884 sur les manufactures, dont la constitutionnalité soulevait des doutes, et par la suite, elle fut appliquée avec mollesse. Même dans le domaine de la réforme du droit, on reprochait quelquefois à Mowat d’être timoré.
Pourtant, fin renard est une épithète qui conviendrait mieux à Mowat. « La sagacité avec laquelle il évaluait jusqu’où il pouvait pousser une question sans alarmer l’opinion publique était remarquable, rappelait George William Ross. Naturellement conservateur, il était prêt, au moment psychologique, à vouer ses idoles aux gémonies et à mener les plus radicaux en procession avec tout le zèle d’un néophyte. » Pour John Charles Dent*-, c’était « un libéral avancé » selon qui le temps n’était pas venu de mettre toutes ses théories en pratique. La démographie politique de l’Ontario imposait la retenue. Étant donné les animosités ethniques, religieuses et surtout politiques qui régnaient dans la province, l’effritement de la base électorale des réformistes en milieu rural rendait la position de Mowat bien assez périlleuse pour qu’il ne prenne pas de risques inutiles. Il avait besoin de se faire de nouveaux amis sans s’aliéner les anciens, mais c’était là une tâche très délicate étant donné l’identité de ces amis éventuels et les moyens par lesquels ils pouvaient être gagnés. Plus le temps passait, plus les conservateurs ontariens s’acharnaient à miner ses appuis ruraux en revenant sans cesse sur ses liens avec la hiérarchie catholique, son recours éhonté au favoritisme à des fins politiques et les intérêts de son gouvernement dans le commerce de l’alcool.
L’attention que Mowat prêtait aux problèmes de la hiérarchie catholique était, au même titre que ses lois ouvrières et ses réformes électorales, destinée à lui concilier un élément de la société qui penchait du côté des conservateurs. En traitant la question orangiste ainsi qu’on l’a dit précédemment, en faisant entrer Christopher Finlay Fraser* au cabinet en 1873 et en se montrant disposé à consulter l’archevêque de Toronto, John Joseph Lynch*, sur la distribution des faveurs et sur les autres questions qui touchaient les catholiques, il jeta la base d’une alliance qui commença à porter fruit aux élections de 1879. Certains évêques, toutefois, étaient plus réticents que Lynch. En 1885, tant le clergé ultramontain que les protestants militants s’en prirent au « concordat Lynch-Mowat » à propos de ce qu’on appelait la Bible de Ross, choix d’extraits des Écritures préparé pour les écoles par des théologiens protestants à la demande de George William Ross et soumis à l’examen de Lynch. L’anticatholicisme qui anima l’opposition provinciale dans les années qui suivirent l’exécution de Louis Riel* en 1885 [V. Christopher William Bunting*] cimenta l’alliance entre les réformistes et la hiérarchie catholique. En 1897. l’archevêque ultramontain de Kingston, James Vincent Cleary*, invoquerait l’absurdité de répudier Mowat et les libéraux ontariens pour justifier le refus des évêques de l’Ontario de faire front commun avec leurs collègues de la province de Québec contre la solution que le gouvernement fédéral de sir Wilfrid Laurier* proposait à la crise scolaire du Manitoba – compromis auquel Mowat avait prêté son prestige et peut-être ses talents de négociateur.
La propagande électorale des conservateurs montre combien le favoritisme comptait dans l’alliance de Mowat avec la hiérarchie. En 1883, les conservateurs accusèrent le gouvernement de ne pas accorder aux catholiques leur juste part de faveurs ; en 1894, ils l’accusèrent de leur en donner trop. Mowat, tout comme Macdonald, avait besoin du favoritisme pour soutenir son régime. L’expansion que le gouvernement prenait pour répondre aux besoins sociaux engendrés par l’urbanisation et l’industrialisation multipliait les occasions que le premier ministre avait de distribuer des faveurs. Les conservateurs réagissaient en accusant le gouvernement d’avoir la manie de centraliser. Ils espéraient ainsi le couper de ses partisans ruraux en jouant sur leur traditionnel esprit de clocher et sur leur aversion pour le « patronage ». Ils usèrent beaucoup de cette propagande contre la loi de 1876 sur les permis de vente d’alcool, appelée loi Crooks du nom du ministre qui l’avait fait adopter, Adam Crooks (même si Mowat et Arthur Sturgis Hardy avaient participé à sa rédaction). Cette loi retirait aux municipalités le droit de délivrer les permis de vente d’alcool pour le remettre entre les mains du gouvernement, et elle instaurait une bureaucratie à cette fin. La mesure ingénieuse créait des emplois pour les réformistes tout en décourageant les conservateurs qui détenaient un permis de se livrer à leurs habituelles pressions politiques, mais ce faisant, elle donnait au gouvernement un intérêt matériel dans le maintien du commerce de l’alcool, argument que les conservateurs pourraient exploiter auprès des réformistes à tendance prohibitionniste.
En 1881, le député conservateur de York East aux Communes, Alfred Boultbee, déclara à Macdonald que les deux grands handicaps électoraux des conservateurs étaient la mainmise du gouvernement de l’Ontario sur les permis de vente d’alcool et son alliance avec les catholiques. À son avis, si l’on ne pouvait pas annuler le premier de ces handicaps par une loi fédérale, il fallait « attaquer vigoureusement Mowat en montrant qu’il [était] l’allié des [catholiques] et des taverniers ». « [J]e pense, poursuivait-il, que si l’on y allait à fond, sans lâcher prise, Mowat et son gouv[ernement] pueraient considérablement au nez de l’Ont[ario]. [I]l y a ici un sentiment protestant très fort, qui grandit d’ailleurs de jour en jour, et si l’on pouvait faire comprendre aux gens que ce petit saint de Mowat est de mèche avec le pape et les vendeurs de rhum, la classe agricole le fuirait comme la peste. »
Boultbee parlait de politique fédérale, mais ses observations valaient tout autant pour les affaires provinciales. Quand on voit à quel point les majorités électorales du gouvernement Mowat étaient faibles, on peut fort bien se dire que ce qui faisait la différence, c’étaient précisément ces handicaps. En 1879, les réformistes avaient remporté 58 sièges sur 88, mais seulement 48 % des voix, alors que les conservateurs en avaient récolté 47 %. Cette majorité de sièges était exceptionnelle, mais, à d’autres égards, le résultat ressemblait à celui de tous les scrutins qui eurent lieu de 1875 à 1890. Chaque fois, les réformistes obtinrent une majorité suffisante ou forte avec 48 ou 49 % des suffrages ; de leur côté, les conservateurs eurent toujours 1 ou 2 % de moins, sauf en 1890, où leur pourcentage chuta à 45. Apparemment, ce qui se passait sur la scène fédérale n’y changeait pas grand-chose. En juin 1879, huit mois après l’écrasante victoire des conservateurs à Ottawa, Mowat était tellement inquiet qu’il se présenta à la fois dans Toronto East (où il perdit de justesse) et dans Oxford North. Pourtant, la répartition des voix fut à peu près la même qu’en janvier 1875, c’est-à-dire à l’époque où les libéraux avaient la cote à Ottawa et où les conservateurs étaient encore embourbés dans le scandale du Pacifique.
Macdonald ne céda jamais à propos des catholiques ni des vendeurs de rhum ; il devait gagner des votes aux endroits non soumis à l’emprise de Mowat. Il choisit plutôt, en 1882, de remanier la carte électorale à son avantage. Toutefois, comme il ne parvenait pas à neutraliser la loi Crooks et que, en 1883, le chef des conservateurs provinciaux, William Ralph Meredith*, ne réussit pas à regagner les catholiques, le Parti conservateur de l’Ontario était condamné à suivre la stratégie de Boultbee : courtiser « la classe agricole » en s’appuyant sur les protestants militants et les prohibitionnistes. Macdonald désavouait cette façon de faire et Meredith ne l’accepta jamais de gaieté de cœur, mais pour discréditer le gouvernement Mowat, collaborateur de la hiérarchie catholique, des conservateurs provinciaux exploitaient les événements générateurs de sectarisme : exécution de Riel ; adoption en 1888, par la province de Québec, de l’Acte relatif au règlement de la question des biens des jésuites ; rapide immigration francophone dans l’est de l’Ontario. En même temps, les prohibitionnistes étaient consternés de voir l’intérêt que le gouvernement avait dans la survie du commerce. Malgré tout, « la classe agricole » n’abandonna pas les réformistes au profit des conservateurs.
Cela s’explique en partie par le doigté avec lequel Mowat dispensait les faveurs, doigté évident dans les mesures que les conservateurs détestaient le plus. La loi Crooks créait peut-être des emplois, mais elle venait répondre aux débitants d’alcool qui avaient réclamé le resserrement de l’application de la loi sur les permis, et elle servait la cause de la tempérance. Le Division Courts Act de 1880, qui retirait aux juges de comté, nommés par le dominion, pour le donner à la province, le droit de nommer les greffiers et huissiers des tribunaux de division, se justifiait par le laxisme des greffiers et huissiers de l’ancien régime et par le grand principe du gouvernement responsable, qui, disait-on, exigeait que tout officier de justice soit nommé par la province. Durant longtemps, la probité avec laquelle Mowat avait coutume d’user du favoritisme étouffa le ressentiment qu’inspirait la politique centralisatrice de son gouvernement. Cette réputation d’honnêteté contribuait à la fidélité des électeurs grits. Pourtant, ce qui comptait infiniment plus, c’était le prestige dont Mowat jouissait à titre de champion de la vision réformiste du inonde – et, surtout, de l’idée que l’histoire du Haut-Canada était un combat contre l’oppression des ennemis de l’extérieur comme de l’intérieur – et le succès avec lequel, dans la controverse des droits provinciaux, il défendait les libertés de l’Ontario contre la montée de cette oppression.
Les études sur les élections ontariennes de la fin du xixe siècle laissent entrevoir que, surtout dans les régions rurales, on votait très souvent par attachement à une tradition qui s’enracinait dans l’identité ethno-religieuse. De 1875 à 1902, et même en 1894, au plus fort de la révolte de l’électorat agricole, le gouvernement provincial dut sa majorité à sa prédominance dans les parties rurales du sud-ouest de l’Ontario, vieux bastion réformiste. La circonscription de Mowat se trouvait au cœur de cette région. C’est là qu’il prononça son premier discours de premier ministre, en 1872, occasion de rappeler à des hommes dont les parents, sinon eux-mêmes, avaient participé à la rébellion 35 ans auparavant, les étapes de la grande lutte que l’on avait menée pour les principes réformistes. Partant de l’époque où les Haut-Canadiens étaient « sous la coupe du family compact » et où « les dépenses publiques échappaient à l’autorité du pouvoir législatif [...] état de choses auquel aucun peuple ne peut se soumettre docilement et en même temps être libre », il évoqua tour à tour les résolutions de 1841 en faveur du gouvernement responsable, l’obstruction systématique du gouverneur sir Charles Theophilus Metcalfe*, la résistance politique grâce à laquelle, enfin, « le gouvernement responsable a[vait] été instauré dans toute son intégralité », puis la période de « la domination du Bas-Canada », à laquelle le gouvernement Brown-Dorion, malgré sa promesse, n’avait pas pu mettre fin, en raison du « refus du gouverneur général de lui accorder la dissolution ». Cette longue bataille contre l’oppression, ponctuée de triomphes illusoires, c’était la Confédération qui en avait délivré le Haut-Canada, en apportant « [t]out ce pour quoi les réformistes avaient lutté à l’époque ».
La campagne de Mowat pour affermir les droits politiques et territoriaux de l’Ontario ne peut se comprendre que si l’on tient compte de sa fidélité à la tradition réformiste du Haut-Canada et de l’importance de la Confédération dans cette tradition. L’opinion commune est que les griefs constitutionnels de l’Ontario découlaient, de façon tout à fait secondaire, des querelles partisanes en général et du litige territorial en particulier. Or, c’est tout le contraire qui se produisit : les différends constitutionnels et le litige territorial vinrent ébranler jusque dans ses fondements la vision du monde des réformistes. En refusant de ratifier les frontières nord de l’Ontario définies par arbitrage en 1878 [V. Simon James Dawson], puis en annexant au Manitoba en 1881 une partie du territoire en question, Macdonald reprenait sa place parmi les bêtes noires des réformistes d’avant la Confédération : celle de laquais haut-canadien des despotes bas-canadiens. En refusant obstinément, de 1881 à 1883, de reconnaître le Rivers and Streams Act, il bafouait l’idée selon laquelle la Confédération avait établi l’autonomie politique du Haut-Canada et se présentait aux réformistes comme un émule de Metcalfe. Mowat, en se battant pour les droits provinciaux, cherchait simplement à obtenir des droits constitutionnels que, il en était certain, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique garantissait, et un territoire qui, selon lui, revenait de droit à l’Ontario.
Cette conviction que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique garantissait la souveraineté des provinces, Mowat l’avait déjà lorsqu’il accéda au poste de premier ministre. Pourtant, au cours des années où il avait été juge, plusieurs fonctionnaires impériaux avaient exprimé l’avis contraire. En 1868, Macdonald avait usé du droit d’annulation à l’égard d’une loi ontarienne précisément parce qu’elle présupposait la souveraineté provinciale. Juste avant l’entrée en fonction de Mowat, les légistes de la couronne en Angleterre avaient émis l’opinion que les lieutenants-gouverneurs ne pouvaient pas nommer des conseillers de la reine en usant de la prérogative royale, pouvoir rattaché à la souveraineté, quoiqu’une loi provinciale ne pourrait les y habiliter. Avisant froidement Macdonald que « la loi sur la Confédération cré[ait] des particularités qui, bien sûr, ne [pouvaient] pas exister en Angleterre et sur lesquelles, soit dit en passant, les légistes anglais [...] n’ [avaient] pas (pour ne pas dire plus) de compétence particulière pour se prononcer », Mowat s’empressa de faire adopter une loi provinciale qui déclarait qu’ « il [avait été] et [était] loisible » au lieutenant-gouverneur de faire ce que, d’après les légistes impériaux, il ne pouvait pas faire. En vain, il défia Macdonald de soumettre la question au Conseil privé. En 1874, après que Macdonald eut perdu le pouvoir à cause du scandale du Pacifique, Mowat fit adopter une loi sur l’administration des déshérences et confiscations, deux autres attributions de la prérogative royale. Sur l’avis de Télesphore Fournier*, ministre de la Justice dans le gouvernement d’Alexander Mackenzie, le gouvernement fédéral l’annula en la déclarant inconstitutionnelle, mais peu après, Edward Blake succéda à Fournier. Blake était d’accord avec Mowat et laissa l’Escheats and Forfeitures Act de 1877 entrer en vigueur. Cependant, il refusa lui aussi l’épreuve judiciaire.
La conception que Mowat avait de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique allait rencontrer peu d’opposition dans les tribunaux ontariens et au comité judiciaire du Conseil privé. Par contre, de 1878 à 1881, il essuya une série de revers à la Cour suprême du Canada, dans certains cas à cause de jugements qui venaient clore des affaires entendues en première instance à l’extérieur de l’Ontario. En 1879, dans l’affaire Lenoir c. Ritchie, plaidée d’abord en Nouvelle-Écosse, la cour démolit la position de Mowat sur la souveraineté provinciale en niant que les lieutenants-gouverneurs pouvaient nommer des conseillers de la reine même si une loi provinciale les y autorisait. En 1881, dans Mercer c. le procureur général de l’Ontario, elle s’appuya sur le jugement Lenoir pour frapper de nullité la loi de Mowat sur les déshérences. Dans Severn c. la Reine en 1878 et dans la Municipalité de Fredericton c. la Reine en 1880, les juges de la Cour suprême interprétèrent très largement les pouvoirs législatifs du dominion (surtout en matière de commerce) et très étroitement ceux des provinces.
La seule victoire que Mowat remporta au cours de ces années survint en 1880, dans Citizens’ Insurance Co. c. Parsons ; comme au procès Severn, il alla défendre en personne sa position sur la compétence provinciale. Dans cette cause, la majorité des juges de la Cour suprême renoncèrent à donner du pouvoir de légiférer sur le commerce une interprétation qui aurait pu invalider à la fois la loi Crooks et la loi sur les cours d’eau (non encore adoptée). Sans tarder, John Wellington Gwynne et Henri-Elzéar Taschereau*, les centralistes les plus convaincus du tribunal, pressèrent Macdonald de veiller à ce que le jugement soit porté en appel : « c’est, disait Gwynne, un premier pas vers la reconnaissance de la souveraineté provinciale, but poursuivi par M. Mowat, je crois ». Un an plus tard, le comité judiciaire du Conseil privé confirma l’arrêt de la Cour suprême. Mowat avait influencé l’issue du procès en faisant assumer les frais de l’intimé par la province et en indiquant aux avocats de celui-ci l’argumentation à employer : ces derniers devaient définir largement la compétence législative de la province et empêcher le dominion d’empiéter sur elle.
Vers cette époque, le gouvernement Macdonald fit deux gestes qui portèrent sur la place publique ce qui avait été jusque-là un conflit plutôt déguisé. Le débat sur les « droits de l’Ontario » était lancé. Il s’agissait tout d’abord du refus de reconnaître le Rivers and Streams Act [V. John Godfrey Spragge] – atteinte grave à l’autonomie provinciale, selon Mowat et son parti, et ensuite, de l’annexion au Manitoba d’une partie du territoire nordique revendiqué par l’Ontario – décision que les réformistes attribuaient à l’influence de la province de Québec. En janvier 1879, Mowat pouvait encore soutenir, comme il le faisait depuis 1872, que la Confédération avait mis « un terme à la domination des tories [canadiens-]français sur les affaires intérieures de l’Ontario ». Trois ans plus tard, il déclarait que, si la Confédération devait servir à nier les droits territoriaux et politiques de l’Ontario, il fallait en finir avec elle. Les hommes politiques réformistes sonnèrent le rappel de leurs troupes : les Ontariens n’étaient pas encore maîtres chez eux, la cause de l’autonomie politique n’avait pas encore triomphé...
Le combat s’intensifia à l’approche des élections fédérales et provinciales. William Ralph Meredith avait d’abord soutenu Mowat dans le débat frontalier, mais en janvier 1882, il fit volte-face avec son caucus. Il invoquait l’intransigeance de Mowat, même si, en fait, il avait changé d’idée en bonne partie à cause des pressions de Macdonald. Mowat offrit de soumettre le litige au comité judiciaire du Conseil privé à la condition que les terres soient rendues à l’Ontario en attendant le jugement. Il insista sur ce point de crainte que le procès ne soit prétexte à faire traîner indéfiniment les choses et que le dominion, pendant ce temps, ne continue de piller les richesses naturelles du territoire en question. Naturellement, Ottawa refusa, et Meredith dut emboîter le pas, révélant ainsi son asservissement à Macdonald. Néanmoins, aux élections fédérales de juin 1882, les conservateurs remportèrent une faible majorité des suffrages ontariens, résultats que Meredith interpréta comme un rejet de la position de Mowat sur la question territoriale et les affaires constitutionnelles.
Pourtant, Mowat trouva peut-être plus dur d’encaisser l’avis émis par le comité judiciaire du Conseil privé trois jours après le scrutin dans l’affaire Russell c. la Reine. Cet avis confirmait la validité de la loi canadienne de 1878 sur la tempérance (loi Scott) en des termes qui semblaient impliquer que le pouvoir fédéral de légiférer pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada était vaste et indéfini. En en prenant connaissance, Macdonald, entre autres, conclut que la loi Crooks était frappée de nullité. L’avis n’allait pas nécessairement aussi loin, mais il paraissait concéder que le Parlement pourrait adopter une loi identique à la loi Crooks et faire ainsi d’une pierre deux coups : détruire le système de permis grâce auquel Mowat avait tant de faveurs à distribuer et en créer un autre sous l’autorité du gouvernement du Canada. Pendant la campagne électorale, Macdonald avait parlé de Mowat comme de « ce tyranneau qui avait tenté de maîtriser l’opinion publique en étendant son emprise sur tous les postes, de celui de huissier d’un tribunal de division à celui de tavernier ». Il avait aussi nié toute valeur à la loi Crooks et promis sa propre loi sur les permis. La conclusion de l’affaire Russell semblait lui donner raison d’avoir joué d’audace.
Malgré ces rebuffades, Mowat décida de faire des élections provinciales un référendum sur les droits de l’Ontario. Les victoires remportées par les réformistes dans six des huit élections partielles tenues en octobre pour l’Assemblée l’y encourageaient. La campagne commença en janvier 1883 par un immense congrès d’orientation à Toronto. On parla de crise ; tout ce pour quoi les réformistes se battaient depuis un demi-siècle était menacé. « Le grand mal que nous supposions avoir été corrigé par la loi sur la Confédération persiste toujours », déclara Mowat aux 6 000 délégués, « et nous ne sommes pas plus libres qu’auparavant – le joug pèse autant qu’au moment où cette plainte fut prononcée pour la première fois ». « Les hommes de l’Ontario », proclamait le procès-verbal du congrès, « sont-ils, aujourd’hui, moins dévoués à la liberté que l’étaient leurs pères ? Ou sir John Macdonald pourra-t-il réussir là où sir Charles Metcalfe a échoué ? » Meredith et son caucus, disait-on, avaient trahi l’Ontario en faisant volte-face sur la question frontalière.
Les réformistes axèrent en grande partie leur campagne sur la personne de Mowat – sage, bienfaisant et puissant protecteur de son peuple, mais qui tenait du peuple sa sagesse et son pouvoir. Les délégués, disait-on, s’étaient rassemblés à sa demande ; il avait voulu, « en toute confiance, entendre leur verdict sur sa vie publique ». Mowat lui-même insistait sur la représentativité du congrès : il y avait là « des hommes de toutes les parties de la contrée et de toutes les couches de la population ». Le moment fort des cérémonies fut un discours louangeur sur le palmarès législatif de Mowat et sa fidélité aux principes réformistes. Les délégués, déclarait le compte rendu officiel, s’étaient réunis non pas simplement pour rendre hommage à cet homme, mais « pour l’aider par leurs conseils et le fortifier par une preuve tangible de leur respect et de leur confiance [...] Ils venaient du peuple et appartenaient au peuple. »
Les résultats furent décevants. Aux élections de février 1883, le gouvernement perdit 15 sièges et n’en remporta que 4 ; sa majorité n’était que de 9 sièges. L’air sombre, les réformistes parlèrent des magouilles d’Ottawa. « Partout [...] où nos amis peuvent être vaincus par l’argent et la fraude, l’argent et la fraude ne manqueront pas à cette fin », écrivit Mowat en novembre 1883 à Charles Clarke dans une lettre où il expliquait pourquoi il confiait le portefeuille de l’Éducation à George William Ross, et non à Clarke lui-même ou à un autre vieux routier du caucus provincial. Plusieurs députés avaient été invalidés pour cause de corruption électorale, et Ross, estimait-on, était le seul réformiste qui pourrait regagner Middlesex West, une des circonscriptions ainsi rendues vacantes. Chaque élection complémentaire était capitale, et l’on pensait que, par cette nomination, on s’assurerait sa candidature.
Des années plus tard, Ross émit l’avis que les réformistes avaient remporté les élections générales grâce au débat sur les droits provinciaux. Même à l’époque, ils n’avaient nulle raison de supposer que cela leur avait nui : avec un nombre supérieur d’électeurs inscrits, et malgré la corruption supposée des tories, ils avaient récolté leur part habituelle du suffrage et leur faible avantage coutumier sur l’opposition. La perte subie en sièges venait simplement corriger l’absurdité statistique de 1879 : une majorité de 28 sièges avec une majorité des voix à l’échelle provinciale de moins de 1 %. Avant que la nouvelle Assemblée ne se réunisse, en janvier 1884, le parti avait regagné trois des sièges remportés par les conservateurs, dont Middlesex West, et avait gagné Algoma (où, légalement, le scrutin n’avait pas pu se tenir avant mai). Mowat pouvait compter sur une confortable majorité.
Atout ou handicap, la lutte des droits provinciaux continuait ; les combattants étaient allés trop loin pour reculer. En mars 1883, Ottawa avait refusé pour la troisième fois de reconnaître la loi sur les cours d’eau. Quatre mois plus tard, Mowat affirmait l’autorité administrative de l’Ontario sur les terres annexées au Manitoba – coup d’éclat destiné à gagner Algoma, selon les conservateurs. En septembre, la loi fédérale sur les permis de vente d’alcool (loi McCarthy) instaurait dans tout le Canada un système semblable à celui que la loi Crooks avait créé en Ontario. La province imposa une taxe punitive sur les permis fédéraux en 1884 et Ottawa refusa de la reconnaître.
Cependant, la position de Macdonald était en train de s’effondrer, à cause du comité judiciaire du Conseil privé. En juillet 1883, le conseil avait conclu en faveur de l’Ontario dans l’appel de Mercer, où Mowat avait comparu en personne pour la province. Le comité n’avait pas abordé la question de la souveraineté provinciale, mais sa décision permettait aux tenants de cette cause d’espérer. En décembre, elle reçut un formidable coup de pouce. Dans Hodge c. la Reine, le comité Judiciaire déclara la loi Crooks valide, notamment pour le motif que les gouvernements fédéral et provincial avaient un égal statut constitutionnel – conclusion que le Conseil privé interpréterait finalement comme impliquant la souveraineté des provinces. Entre-temps, le jugement Hodge obligea Macdonald à soumettre la loi McCarthy à la Cour suprême du Canada, qui annula la plupart de ses articles. En 1885, le comité judiciaire atténua davantage la menace implicite dans Russell en condamnant la loi dans son ensemble.
Pour ce qui était de la controverse sur le droit d’annulation, le comité judiciaire mina la position d’Ottawa au début de 1884 par son avis dans l’affaire qui était à l’origine du Rivers and Streams Act, soit McLaren c. Caldwell. Ce que Macdonald n’avait cessé de dénoncer comme une atteinte aux droits des particuliers se révélait être la loi du pays par application d’une loi de 1849. Mais ce fut dans le litige territorial que Mowat remporta sa plus grande victoire. En décembre 1883, il persuada le Manitoba de soumettre la question au comité judiciaire sous une forme qui excluait les délais. Macdonald accepta à contrecœur l’entente entre les deux provinces, mais il insista pour que seule la question de la frontière soit déférée, et non celle de l’autorité sur les richesses naturelles du territoire en litige. Pendant l’été de 1884, Mowat se rendit à Londres et exposa le point de vue de l’Ontario devant le comité judiciaire. Il l’emporta haut la main.
À son retour, on l’accueillit avec des ovations et des envolées de rhétorique belliqueuse. Le 15 septembre, à Niagara Falls, des panneaux illuminés proclamaient : « Voici venir le conquérant » et « Bienvenue au champion de l’Ontario ». Faisant habilement allusion au lieu et au centenaire loyaliste, Mowat déclara qu’il « rev[enait] de livrer la bataille de l’Ontario » et que souvent, dans l’histoire, on avait fait des guerres longues, sanglantes et coûteuses pour de bien plus petites parcelles de territoire. Le lendemain, à Toronto, il y eut un défilé de 12 000 à 13 000 représentants de toutes les parties de la province et un grand rassemblement à Queen’s Park. D’autres manifestations triomphales suivirentà Woodstock et à Barrie. Mowat était au faîte de sa gloire.
Pourtant, il restait beaucoup à faire. Le litige territorial traîna jusqu’à ce que, en 1888, le comité judiciaire du Conseil privé conclue, dans St. Catharines Milling and Lumber Co. c. la Reine, que l’Ontario, et non le dominion, était propriétaire des richesses naturelles du territoire concédé à la province quatre ans plus tôt. Toujours en 1888, après qu’Ottawa eut encore refusé d’en référer au Conseil privé, Mowat fit adopter un projet de loi visant à mettre à l’épreuve la prétention des provinces à l’égalité constitutionnelle avec le dominion. La décision qui porta le coup de grâce à la position du gouvernement central fut rendue en 1892 dans une affaire venant du Nouveau-Brunswick, celle de la Banque maritime de la Puissance du Canada, mais elle s’appuyait sur Hodge. Le Nouveau-Brunswick était représenté au Conseil privé par sir Horace Davey, qui était rémunéré par l’Ontario depuis 1883 et avait comparu dans Mercer, Hodge et l’affaire de la loi McCarthy.
Déterminer les compétences législatives présentait des difficultés particulières parce que cette question était inextricablement liée à la réglementation du commerce de l’alcool. En 1890, cependant, Mowat modifia la loi Crooks en y ajoutant un droit de prohibition locale identique, en principe, à celui de la loi Scott. Si le comité judiciaire acceptait cette modification – et l’on pouvait penser qu’il le ferait, vu ses conclusions dans l’affaire Hodge et sur la loi McCarthy –, il devrait nécessairement analyser de plus près les motifs pour lesquels, dans Russell, il avait confirmé la validité de la loi Scott. Dans l’avis émis en 1896 à propos de la prohibition et que les centralistes du milieu du xxe siècle qualifieraient de coup mortel au pouvoir fédéral, le comité donna raison à Mowat sur le droit de prohibition locale, infirma Fredericton et adopta, sur l’interprétation des pouvoirs législatifs, des règles générales remarquablement semblables à celles que Mowat avait préconisées 15 ans plus tôt dans l’appel de Citizens’ Insurance Co. Une fois que le comité judiciaire eut infirmé Severn en 1897 et Lenoir en 1898, dans les deux cas à la suite d’un appel présenté par Mowat, on put dire que Mowat n’avait jamais perdu une cause constitutionnelle et qu’aucune de ses lois n’avait été invalidée par l’appareil judiciaire.
Le droit d’annulation fut le seul point où Mowat ne l’emporta pas tout à fait. La querelle de la loi sur les cours d’eau l’avait convaincu de la nécessité d’abolir le droit de veto fédéral. Cependant, en vertu de la théorie selon laquelle la Confédération était un pacte conclu entre les colonies, il fallait le consentement de toutes les provinces pour modifier l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Sur l’invitation du premier ministre de la province de Québec, Honoré Mercier*, Mowat accepta donc de participer à la conférence interprovinciale d’octobre 1887 à Québec. Sous la présidence de Mowat, la conférence adopta des résolutions sur le droit d’annulation et plusieurs autres questions relatives à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, mais comme il n’y avait pas de représentants de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Colombie-Britannique, Macdonald put les écarter en disant qu’elles ne reflétaient pas un consensus des provinces. Néanmoins, à compter de ce moment, le gouvernement fédéral hésita davantage à exercer son droit d’annulation pour des motifs politiques et, en général, les querelles de compétences se réglèrent devant les tribunaux.
Avant d’instituer le droit de prohibition locale, en 1890, Mowat avait fait adopter toute une série de modifications restrictives dans l’espoir de contrer la montée de la tendance prohibitionniste et les efforts déployés par les conservateurs pour faire de la loi Crooks un objet de scandale. Aux élections de 1886 et 1890, seul l’anticatholicisme fit peser sur le gouvernement une menace plus grande que la question de l’alcool, mais, en raison de sa position de défenseur de la province et de sa réputation de probité, Mowat put faire échec aussi bien aux militants prohibitionnistes que protestants. Les réformistes conservèrent leur supériorité dans le sud-ouest de la province et, grâce à des gains du côté des catholiques – francophones surtout –, ils purent, les deux fois, récolter leur part habituelle du suffrage et une large majorité. Selon Christopher Finlay Fraser, ce fut en 1886 que le parti remporta pour la première fois une majorité importante du vote catholique.
À l’approche des élections de 1894, cependant, Mowat se trouva de plus en plus coincé. À cause de la crise agricole, les fermiers commençaient à remettre en question leurs allégeances traditionnelles. Les deux partis en souffraient, mais les réformistes avaient davantage à perdre. Les questions de l’heure – prohibition, ressentiment rural à l’égard de la Politique nationale, hostilité sectaire envers les écoles séparées [V. D’Alton McCarthy*] – éclipsaient les droits provinciaux, leur cheval de bataille. Mowat soutenait, comme toujours, que la constitution n’autorisait pas la province à imposer la prohibition générale. Il en allait de même, indubitablement, de la réforme tarifaire. Quant à l’hostilité contre les écoles séparées, la province pouvait difficilement l’apaiser sans risquer que le dominion invoque l’Acte de l’Amérique du Nord britannique pour intervenir. Mowat parvint à contenir la menace prohibitionniste en 1893 en tenant un référendum sur la prohibition et en soumettant au tribunal la question de la compétence provinciale, mais, pour le reste, la province ne pouvait rien faire à moins de quitter la Confédération. Aux élections partielles de décembre 1893, les réformistes perdirent un siège sûr au profit d’une organisation « nativiste », la Protestant Protective Association, et un siège moins assuré au bénéfice d’une organisation d’agriculteurs politisés, les Patrons of Industry [V. George Weston Wrigley].
Au scrutin général de juin 1894, 94 sièges étaient en jeu, mais les réformistes ne présentèrent que 79 candidats, les conservateurs 65 et les Patrons 50. La Protestant Protective Association avait peu de candidats, mais un grand nombre de ceux du Parti conservateur et des Patrons adhéraient à son programme. Les premiers résultats donnèrent 47 sièges au gouvernement Mowat, 27 aux conservateurs et 17 aux Patrons ; 2 autres sièges allèrent à la Protestant Protective Association et 1 à un indépendant. Les élections complémentaires qui se tiendraient probablement avant le début de la session étaient d’une importance capitale, mais Mowat ne pouvait guère en influencer le cours. Toutefois, comme si souvent, ses adversaires lui fournirent des armes contre eux-mêmes. William Ralph Meredith, député de London à l’Assemblée, démissionna de son siège, et le caucus conservateur le remplaça comme leader par George Frederick Marter, prohibitionniste et ardent « nativiste », dans l’espoir de s’attirer le soutien des Patrons à l’Assemblée. Les réformistes remportèrent l’élection partielle haut la main, puis arrachèrent trois circonscriptions où les résultats initiaux avaient été annulés par un tribunal, soit une aux Patrons et deux aux conservateurs. Par la suite, les conservateurs et les Patrons se révélèrent incapables de toute alliance efficace à l’Assemblée. Finalement, les Patrons devinrent plus ou moins un appendice du caucus réformiste.
Le 4 mai 1896, après quelques semaines de négociations, on annonça que Mowat avait accepté de se joindre aux libéraux fédéraux de Wilfrid Laurier. Ce n’était pas la première fois qu’un chef libéral fédéral tentait de l’attirer à Ottawa. Mackenzie lui avait offert le département de la Justice quand Blake avait quitté le cabinet, en janvier 1878, mais Mowat avait refusé parce que des élections fédérales approchaient. En janvier 1887, à la veille d’un autre scrutin, Blake lui-même l’avait invité à lui succéder à la tête de l’opposition. Cependant, Blake avait reculé quand Mowat et son bras droit au cabinet provincial, Timothy Blair Pardee*, lui avaient signalé que le moment était mal choisi et que, en plus, Mowat n’ayant guère de fortune, il devrait reprendre la pratique du droit pour gagner sa vie s’il perdait son élection. En 1896, la conjoncture était différente. En Ontario, Mowat avait subjugué les Patrons et fait chuter le nombre de sièges conservateurs à l’Assemblée autant qu’on pouvait raisonnablement l’espérer. Des élections nationales se tiendraient en juin, et les libéraux semblaient avoir plus de chances de les gagner qu’en 1878 ou 1887, surtout si Mowat était avec eux.
Mowat contribua à la campagne des libéraux de deux manières. Les conservateurs avaient promis de forcer le Manitoba à révoquer l’abolition du double système d’enseignement public confessionnel [V. Thomas Greenway]. Laurier, lui, voulait négocier avec le Manitoba. Le concours de Mowat garantissait que Laurier, en négociant, tiendrait compte des droits provinciaux, ainsi que des susceptibilités des catholiques et des protestants, des francophones et des anglophones. Par ailleurs, sa présence rassurait les Ontariens, inquiets des orientations libérales en matière de commerce et de leurs implications politiques. À la conférence interprovinciale de 1887, il avait fait adopter une résolution déclarant que la réciprocité absolue avec les États-Unis serait profitable à l’économie canadienne et ne menacerait pas nécessairement le lien impérial. En 1888, le Parti libéral avait inscrit la réciprocité à son programme [V. sir James David Edgar*]. Pendant la campagne fédérale de 1891, Mowat contredit les conservateurs qui prétendaient que les tenants de la réciprocité s’étaient engagés secrètement à chercher à conclure une union commerciale et même politique avec les États-Unis. Après les élections, remportées par les conservateurs, il avait dirigé la lutte contre la remontée de l’annexionnisme. En mai 1892, il démontra sa fidélité à l’Empire en démettant de ses fonctions un annexionniste, le procureur de la couronne du comté de Dufferin, et en acceptant le titre de chevalier commandeur de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, qui lui avait été conféré le 25 mai. (II serait grand-croix de l’ordre le 22 juin 1897.) En juin 1893, il présida le congrès au cours duquel le Parti libéral avait officiellement mis la réciprocité sous le boisseau. Son arrivée sur la scène fédérale, en mai 1896, était un signe que les libéraux répudiaient l’annexionnisme et respectaient les forces économiques qui s’étaient mises en place au Canada au fil de 17 années de protection tarifaire. Pour gagner l’appui de Mowat, Laurier lui avait fait constituer une rente viagère avec des fonds privés et avait même évoqué la possibilité de lui céder la place de premier ministre advenant une victoire. Cependant, il est douteux que Mowat en souhaitait autant ou que Laurier ait été vraiment résolu à faire ce sacrifice.
Aux élections générales, les libéraux furent victorieux dans l’ensemble, mais ne remportèrent que 43 des 92 sièges de l’Ontario. Mowat était contrarié, mais ses collègues lui affirmaient que l’on n’aurait pas pu faire mieux. Après tout, le gouvernement conservateur de sir Charles Tupper* avait essuyé non seulement l’opposition des libéraux, mais aussi des Patrons of Industry, des conservateurs dissidents et des partisans du renégat conservateur D’Alton McCarthy. Mowat démissionna de ses fonctions provinciales en juillet et s’installa à Ottawa. Le 13, il fut assermenté ministre de la Justice et, deux jours plus tard, appelé au Sénat, où il devint leader du gouvernement. Cependant, il ne lui fallut que quelques mois pour découvrir que son nouveau rôle lui pesait. Vers 1890, ses collègues ontariens avaient commencé à assumer des fonctions dont il s’acquittait lui-même auparavant. Il était veuf depuis 1893. Au printemps de 1895, à la veille de son 75e anniversaire, il avait commencé à se sentir vieux, et Arthur Sturgis Hardy avait démenti la rumeur selon laquelle Mowat deviendrait ministre de la Justice dans un gouvernement libéral en déclarant qu’il n’en serait pas capable. Pendant la campagne fédérale de 1896, sa faiblesse l’avait contraint à limiter sa participation. Pourtant, en juillet, George William Ross affirmait à Laurier que Mowat pourrait « faire plus d’heures de dur labeur que tous les éventuels candidats à [son] cabinet » et Hardy notait que, à la perspective de s’installer à Ottawa, Mowat semblait avoir rajeuni de trois ou quatre ans. En février suivant, Mowat écrivait : « l’hiver et le travail à Ottawa semblent me convenir, car j’ai engraissé de plus de cinq livres ».
Pourtant, dès juillet 1897, il était prêt à prendre sa retraite. Il avait beau travailler en moyenne dix heures par jour, les dossiers s’accumulaient toujours sur son bureau. En outre, les compromis de la politique fédérale lui déplaisaient : « Mes collègues sont tous des hommes compétents, dit-il à Edward Blake, mais il ne règne pas parmi nous cette solidarité à laquelle j’avais été habitué durant tant d’années en Ontario, et il se fait beaucoup de choses que je n’aime pas et dont je déteste porter la responsabilité. » Faute de moyens (la rente prévue par Laurier ne rapportait peut-être pas assez, si même Mowat l’avait acceptée), il dut rester au département de la Justice jusqu’au 17 novembre 1897, date où le poste de lieutenant-gouverneur de l’Ontario se libéra. Il assuma cette fonction le lendemain sans enthousiasme : « Je serai une nullité en politique pour le reste de mes jours et, bien que je sois vieux, cette perspective ne m’enchante pas. »
Mowat s’était retiré à temps : en octobre 1898, il eut une légère crise d’apoplexie. Une autre attaque, en juin suivant, le laissa tout juste capable de remplir les devoirs essentiels de sa fonction. Pourtant, dès octobre 1899, il dit à Laurier qu’il espérait un autre mandat de cinq ans, en raison du salaire. La vie publique avait mangé toutes ses économies ; son seul revenu personnel lui venait de l’héritage de sa femme. Il ne précisait pas que, en plus, la famille de son fils Arthur, ruiné par des spéculations immobilières au Manitoba, était alors à sa charge.
Sans pitié, le temps sapait les énergies de Mowat. À la mort de la reine Victoria, en 1901, il n’arriva pas à rassembler ses idées pour donner une entrevue à un journal. À l’expiration de son mandat, en octobre 1902, il demanda à Laurier s’il ne lui serait pas possible de prendre sa retraite avec plein salaire. Ses fonctions lui pesaient beaucoup plus qu’au début ; il souhaitait être libéré de tout souci politique pendant le peu de temps qui lui restait à vivre. Le premier ministre le laissa en poste, mais ne fit rien pour lui garantir une pension ; il ne se rendit pas non plus à son deuxième souhait, qui aurait été d’avoir un autre mandat complet. En décembre, Mowat demanda avec angoisse quel sort il connaîtrait après avoir passé toute sa vie à servir la population. « Je suis un très vieil homme, confessait-il ; mon esprit et mon corps n’ont plus guère de vigueur. »
En janvier 1903, Mowat se fractura une cuisse en tombant. La blessure guérit moins vite que prévu ; en mars, il ne put inaugurer la nouvelle législature. Le scandale déclenché par Robert Roswell Gamey éclaboussait le gouvernement Ross, dont la majorité était minime. Aux Communes, des députés reprochaient à Laurier de garder un invalide en fonction. Dans les échos mondains, on se plaignait que le lieutenant-gouverneur manquait à ses obligations sociales. Mowat affirmait à Laurier qu’il se sentait capable de continuer, même si, en plus, il était en train de devenir aveugle ; une deuxième fracture, en avril, annonça que sa fin était proche. Tandis que Laurier et Ross pesaient le pour et le contre de son remplacement, il déclinait, entouré de ses proches. Il s’éteignit à sa résidence officielle le 19 avril.
Mowat était un homme courtaud, à lunettes, terne, et à la voix faible, mais son apparence était trompeuse. Selon sir John Stephen Willison*, rédacteur en chef du Globe de Toronto dans les années 1890, c’était « un politique consommé qui savait merveilleusement concilier devoir et occasion propice ». « Habile et prévoyant, poursuivait Willison, il n’entrait jamais en conflit ouvert avec les vérités chrétiennes. Aucun homme ne fut jamais plus prudent ou plus audacieux si la situation exigeait détermination et action. Son regard, derrière ses lunettes, était d’une simplicité et d’une franchise engageantes, mais, en même temps, son esprit réfléchissait aux moyens de confondre ses assiégeants. » Ces traits, avec sa « perspicacité devant les vanités et faiblesses de ses collègues », et la « ruse et [la] stratégie » – « technique délibérée, constante » – de son art politique, voilà ce qui était la source de son autorité « absolue » au sein du Parti réformiste provincial et de sa réputation dans l’opinion publique. À cela s’ajoutait son indépendance : « Sir Oliver Mowat, concluait Willison, n’eut jamais de maître et ne se laissa jamais séduire par l’adulation. »
Assurément, son gouvernement fonctionnait grâce à une ruse et à une stratégie des plus raffinées, et celles-ci ne venaient pas que de lui. Comme leurs services n’étaient pas sollicités à Ottawa, de fidèles ministres tels Fraser, Pardee, Hardy et Ross formaient le noyau d’un cabinet qui, d’après Willison, était « peut-être celui qui réunissait autant d’hommes de valeur, brillants dans les débats et supérieurs par leur sens de l’administration, que tout autre cabinet ayant existé au Canada ». Willison n’avait connu aucun homme politique qui avait, plus que Fraser, la « capacité de dégager instantanément la véritable signification d’une situation complexe », et il affirmait que Pardee pouvait toujours tout justifier. « Devant bon nombre des actions du gouvernement, écrivait Ross à propos de Pardee, il était impossible de ne pas reconnaître la touche de ce grand général. » De même, en suivant les grandes victoires stratégiques de ce gouvernement, nul ne peut manquer de noter que Crooks et Hardy participèrent à la rédaction de la loi Crooks, que Fraser apporta une contribution déterminante au concordat Lynch-Mowat et que, dans ses duels judiciaires avec Ottawa, Mowat eut, en Edward Blake et David Mills, des collaborateurs imposants.
Cela dit, Mowat lui-même ne manquait certainement pas d’astuce. Ross s’extasiait de le voir lire dans l’opinion publique comme dans un livre ouvert. Willison – qui, étant proche des hautes instances libérales, en savait beaucoup et, en tant que mémorialiste, n’avait aucune raison de dissimuler ce qu’il savait – le considérait de toute évidence comme le cerveau du gouvernement et voyait la preuve de son génie politique dans « le fait que pendant si longtemps, il eut de puissants appuis chez les commerçants d’alcool et de plus puissants encore chez les prohibitionnistes ». D’après Willison, il ne s’appuyait ni sur Blake ni sur Mills pour diriger la campagne des droits provinciaux « et ne laissait non plus aucun d’eux l’emporter sur son propre jugement ».
Mowat devait une grande partie de sa réussite à son air plutôt banal. Jamais il n’était flamboyant ni grossier comme le théâtral Macdonald, ni trop brillant comme Blake le cérébral. Ses ennemis se laissaient berner par ses allures modestes, sa candeur désarmante. Au plus fort de la bataille des droits provinciaux, Macdonald déclara que Mowat ne valait pas grand-chose : il n’était que « l’âme damnée de Blake ». En 1888, en apprenant sa sixième victoire consécutive au Conseil privé, il s’exclama : « Quelle chance Mowat a eue avec le C[onseil] P[rivé] ! [D’Alton] McCarthy n’arrive pas à comprendre cela. » Cette aptitude à n’avoir l’air de rien s’alliait chez lui à une tendance instinctive au secret. Conformément aux instructions qu’il avait données dans son testament, presque tous ses papiers furent détruits. En 1876, craignant d’avoir peut-être évoqué par mégarde, en Chambre, certaines opinions que Blake lui avait communiquées en privé, il écrivit une longue lettre angoissée : « Il n’y a aucune chose à propos de laquelle j’ai été plus scrupuleux, toute ma vie, que les obligations de confidentialité qui se rattachent aux lettres « personnelles » [...] Désormais, je dois redoubler de vigilance, même si, jusqu’à présent, l’imprudence et l’indiscrétion ne faisaient pas partie des péchés ou faiblesses auxquels je me croyais particulièrement enclin. » Aussi mortifié qu’il ait pu l’être par ce possible manquement aux usages, on le soupçonne d’avoir été encore plus mal à l’aise parce qu’il était sorti de sa réserve. C’était tapi dans cette réserve, comme dans un fourré, qu’il menait les hommes, en faisant habilement appel au meilleur d’eux-mêmes et sans doute, si nécessaire, en jouant non moins habilement sur ce que Willison appelait leurs « vanités et faiblesses ».
En 1889, Willison organisa une assemblée publique à Toronto afin que Laurier explique sa position à propos de l’Acte pour le règlement de la question des biens des jésuites. Laurier avait une personnalité si imposante qu’il parvint à contenir l’hostilité des auditeurs. Mowat, lui, sentant leur humeur, mis de côté le discours qu’il avait rédigé – un éloge de Laurier – et en improvisa un dans lequel il réussit à prendre ses distances par rapport au chef fédéral sans le répudier. « Circonspect comme toujours, rappelait Willison, il flairait le terrain, sans jamais faire un pas de trop ni s’aventurer sur une piste dangereuse. Laurier, au mieux, gagna seulement une partie de l’assemblée ; Mowat, lui, reçut l’ovation générale d’un auditoire qui prenait plaisir à voir avec quel mélange de douceur et d’adresse on le menait, tous sachant aussi bien que lui-même qu’il manœuvrait pour assurer sa propre sécurité. » Mowat souffla à Willison de détruire la copie que le Globe avait faite de son éloge à Laurier. « Tandis qu’il disait cela, ses yeux brillaient derrière ses lunettes. »
Vu ses extraordinaires talents de manipulateur et le plaisir qu’il prenait à jouer gros jeu, Mowat aurait pu être un escroc de premier ordre. Son sens du devoir le sauva de la malhonnêteté. Willison notait que son tempérament était essentiellement religieux. Si c’était le cas, il n’était pas de ceux qui pèchent d’autant plus aisément qu’ils croient au salut. Tout homme politique est nécessairement un opportuniste, mais Mowat s’efforça toujours d’être « un homme politique chrétien » – un opportuniste à principes. Ce souci de concilier devoir et occasion propice fut l’une des clefs de sa réussite. La virtuosité stratégique exige un esprit visionnaire autant que de la ruse, et la ruse de Mowat était d’autant plus efficace qu’elle était subordonnée à une pensée essentiellement morale.
Cet esprit visionnaire n’était pourtant pas facile à définir. Ceux de ses contemporains qui ont rédigé leurs mémoires, dont son gendre Charles Robert Webster Biggar, Willison, George William Ross et Hector Willoughby Charlesworth*, ont effleuré le thème du chef libéral plus conservateur que ses adversaires, sans résoudre le paradoxe. Willison, le plus clairvoyant, semble avoir été d’avis que les valeurs de Mowat venaient essentiellement des Baldwin plutôt que de George Brown – qu’elles étaient davantage celles d’un conciliateur que d’un agitateur – et qu’il n’était pas populiste : « Il avait la haute main sur « le peuple » de peur que celui-ci ne lui échappe. Jamais il ne crut que la voix de la démocratie était nécessairement la voix de Dieu. » Bien que libéral de nom, écrit l’historien Sydney Francis Wise, « Mowat, au fond, était conservateur au sens usuel du terme. [...] [Il] puisait assidûment dans le passé de l’Ontario pour justifier ses actes et, ce faisant, il synthétisait les traditions conservatrice et réformiste, invoquant sans distinction la mémoire de Robert Baldwin et de John Beverley Robinson [sir John Beverley Robinson*] ». Selon Wise, Mowat était par-dessus tout « un nationaliste ontarien à l’intérieur de la nation canadienne ».
Fondamentalement, les principes politiques que Mowat défendait étaient ceux-là mêmes qui animaient la grande tradition réformiste du Haut-Canada depuis les années 1820, à savoir, surtout, le droit de la collectivité haut-canadienne au gouvernement responsable et le devoir de fidélité à la constitution qui, censément, préservait ce droit. À l’origine, ce double principe était libéral plutôt que conservateur. Et il était loin d’être populiste, quoique l’idée selon laquelle le Haut-Canada subissait le joug de groupes d’intérêts aidés d’un oppresseur de l’extérieur ait eu une connotation populiste. Robert et William Warren* Baldwin n’étaient pas populistes, et leur façon de concevoir la politique haut-canadienne – conflit entre la collectivité dans son ensemble (le peuple) et une oligarchie – pouvait aller aussi bien avec une définition pluraliste ou libérale du peuple qu’avec une définition restrictive ou populiste. À compter des années 1830, à cause de l’afflux constant des immigrants britanniques, une définition englobante devint un impératif politique. La capacité de synthèse de Mowat se révéla donc très précieuse lorsque l’urbanisation et la dépopulation rurale vinrent éroder l’électorat traditionnel de son parti. Pourtant, cette tendance démographique adverse n’était pas un problème inédit ; elle n’était que la nouvelle manifestation d’un vieux problème.
Les Baldwin ne défendaient pas moins les droits de la collectivité bas-canadienne que ceux de la collectivité haut-canadienne, et ils exécraient l’ordre d’Orange. Ce fut leur respect pour les sentiments des francophones et des catholiques qui étaya moralement l’alliance des réformistes avec le nationalisme francophone dans les années 1840. Après l’avènement du gouvernement responsable, cette alliance prit fin : le Parti réformiste se scinda et les « bleus » s’associèrent à la nouvelle coalition libérale-conservatrice. Dès lors, George Brown redistribua les rôles d’oppresseurs extérieurs du Haut-Canada au clergé francophone et aux milieux d’affaires montréalais. Cette formule satisfaisait à la fois l’anticatholicisme et la francophobie qui caractérisaient le patriotisme britannique d’alors, et le ressentiment qu’éprouvaient des hommes d’affaires haut-canadiens devant l’hégémonie financière de Montréal. Sous Brown, la vieille hostilité contre l’oligarchie se transforma aisément en hostilité générale contre les groupes d’intérêts, sentiment qui, au milieu de l’époque victorienne, faisait partie intégrante du libéralisme.
Les principes de la tradition réformiste se révélèrent merveilleusement adaptés aux besoins que le Parti réformiste avait à l’époque de la Confédération et de l’industrialisation. La campagne de Mowat en faveur des droits territoriaux et constitutionnels de l’Ontario jouait sur les vieux préjugés des partisans de Brown et sur l’impatience des milieux d’affaires à renverser la domination montréalaise. Dans le litige frontalier, il fit le lien entre sa campagne et la tradition loyaliste en comparant le gouvernement du dominion aux envahisseurs de 1812 – ce qui, idéologiquement parlant, était un coup de maître. De même, dans les années 1890, il dirait que prôner l’annexion aux États-Unis, c’était trahir à la fois la tradition loyaliste et le principe du Canada First. Invoquer le devoir de fidélité à la constitution se révéla rentable aussi sur le plan électoral. Mowat pouvait, du même souffle, défendre les droits des catholiques ontariens et s’attaquer à leurs anciens protecteurs, les « tories de la province de Québec ». En effet, les écoles séparées, à l’instar des droits provinciaux, tiraient leur légitimité du fait que la Confédération était un « pacte », comme il le disait en 1890. En même temps, en adhérant à une définition libérale du peuple – plutôt qu’à une définition populiste – les réformistes justifiaient leur attitude à la fois équitable et conciliante envers les catholiques ontariens et les autres groupes dont ils avaient besoin pour élargir leurs assises électorales.
Dans un éloge funèbre à la Chambre des communes, Laurier déclara que, du point de vue de l’importance historique, la seule chose qui dépassait la politique de tolérance religieuse de Mowat était ce qu’il avait fait pour donner à la Confédération « son caractère de pacte fédéral ». C’était un jugement éclairé. Les griefs régionaux ne manquaient pas dans les années 1880, mais la campagne que Mowat mena durant 25 ans pour définir la constitution était unique. Plus que quiconque, probablement, il façonna la structure et le mode des relations fédérales-provinciales du xxe siècle. De même, personne n’aurait pu faire ce qu’il fit, à titre de premier ministre réformiste de l’Ontario, pour contenir l’hostilité qui opposa Canadiens anglais et Canadiens français dans la décennie qui suivit la pendaison de Riel. Le réseau de politiques et de dogmes sociaux que l’on appelle aujourd’hui biculturalisme s’inscrit peut-être dans la tradition baldwiniste de la tolérance, dont Mowat fut le grand porte-étendard à la fin du xixe siècle. Quoi qu’il en soit, il y avait un fondement historique à la déclaration que fit Laurier en mai 1896, en invitant Mowat à l’aider à chasser les conservateurs du pouvoir et à trouver, à la crise scolaire du Manitoba, une solution qui respecterait aussi bien les sentiments des catholiques que les droits provinciaux, à savoir que l’on reviendrait bientôt à « la grande époque de Baldwin et Lafontaine ». Avant de collaborer à la promotion des droits provinciaux avec Mercier, en 1887, Mowat avait défendu scrupuleusement les écoles séparées, tout comme les Baldwin, par leur respect pour les aspirations des francophones, avaient raffermi l’alliance des réformistes avec La Fontaine.
Laurier reconnaissait à Mowat le mérite d’avoir doté l’Ontario d’« un gouvernement qui [pouvait] être cité en exemple à tous les gouvernements : un gouvernement [...] honnête, progressiste, courageux et tolérant ». Il est juste de dire, en effet, que le gouvernement Mowat établit, en matière de mœurs politiques, des critères qui offraient un heureux contraste avec les excès du gouvernement Macdonald et ceux de plusieurs gouvernements du Québec. En outre, Mowat eut sur la suite de l’histoire du Canada des influences que Laurier n’avait peut-être pas discernées ou ne jugeait peut-être pas à propos de louer. Grâce à ses conquêtes territoriales, il donna à l’Ontario l’immense réservoir de richesses minières et forestières qui lui assurerait la prédominance dans la Confédération. La réaction prudente, calculatrice de son gouvernement aux problèmes de l’industrialisation et de l’urbanisation fut le prototype, sinon l’exemple parfait, de la politique du consensus. Souvent parcimonieuses, voire futiles quant au fond, ses mesures sociales contribuèrent à légitimer l’intervention de l’État, au nom du peuple, dans les activités commerciales et même dans les relations familiales. Dans ce sens limité, Mowat fut un pionnier de l’État régulateur et, pourrait-on dire, de l’État-providence au Canada.
La Confédération avait apporté tout ce pour quoi les réformistes avaient combattu jusque-là, déclarait Mowat aux électeurs d’Oxford North en 1872. Il ne précisait pas que, si c’était le cas, c’était parce que, en 1859, Brown et lui-même avaient convaincu le parti de lutter pour la fédération plutôt que pour la séparation. Pendant un moment, après avoir contrecarré les visées centralisatrices de Macdonald, on s’arrêta pour faire le point, mais les préjugés des partisans de Brown survivaient et les agriculteurs étaient toujours aux prises avec la Politique nationale. Quoi que Mowat eût pu faire si on l’avait empêché de mener sa campagne en faveur des droits provinciaux, il était loin d’envisager la sécession pour quelque autre motif. Assez curieusement, les ultra-protestants et les tribuns agrariens des années 1890 ne semblent pas l’avoir envisagée non plus, mais quand même, le Parti réformiste de l’Ontario se trouvait alors à un stade critique : ou il devenait exclusivement le porte-parole des agriculteurs, ou il risquait de perdre une bonne partie de ses appuis traditionnels.
Sir Oliver Mowat, dernier défenseur du patriotisme provincial des Baldwin, refusait tout choix de ce genre. Les membres de son parti estimaient que leur devoir était de défendre le peuple contre les groupes d’intérêts. Durant toute sa carrière de premier ministre, il s’employa à élargir leur définition du peuple. Il y fit entrer les ouvriers, les catholiques – et même les catholiques francophones. En concluant avec Laurier, en 1896, une collaboration qui reposait sur la reconnaissance des intérêts créés par la Politique nationale, il annonçait le ton de la politique libérale ontarienne. Désormais, les agriculteurs étaient un groupe d’intérêts comme n’importe quel autre, et il fallait aussi tenir compte des membres de la Canadian Manufacturers’ Association.
Pour la préparation de l’article qui précède, nous avons bénéficié d’une subvention de recherche accordée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. [p. r.]
On peut voir des portraits officiels de sir Oliver Mowat dans la Government of Ontario Art Coll. à l’Ontario Legislature Building, Toronto : un portrait à l’huile exécuté en 1892 par Robert Harris*, un autre, vers 1903, par John Wycliffe Lowes Forster*, un buste en plâtre réalisé par Walter Seymour Allward* vers 1903, et une statue de bronze en pied du même artiste, terminée en 1905, à Queen’s Park.
On trouve aussi quatre clichés originaux de Mowat dans la Photographie Records Coll. des AO. Deux sont des portraits officiels, pris vers 1860 et vers 1897. Les autres sont des photos de groupes : l’une des membres du cabinet de 1891, et une photographie sans date montrant le lieutenant-gouverneur Mowat à l’occasion d’une visite royale.
L’étude de documents juridiques américains faite par Oliver Mowat a paru sous le titre de « Observations on the use and value of American reports in relation to Canadian jurisprudence » dans Upper Canada Law Journal (Toronto), 3 (1857) : 3–7. Ses publications comprennent aussi A letter on the bill for quieting titles to real estate in Upper Canada, addressed to the Hon. J. A. Macdonald, attorney-general for Upper Canada (Toronto, 1865), de même que de nombreuses allocutions et notes rédigées durant son mandat comme premier ministre. On trouve des listes de ces textes dans le Répertoire de l’ICMH, Canadiana, 1867–1900, et O. B. Bishop, Publications of the government of Ontario, 1867–1900 (Toronto, 1976), 367–369. La plupart traitent de questions politiques, notamment du gouvernement en Ontario et de la question des écoles séparées, mais il a aussi rédigé une adresse intitulée Christianity, and some of its evidences [...] (Toronto, 1890), et une autre Christianity, and its influence [...] (Toronto, 1898), après sa retraite du Parlement.
Une collection de la correspondance de Mowat avec son frère John a été éditée par Peter Neary et publiée sous le titre de « Neither Radical Nor Tory Nor Whig : letters by Oliver Mowat to John Mowat, 1843–16 », OH, 71 (1979) : 84–131.
AN, MG 24, B40 ; MG 26, A ; B ; G.— AO, F 2, MS 20 ; F 3 ; F 23, MU 476, Mowat à Campbell, 25 sept. 1883 ; F 26 ; F 1027 ; RG 4 ; RG 24, Ser. 8.— Globe, 1853–1884.— Mail (Toronto), 25 oct. 1872, 7 janv. 1876, 7, 9 juin 1879.— Toronto Daily Mail, 2 juin 1882.
Christopher Armstrong, The politics of federalism : Ontario’s relations with the federal government, 1867–1942 (Toronto, 1981).— Fern Bayer, The Ontario collection (Markham, Ontario, 1984).— C. R. W. Biggar, Sir Oliver Mowat […] a biographical sketch (2 vol., Toronto, 1905).— Canada, Dép. de la Justice, Correspondence, reports of the ministers of justice, and orders in council upon the subject of dominion and provincial legislation, 1867–1895 [...], W. E. Hodgins, compil. (Ottawa, 1896).— Catholic appointments and the Mowat government ([Toronto ?, 1894 ?]).— Ramsay Cook, Provincial autonomy, minority rights and the compact theory, 1867–1921 (Ottawa, 1969).— Dent, Canadian portrait gallery, 2.— A. M. Evans, « The Mowat era, 1872–1896 : stability and progress », Profiles of a province : studies in the history of Ontario [...] (Toronto, 1967), 97–106 ; « Oliver Mowat the pre-premier and post-premier years », OH, 62 (1970) 137–150 ; « Oliver Mowat : vice-chancellor of Upper Canada, 1864–72 », OH, 71 : 75–82 ; « The Ontario press on Oliver Mowat’s first six weeks as premier », OH, 56 (1964) : 125–141 ; Sir Oliver Mowat (Toronto, 1992).— [M. W. Kirwan], Facts for the Irish electors ! : a faithful record of how the Reformers and Conservatives have treated the Irish people ([Toronto, 1886]).— J. C. Morrison, « Oliver Mowat and the development of provincial rights in Ontario : a study in dominion-provincial relations, 1867–1896 », Three history theses ([Toronto], 1961).— Oliver Mowat’s Ontario : papers presented to the Oliver Mowat colloquium, Queen’s University, November 25–26, 1970, Donald Swainson, édit. (Toronto, 1972).— Ontario, Legislature, Sessional papers, 1870–1871, n° 3 ; 1874, nos 4, 19 ; 1880, n° 20 ; 1888, n° 37 ; Statutes, 1873–1890.— Ontario elections, 1883 ; pamphlet no. 1 : legislative and territorial rights ([Toronto, 1883 ?]).— Paul Romney, « From the rule of law to responsible government : Ontario political culture and the origins of Canadian statism », SHC Communications hist., 1988 : 86–119 ; Mr Attorney : the attorney general for Ontario in court, cabinet, and legislature, 1791–1899 (Toronto, 1986).— G. W. Ross, Getting into parliament and after (Toronto, 1913), 192.— R. C. Vipond, « Constitutional politics and the legacy of the provincial rights movement in Canada », Rev. canadienne de science politique (Ottawa), 18 (1985) : 267–294 ; Liberty and community : Canadian federalism and the failure of the constitution (Albany, N.Y., 1991).— Willison, Reminiscences.— S. F. Wise, « Ontario’s political culture », The government and politics of Ontario, D. C. MacDonald, édit. (3e éd., Toronto, 1985), 159–173.
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Paul Romney, « MOWAT, sir OLIVER », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 mars 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/mowat_oliver_13F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/mowat_oliver_13F.html |
| Auteur de l'article: | Paul Romney |
| Titre de l'article: | MOWAT, sir OLIVER |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1994 |
| Année de la révision: | 1994 |
| Date de consultation: | 2 mars 2026 |