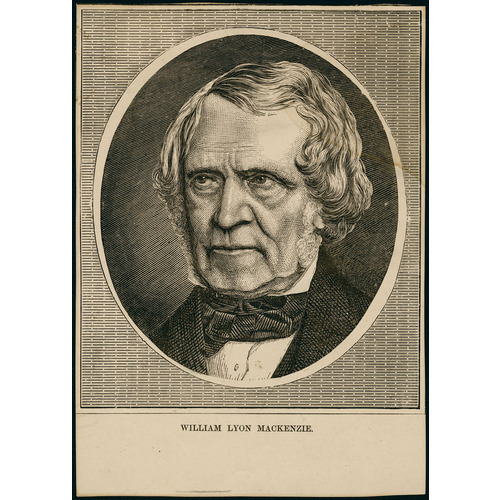Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2905324
MACKENZIE, WILLIAM LYON (il signait parfois Mckenzie ou MacKenzie), marchand, journaliste, homme politique, né le 12 mars 1795 à Springfield, Dundee, dans le Forfarshire (Angus), Écosse, enfant unique de Daniel Mackenzie, tisserand, et d’Elizabeth Chalmers, née Mackenzie, décédé le 28 août 1861 à Toronto, Haut-Canada.
Il est particulièrement important pour comprendre la carrière de William Lyon Mackenzie de séparer la réalité de la légende. Les études le concernant portent essentiellement sur ses activités politiques de 1824 à 1838 et ont ainsi contribué à faire de lui une figure légendaire. À une époque troublée où le despotisme qui suivit les guerres napoléoniennes s’effondrait, où le progrès de la technologie ébranlait la société et où le continent nord-américain s’ouvrait de plus en plus à la colonisation, il se distingua rapidement parce qu’il préconisait des changements radicaux. En outre, ses collègues et ses adversaires n’avaient pas le même pittoresque. Le sort voulut qu’il prenne l’initiative d’une rébellion qui fut considérée par les générations suivantes comme l’un des facteurs essentiels de l’évolution des institutions canadiennes et d’un idéal de démocratie, de justice et de liberté. La légende lui a prêté un rôle plus important qu’il n’était en mesure de jouer. S’il a fait l’objet d’un grand nombre d’études et de discussions, il reste l’un des personnages les plus méconnus de l’histoire du Canada. Il est lui-même à l’origine des équivoques dont sa carrière a fait l’objet : il avait l’habitude de noter en détail ses expériences et ses vues, mais souvent la mémoire lui faisait défaut ou bien ses observations étaient inspirées par les nécessités du moment.
Les ancêtres paternels et maternels de Mackenzie étaient originaires de Glenshee, dans la paroisse de Kirkmichael, au nord de Dundee. Son père et sa mère s’étaient mariés à Dundee le 8 mai 1794 ; sa mère, de 17 ans la plus âgée des deux, était veuve. Le père de Mackenzie mourut vraisemblablement le 9 avril 1795, trois semaines après la naissance de son fils, mais on n’a trouvé aucun document faisant état de l’inhumation. Bien que Charles Lindsey*, gendre et premier biographe de Mackenzie, affirma que celui-ci et sa mère endurèrent alors des privations, il est certain que leur bien-être fut assuré par des membres de la famille. Mackenzie indiqua lui-même qu’il avait gardé de bons souvenirs de sa jeunesse à Dundee : « c’est également là que j’ai reçu une partie de mon instruction et que j’ai passé quelques-unes de mes journées les plus heureuses[...] libre de tout souci ». On ne saurait trop souligner l’influence que sa mère eut sur lui. Comme son fils, Elizabeth Mackenzie était très fière mais elle était aussi, contrairement à lui, profondément religieuse ; elle s’était convertie à une secte presbytérienne sécessionniste (opposée au soutien de l’État) dont plusieurs membres devinrent des réformistes. Mackenzie ne tarda pas à rejeter les pratiques religieuses de sa mère, mais il conserva des principes rigides et puritains durant toute sa carrière.
Mackenzie (qu’on appelait alors « Willie » et parfois « Lyon » dans la famille) obtint une bourse d’études qui lui ouvrit les portes de l’école paroissiale de Dundee à l’âge de cinq ans. Par la suite, il fréquenta l’école d’un certain M. Adie où il accepta mal la discipline. Avec le soin méticuleux qui allait plus tard lui permettre d’établir un fichier grâce auquel il pouvait fustiger ses adversaires, il prit note des 958 livres qu’il lut entre 1806 et 1820, en indiquant l’année et le genre de volume. Il devint à 15 ans le plus jeune membre du service des informations commerciales d’un journal de Dundee. Il appartenait également à une société scientifique de l’endroit, ce qui lui donna l’occasion de rencontrer Edward Lesslie ; celui-ci et son fils James* furent les protecteurs de Mackenzie jusqu’à la fin de sa vie.
Il fut apprenti chez plusieurs marchands de Dundee, puis, en 1814, grâce à des fonds de Lesslie, il tenait avec sa mère un « magasin général » et une bibliothèque circulante à Alyth, 20 milles au nord de Dundee ; l’entreprise fit faillite durant la crise économique qui suivit les guerres napoléoniennes. Les dernières années que Mackenzie passa en Grande-Bretagne sont peu connues. Il retourna brièvement à Dundee, travailla en 1818 pour une société de construction de canaux dans le Wiltshire, voyagea en France et se rendit à Londres où, pense-t-on, il écrivit ses premiers articles pour les journaux. Il raconta plus tard qu’il avait mené une vie dissolue entre 17 et 21 ans et qu’il avait ensuite abandonné le jeu et la boisson. Le 17 juillet 1814, à Alyth, il avait eu un fils illégitime, nommé James. On ne sait rien de la mère, qui s’appelait Isabel Reid, mais l’enfant fut pris en charge par Elizabeth Mackenzie.
En 1820, Mackenzie s’embarqua pour le Canada en compagnie de John Lesslie, un autre des fils d’Edward. Après avoir travaillé quelque temps au canal de Lachine et rédigé des textes pour le Montreal Herald que dirigeait Alexander James Christie*, il alla bientôt s’installer à York (Toronto) où il fut employé par Lesslie dans un commerce de livres et de produits pharmaceutiques. Le Haut-Canada, qui allait devenir sa patrie d’adoption, lui fit immédiatement une impression favorable. Avant la fin de l’année 1820, il écrivait dans l’Observer d’York sous le pseudonyme de « Mercator ». À l’été de 1822, le reste de la famille d’Edward Lesslie arriva au Canada avec la mère de Mackenzie et Isabel Baxter (1805–1873), une jeune fille de Dundee qu’elle avait choisie pour être l’épouse de son fils. Le 1er juillet, à Montréal, Mackenzie épousa Isabel qui devait donner naissance à 13 enfants. Elle fut pour lui une compagne idéale : de santé robuste, elle se montra docile et patiente au milieu des nombreuses difficultés qu’il allait connaître.
Plus tard au cours de cette année, Edward et John Lesslie ouvrirent à Dundas une succursale de leur magasin. Ils avancèrent les fonds nécessaires et Mackenzie, en qualité d’associé résidant, s’établit à cet endroit pour vendre des articles de pharmacie, de quincaillerie et des marchandises générales, et diriger une bibliothèque circulante. Il se fit également concéder une terre de la couronne, mais son association avec les Lesslie tourna mal et dégénéra rapidement en une dispute si vive que Peter Paterson* aîné dut servir d’intermédiaire quand la société fut dissoute en janvier 1823. Après avoir tenté en vain de relancer l’entreprise, Mackenzie déménagea à Queenston dès octobre 1823. Il s’efforça d’y mettre sur pied un nouveau commerce et il fit la connaissance de Robert Randall* qui était membre de l’Assemblée. Lorsque Randall mourut en 1834, Mackenzie, à titre d’exécuteur testamentaire et d’héritier d’une partie des biens, entreprit une bataille qui allait durer 20 ans sur la question des propriétés foncières du défunt. Comme ses affaires à Queenston s’avéraient peu satisfaisantes, il lança le Colonial Advocate, son journal le plus connu. Le premier numéro parut le 18 mai 1824 ; son but avoué était d’influencer le résultat des prochaines élections. À l’époque, il défendait les liens avec la Grande-Bretagne, le droit d’aînesse et le principe des « réserves » du clergé, mais il faisait aussi l’éloge des institutions américaines. L’Advocate connut bientôt des problèmes financiers et des difficultés qui lui étaient faites par le bureau des Postes et ses agents. Dans une certaine mesure, Mackenzie avait lui-même provoqué ces ennuis en envoyant des numéros gratuits à un grand nombre de personnalités ; en outre, il avait pris l’habitude d’écrire à tous les gens influents.
En novembre 1824, il déménagea son entreprise à York où il se montra de plus en plus critique à l’endroit de l’establishment tory à mesure que ses propres dettes augmentaient. D’après Charles Lindsey, le journal tirait à 825 exemplaires au début de 1825, mais il devait affronter un concurrent réformiste, le Canadian Freeman, publié par Francis Collins* ; de fait, entre juillet et décembre 1825, le Colonial Advocate ne parut pas. En octobre, cependant, Mackenzie avait acheté aux États-Unis une nouvelle presse et des caractères d’imprimerie. Au début de 1826, il envisagea de transformer l’Advocate en un journal agricole ou de le vendre à Charles Fothergill* et de retourner à Dundas pour faire du commerce. Il modifia le ton de ses éditoriaux, ce printemps-là : ses attaques contre d’éminents tories comme William Allan*, la famille Boulton et George Gurnett devinrent plus grossières, mais ce journalisme à sensation, que les autres éditorialistes pratiquaient ouvertement, ne fit pas monter le tirage. En mai 1826, il gagna Lewiston, dans l’état de New York, pour éviter d’être mis sous arrêt pour dettes.
Une maladresse des tories permit à Mackenzie de se tirer d’embarras. Le 8 juin 1826, une bande de 15 jeunes gens, appartenant à de bonnes familles tory, qui agissaient peut-être à l’instigation de Samuel Peters Jarvis*, s’étant vaguement déguisés en Indiens, firent irruption en plein jour dans son bureau d’York, démolirent la presse et lancèrent les caractères d’imprimerie dans la baie. Les magistrats tories ne firent rien pour défendre la propriété de Mackenzie. Comme l’affirma Jesse Ketchum, un réformiste perspicace : « Le parti ministériel n’aurait pu trouver meilleure façon de se faire tort à lui-même. » De retour à York, Mackenzie refusa les £200 qu’on lui offrait en règlement et décida de traduire les huit principaux participants devant les tribunaux. Le procès fut tenu en octobre ; les intérêts de Mackenzie furent défendus par James Edward Small, Marshall Spring Bidwell* et Alexander Stewart de Niagara. Le jury accorda au plaignant une compensation de £625, somme qui excédait de beaucoup le montant des dommages. Grâce à cet arrangement, Mackenzie put rembourser ses créanciers les plus pressants et remettre ses affaires en bonne voie. Il ne cessa de faire allusion au procès, se rangeant lui-même parmi les martyrs de la liberté que le Haut-Canada comptait, selon lui, en la personne de Robert Thorpe* et de Robert Fleming Gourlay. Le jugement rendu avait cependant démontré qu’on pouvait obtenir justice devant les tribunaux du Haut-Canada. Par la suite, les tories exprimèrent leur dépit en faisant subir au petit Écossais toutes sortes de vexations.
Mackenzie s’intéressait de plus en plus à la question des droits politiques des immigrants américains [V. John Rolph]. À titre de secrétaire d’un comité chargé de faire signer des pétitions en vue de corriger la situation faite à ceux-ci, il exerça son influence afin que Robert Randall fût désigné en 1827 pour aller porter les pétitions en Angleterre. Avec l’aide de réformistes anglais comme Joseph Hume, Randall persuada le ministre des Colonies, lord Goderich, qu’une injustice était en train de se commettre, et la législature du Haut-Canada reçut instruction de présenter des projets de loi visant à accorder pleins droits aux citoyens d’origine américaine. Mackenzie découvrit ainsi l’utilité de s’adresser directement à Londres pour obtenir satisfaction.
Un autre requérant se trouvait à Londres en 1827 : John Strachan, rector d’York, demandait une charte universitaire en vue de fonder King’s College et faisait valoir les prétentions de l’Église d’Angleterre au revenu de la vente des réserves du clergé. Avec le révérend Adolphus Egerton Ryerson*, leader méthodiste, Mackenzie s’opposa immédiatement aux demandes de Strachan. Il annonça sa candidature aux élections qui devaient avoir lieu au printemps et il échangea des lettres avec des radicaux anglais comme Hume et des réformistes du Bas-Canada comme John Neilson*.
Mackenzie décida de briguer les suffrages dans la circonscription d’York qui comptait deux représentants et comprenait, par rapport à l’actuelle ville de Toronto, le secteur situé au nord de la rue Queen ainsi que les comtés d’York, de Peel et d’Ontario. La population, d’origine américaine dans une large mesure, semblait devoir être favorablement disposée à l’égard des réformistes. Trois autres membres influents de ce mouvement se portèrent candidats : Small et Robert Baldwin*, deux modérés, et Ketchum qui était plus radical. Voyant qu’il ne recueillait pas, au cours des assemblées, l’appui dont les autres étaient l’objet, Mackenzie défendit sa cause dans les journaux. Durant sa campagne de presse, il fit paraître une « liste noire » dans laquelle il se livrait à une véritable dissection de l’opposition, mais il fut pris à partie par les rédacteurs en chef des journaux tories et même par Francis Collins, qui lui donna le sobriquet de « William Liar [Menteur] Mackenzie ». La tactique, cependant, produisit d’heureux résultats : Mackenzie et Ketchum furent élus alors que les réformistes obtenaient une majorité écrasante.
Lorsque la session s’ouvrit au début de janvier 1829, Bidwell plutôt que Mackenzie fut élu président, seul poste que la majorité réformiste pouvait alors attribuer à son chef. Mackenzie pouvait néanmoins exiger des réformes. Sans plus tarder, il mit sur pied des comités en vue d’étudier la situation de l’agriculture, du commerce et des postes. En qualité de président du comité des postes, il fit la preuve que le bureau, sous l’autorité britannique, était rentable, et il recommanda que la direction en fût confiée au gouvernement de la province. Il dénonça également le fait que la Bank of Upper Canada était une société à responsabilité limitée et qu’elle exerçait un monopole ; c’était là un indice de son conservatisme rural, de son manque de confiance en cette sorte de compagnie et de sa croyance à la monnaie métallique. En outre, il estimait que le gouvernement ne devait plus engager de dépenses tant que la dette publique ne serait pas payée, même si cette dette était largement le résultat de travaux nécessaires au progrès de la colonie. Plus tard au cours de la législature, il blâma sévèrement la Welland Canal Company de ce qu’elle entretenait des liens étroits avec l’exécutif provincial et il critiqua les méthodes de financement des travaux adoptées par William Hamilton Merritt. Il se mêla aussi de la querelle qui éclata lorsqu’on voulut établir si l’aumônier de l’Assemblée serait ou non un anglican, ce qui montrait bien qu’il n’était pas en mesure de distinguer l’essentiel de l’accessoire.
En mars 1829, Mackenzie se rendit aux États-Unis pour acheter des livres en vue de les revendre et pour étudier les manières d’agir du nouveau président, Andrew Jackson. Il constata la simplicité et l’économie de l’appareil gouvernemental américain par rapport à celui du Haut-Canada ; il admira le spoils system (l’octroi des postes, après une élection, aux adhérents du parti arrivé au pouvoir), système qui lui semblait un moyen d’évincer les fonctionnaires membres du « Family Compact », et il apprécia les idées de Jackson concernant la monnaie métallique ainsi que son opposition aux banques. Comme le président, qu’il put rencontrer, Mackenzie était un homme dynamique et radical qui défendait ardemment les fermiers et les propriétaires indépendants, mais s’intéressait peu au sort des gens ordinaires. Il revint à York rempli d’admiration pour les États-Unis et leurs institutions, sentiment auquel allait bientôt s’ajouter un mécontentement de plus en plus vif à l’égard de la Grande-Bretagne.
La mort du roi George IV entraîna la dissolution de l’Assemblée en mai 1830 et, par suite, de nouvelles élections. Cependant, la situation avait beaucoup évolué depuis 1828. Sir John Colborne, gouverneur plus compétent et populaire que sir Peregrine Maitland*, avait réduit l’influence de Strachan et de ses partisans et renforcé le caractère britannique de la province par le biais de l’aide aux immigrants. En outre, l’Assemblée que dominaient les réformistes n’avait obtenu que peu de succès, faute d’expérience et d’organisation, en partie, mais également parce que les projets de loi étaient rejetés par le Conseil législatif. Dans la circonscription d’York, Mackenzie et Ketchum reçurent respectivement 570 et 616 voix, tandis que le plus proche candidat tory en obtenait 425. En tout, le groupe réformiste remporta moins d’une vingtaine des 51 sièges.
Après la défaite des réformistes, Mackenzie jugea que le régime démocratique du Haut-Canada était insatisfaisant. En plus d’être opposé politiquement aux tories, il provoqua la fureur de ceux-ci par de violentes attaques contre tous ceux qui lui déplaisaient et par les efforts qu’il fit en vue de politiser et de réformer tous les organismes dont il était membre. Par exemple, lorsque les tories mirent sur pied une société d’agriculture, durant l’été de 1830, il refusa de fournir sa cotisation tout en exigeant de prendre la parole aux réunions. Vers la même époque, il se joignit à l’église St Andrew, fondée par d’éminents tories de confession presbytérienne qui défendaient le lien entre l’Église et l’État. Il avait fréquenté l’église anglicane St James, comme il convenait à un membre de l’Assemblée, de même que l’église presbytérienne indépendante. Dès qu’il fut membre de St Andrew, il mena une campagne pour que l’Église rompe tous ses liens avec l’État ; il s’ensuivit une bataille qui dura quatre ans et ne prit fin qu’avec le départ de Mackenzie et du ministre.
Quand l’Assemblée se réunit en janvier 1831, il se lança à fond dans tous les débats ; il demanda des enquêtes sur les abus et, s’inspirant probablement du mouvement réformiste d’Angleterre, il exigea en particulier la révision du système électoral de la province. Il présida un comité spécial qui proposa l’augmentation du nombre des représentants, surtout dans les villes dont la population s’était accrue, et quelques bonnes idées telles que le vote en un seul jour et le vote au scrutin secret. En 1833, York, qui était pourtant un château fort des radicaux et que représentait Mackenzie, fut divisé en quatre circonscriptions ayant chacune un représentant. Mackenzie fit un travail moins constructif dans d’autres domaines et il provoqua l’impatience de l’Assemblée tory que dirigeaient des personnes mal disposées envers lui : le nouveau président de l’Assemblée était Archibald McLean et les leaders, le procureur général Henry John Boulton et le solliciteur général Christopher Hagerman*. Les ministres tories s’irritaient également des attaques menées par sir John Colborne qui réformait le Conseil législatif et ignorait Strachan et le Conseil exécutif. En outre, le gouvernement britannique élu en 1830 proposait de placer certains revenus sous le contrôle de l’Assemblée coloniale en retour d’une liste civile permanente. Bien que les réformistes réclamaient depuis longtemps un tel contrôle, la loi qui autorisait celui-ci fut qualifiée par Mackenzie de « loi du salaire éternel ». Pris dans un étau entre les réformistes et le ministère des Colonies, quelques députés tories, exaspérés, présentèrent sans succès une résolution visant à expulser Mackenzie de l’Assemblée ; ce dernier considéra cette tentative comme un « signe des temps ».
Mackenzie décida de faire valoir ses vues auprès des autorités britanniques comme l’avait fait le délégué Randall en 1827. Il passa une bonne partie de l’année 1831 à parcourir la province en propageant ses idées et en recueillant des signatures à l’appui des pétitions qui énuméraient des griefs ; il eut aussi des consultations avec les réformistes du Bas-Canada. Il recruta un grand nombre de partisans, surtout parmi les nouveaux immigrants irlandais et ceux qui étaient d’origine américaine. Les tories réagirent en préparant des contre-pétitions. À l’ouverture de la session de novembre, Mackenzie exigea une fois de plus des enquêtes sur la Bank of Upper Canada, le canal de Welland, King’s College, les revenus de la colonie et le salaire de l’aumônier. En même temps, il rédigea des articles plus violents dans le Colonial Advocate. Après qu’il eut qualifié l’Assemblée de « bureau de sycophantes », la majorité tory le fit expulser le 12 décembre par un vote de 24 à 15. Dans leur manque de perspicacité, les tories contribuèrent ainsi à rétablir sa réputation de martyr et à le mettre en situation de force au moment même où le système qu’ils représentaient était modifié sous l’action des modérés de la province et à la suite d’un changement d’attitude en Angleterre.
Le jour de l’expulsion de Mackenzie, une foule de plusieurs centaines de personnes envahit la chambre et demanda à Colborne de dissoudre le parlement. Le gouverneur refusa, mais les tories n’allaient pas tarder à s’apercevoir qu’il ne suffisait pas d’expulser Mackenzie de l’Assemblée : il fallait en outre l’empêcher d’y revenir. À l’élection partielle tenue le 2 janvier 1832, il fut réélu à 119 voix contre une. On lui remit une médaille d’or d’une valeur de $250 et on célébra sa victoire en formant un cortège de 134 traîneaux qui défila dans la rue Yonge au son des cornemuses, Mackenzie lui-même étant installé dans le traîneau de tête avec une petite presse qui imprimait des feuilles volantes. Il vivait ses plus belles heures de gloire.
Il ne pouvait donner aux tories une preuve plus éclatante de sa force politique, mais certains de ses adversaires, notamment Henry John Boulton et Allan Napier MacNab, manquaient de clairvoyance. Il se lança dans de nouvelles attaques et, le 7 janvier 1832, il fut encore une fois expulsé, puis réélu. La province était en ébullition, alors que Mackenzie suscitait l’envoi de pétitions à Londres et que les tories, par contre, fondaient la British Constitutional Society. Des incidents étaient à prévoir. Mackenzie sema le désordre dans une assemblée convoquée à York par l’évêque Alexander Macdonell* en vue d’exprimer l’appui des catholiques au gouvernement. À Hamilton, un magistrat tory, William Johnson Kerr*, attira Mackenzie hors de son hôtel et le fit battre par des hommes de main. Le 23 mars, à York, des apprentis irlandais, qui voulaient venger l’évêque, assaillirent Mackenzie et Ketchum en leur lançant des détritus. Plus tard le même jour, il y eut des émeutes dont Mackenzie ne sortit indemne que grâce à l’intervention du magistrat James FitzGibbon. Il dut se cacher jusqu’à son départ pour l’Angleterre en avril 1832 ; lors de réunions publiques on se mit d’accord pour couvrir ses dépenses.
À Londres, Mackenzie rencontra des réformistes tels que Joseph Hume et John Arthur Roebuck* et il demanda l’appui de la population par l’intermédiaire du Morning Chronicle. D’allégeance whig, le ministre des Colonies, lord Goderich – homme modéré et d’une grande perspicacité – voulait se renseigner afin d’être en mesure de réparer les injustices. Le 2 juillet, il reçut Mackenzie en tant que simple citoyen, de même que Denis-Benjamin Viger, de l’Assemblée du Bas-Canada, et le révérend George Ryerson*, représentant des méthodistes. Au cours de cette entrevue et de celles qui suivirent, on lui prêta, selon lui, une attention bienveillante. Goderich lui demanda un rapport sur le Haut-Canada et son bureau fut bientôt inondé de textes. Mackenzie profita de son séjour à Londres pour visiter la ville et assister aux débats parlementaires sur le Reform Bill ; il soumit ses doléances à la population britannique en faisant paraître Sketches of Canada and the United States.
À la suite des démarches de Mackenzie, lord Goderich envoya à Colborne, le 8 novembre 1832, une dépêche dans laquelle il recommandait d’effectuer certains changements d’ordre financier et politique et de mettre un terme aux tactiques de harcèlement employées en chambre contre Mackenzie. Au début du mois, toutefois, celui-ci avait été expulsé une troisième fois par les tories, in absentia, pour être aussitôt « réélu par acclamation ». La dépêche de Goderich arriva au Haut-Canada en janvier 1833 et souleva l’ire des tories qui, à l’instar des réformistes les plus radicaux, n’étaient pas disposés à accepter les décisions britanniques qui allaient à l’encontre de leurs intérêts. Le Conseil législatif refusa de se soumettre à l’autorité ; après un débat orageux à l’Assemblée, c’est à peine si l’on obtint une majorité suffisante pour faire imprimer le texte de la dépêche. En février 1833, la chambre priva Mackenzie de son droit de vote et refusa de tenir une nouvelle élection. Quand il fut informé de ces événements, Goderich releva Boulton et Hagerman de leurs fonctions respectives de procureur général et de solliciteur général. Colborne adressa des protestations au ministère des Colonies, tandis que les deux hauts fonctionnaires allaient porter plainte à Londres. Pendant ce temps, Mackenzie savourait sa victoire en visitant l’Angleterre, l’Écosse et une partie de la France en compagnie de son épouse.
En avril, cependant, lord Goderich fut remplacé au ministère des Colonies par un homme plus conservateur, lord Stanley, lequel réinstalla Hagerman à son poste et nomma Boulton juge en chef de Terre-Neuve. Il sembla donc à Mackenzie que tous ses succès avaient été effacés en moins de trois mois. Ce revers eut sur lui une influence décisive : il lui fit perdre toute confiance dans le recours aux autorités britanniques et accentua son penchant pour les États-Unis. Son ardeur s’éteignit et il se laissa gagner par le désespoir, oubliant que son voyage en Angleterre avait tout de même provoqué des changements dans le gouvernement et obligé les tories à montrer qu’au fond ils ne recherchaient que leurs intérêts. Le 5 décembre 1833, il manifesta ses nouveaux sentiments en supprimant le mot « Colonial » du nom de son journal. Il était revenu au Canada en août. Le 17 décembre, il fut déclaré exclu de l’Assemblée. Réélu sans opposition au cours du même mois, il tenta vainement par deux fois de reprendre sa place en chambre. Finalement, Colborne donne l’ordre de le laisser réintégrer son siège, mettant ainsi un terme à une série d’expulsions qui n’avaient rien d’honorable.
À cette époque, Mackenzie se brouilla avec Adolphus Egerton Ryerson et les méthodistes. Il avait bien accueilli la fondation du Christian Guardian en 1829, mais le radicalisme de Ryerson et de ses partisans se limita par la suite à la lutte qu’ils menèrent sur la question des privilèges accordés aux anglicans. En 1832, Ryerson se trouvait lui aussi en Angleterre où il négociait l’union des méthodistes canadiens et britanniques, se préparant ainsi à accepter l’aide de l’État. À son retour, il dénonça le radicalisme et attaqua Joseph Hume dans le Christian Guardian. Mackenzie répliqua et s’engagea dans un échange de propos acrimonieux qui lui mit à dos la confession religieuse la plus importante de la colonie et le journal ayant le plus fort tirage.
Une nouvelle arène politique s’ouvrit lorsque la ville d’York, le 6 mars 1834, fut érigée en municipalité sous le nom de Toronto. Les tories et les réformistes présentèrent des listes de candidats à la première élection, tenue, le 27 mars. Mackenzie se fit élire au conseil municipal, où les réformistes obtinrent la majorité, puis il fut désigné comme premier maire de Toronto par les conseillers, qui le préférèrent à John Rolph. En sa qualité de maire, Mackenzie était le président du conseil et le premier magistrat de la ville. Celle-ci avait de lourdes dettes et des règlements inadéquats concernant l’évaluation municipale, et de nombreux travaux publics étaient à faire. Le conseil, fort irascible, était difficile à diriger. Or, Mackenzie ne sut pas profiter des occasions qui s’offraient à lui. S’il pouvait mener ses attaques avec brio, ce « brandon de discorde » – comme on disait – se montra incapable de s’appliquer à résoudre les problèmes municipaux. Il consacra plutôt son temps à défendre les causes qui lui étaient chères ou à préparer les prochaines élections provinciales. À la manière typique des hommes politiques du temps, il se débarrassa des fonctionnaires tories, distribua des faveurs à ses partisans et entendit plus volontiers les contestations d’élection élevées contre des tories que celles mettant en cause des réformistes. Il laissa paraître sa grande fierté en exigeant qu’on lui témoigne le respect dû à son rang quand il présidait le conseil ou le tribunal. Ne pouvant s’appuyer sur des précédents ni compter sur des collaborateurs efficaces, il se trouvait devant une tâche difficile qu’une épidémie de choléra rendit encore plus complexe ; néanmoins, la façon dont il s’acquitta de ses fonctions de maire-le poste le plus élevé qu’il devait occuper – indique bien qu’il n’était pas en mesure de mettre lui-même en œuvre les réformes qu’il réclamait. Les maires qui vinrent après lui, réformistes ou tories, firent la preuve que la ville de Toronto, avec les mêmes problèmes financiers et, en grande partie, les mêmes conseillers, pouvait être administrée de manière plus satisfaisante. Dès le milieu de l’été de 1834, le conseil était devenu inefficace. Les réformistes subirent une cuisante défaite à l’élection municipale de 1835, et Mackenzie, dans son propre quartier, reçut le plus petit nombre de voix de tous les candidats au conseil.
En octobre 1834, cependant, des élections provinciales furent tenues, et Mackenzie, quelques mois avant l’expiration de son mandat à la mairie, remporta la victoire dans la seconde circonscription d’York, alors que les réformistes obtenaient la majorité à l’Assemblée. Les chances du parti n’avaient donc pas été compromises par la tempête de protestations qui s’était élevée (venant des réformistes autant que des tories et de Ryerson en particulier) lorsque Mackenzie avait publié une lettre de Joseph Hume en mai 1834, lettre qui dénonçait la « domination funeste » de l’Angleterre et semblait réclamer l’indépendance des colonies même au prix de la violence. En novembre 1834, persuadé que son siège à l’Assemblée allait lui permettre d’exiger des réformes et découragé par l’attitude inconséquente du ministère des Colonies dans l’affaire concernant Hagerman et Boulton, Mackenzie cessa de publier l’Advocate. Le journal passa aux mains de son collègue réformiste William John O’Grady*. Quand la session fut ouverte, la majorité réformiste, à la demande de Mackenzie, fit rayer des comptes rendus toutes les notes relatives aux expulsions dont il avait été l’objet. En outre, la nouvelle Assemblée le nomma président d’un comité spécial qui présenta, trois mois plus tard, le Seventh report [...] on grievances ; fidèle reflet des idées et des sentiments de Mackenzie, et de surcroît mal structuré, le rapport constituait néanmoins une énumération accablante des griefs principaux et secondaires, avec les divers correctifs qu’on pouvait leur apporter. Désigné par l’Assemblée comme représentant du gouvernement au conseil d’administration de la Welland Canal Company, Mackenzie examina de très près les finances de la compagnie ; par la suite, un comité de la chambre la blâma pour ses très mauvaises méthodes de gestion, sans toutefois dénoncer la malhonnêteté des administrateurs qui avait pourtant été mise en évidence.
Malgré les efforts de Mackenzie, il semblait bien que les réformes ne seraient pas effectuées puisque les autorités britanniques avaient donné instruction au nouveau lieutenant-gouverneur, sir Francis Bond Head*, de ne pas faire de concessions et que le ministre des Colonies, lord Glenelg, avait désapprouvé le rapport sur les griefs. Le lieutenant-gouverneur, considéré au début comme un partisan des réformes, en vint bientôt à s’opposer aux réformistes modérés et, particulièrement, à Baldwin et à Rolph – il avait lui-même nommé ces derniers au Conseil exécutif ; il se querella avec la majorité réformiste, prononça la dissolution de l’Assemblée et fit personnellement campagne contre les réformistes au cours des élections qui suivirent. Mackenzie versa des larmes à l’annonce de sa propre défaite aux mains d’Edward William Thomson, en juillet 1836. S’étant fait le défenseur du peuple, il ne pouvait croire que celui-ci l’avait abandonné. Il mettait son échec sur le compte de la corruption électorale. Il ne lui vint pas à l’esprit que l’appel à la loyauté lancé par Head et le tort fait à la cause réformiste par sa propre dispute avec la presse méthodiste au sujet de la lettre de Hume pouvaient avoir influencé les électeurs.
Dans les jours qui suivirent sa défaite, Mackenzie se hâta de fonder un nouveau journal, la Constitution, même s’il avait renoncé « pour toujours » au journalisme en 1834. Il voulait poser un geste symbolique en faisant paraître le premier numéro le 4 juillet 1836. L’admiration qu’il éprouvait pour les institutions américaines atteignait son point culminant. Cependant, au lieu de signaler dans son journal les nombreuses fraudes et injustices qui sautaient aux yeux (le rejet pour une question de procédure, par exemple, de la demande qu’il avait adressée à la chambre en vue d’obtenir une enquête sur les circonstances de sa défaite), il se contenta de rédiger des textes sur la question des changements constitutionnels.
Au printemps de 1837, toutefois, ses articles prirent un ton différent. Lorsqu’il apprit que les « Dix résolutions » de lord John Russell, ministre de l’Intérieur, enlevaient à l’Assemblée du Bas-Canada tout contrôle sur l’exécutif, Mackenzie se rendit compte, semble-t-il, qu’il ne pouvait plus rien espérer du gouvernement impérial. La Constitution, tout en soulignant la nécessité d’effectuer les réformes dans le respect des lois, faisait des allusions de plus en plus fréquentes à la possibilité de prendre les armes pour résister à l’oppression. À l’été de 1837, Mackenzie forma des comités de surveillance et des cellules politiques ; en août et en septembre, il répandit le message des réformistes de Toronto au cours d’une série d’assemblées tenues dans le district de Home. On adopta des propositions exprimant une vive inquiétude au sujet de la situation de la colonie et demandant une réunion des délégués des divers cantons et du Bas-Canada en vue d’étudier les mesures à prendre. Mackenzie contribua probablement à la rédaction d’un grand nombre de ces propositions, dont quelques-unes suggéraient vaguement le recours à la force, mais il y a des raisons de croire que Mackenzie et ceux qui allaient prendre la tête de la rébellion par la suite hésitaient à prendre les armes ou même rejetaient complètement cette solution. Les cellules politiques, d’après Mackenzie, avaient uniquement pour but de persuader le gouvernement que les réformes étaient désirées par la masse du peuple. De plus, il semble qu’aucun préparatif n’avait été fait en vue d’un soulèvement. Entre la fin de juillet et la fin d’octobre, une seule séance d’exercices militaires fut tenue, au nord de Toronto ; en septembre personne parmi les futurs chefs de la rébellion n’avait encore été mis au courant de quelque plan que ce soit.
S’il subissait les insultes et les violences physiques des bandes formées par les orangistes, Mackenzie recevait l’appui de foules nombreuses ; il en vint peu à peu à croire que la seule façon de supprimer la domination de Head, des membres du « Family Compact » et de leurs partisans orangistes, était de conduire ces foules enthousiastes à Toronto afin de renverser le gouvernement. Il savait qu’il ne s’agissait pas d’une entreprise facile. La perspective des réformes pouvait attirer la population aux assemblées et parfois même aux exercices de tir, mais les gens étaient foncièrement conservateurs ; pour les faire passer à l’action, il fallait les stimuler.
Mackenzie tenta d’abord de les mettre devant un fait accompli. Vers la mi-octobre, il organisa une réunion de dix réformistes radicaux au domicile de John Dœl* où les membres du mouvement avaient l’habitude de se rencontrer. Il proposa un plan suivant lequel « les employés du fondeur Dutcher et du fabricant de haches Armstrong », deux grands industriels de la ville qui étaient des réformistes radicaux, s’empareraient du siège du gouvernement le soir venu, après quoi on lancerait un appel général à la population pour qu’elle leur donne son appui. Head était particulièrement vulnérable à ce genre d’action : en réponse à une requête présentée par Colborne au début du mois, il avait dépêché au Bas-Canada tous les soldats réguliers de la province. Certains des participants à la réunion s’opposèrent à ce coup d’État, et Mackenzie suggéra alors d’organiser les fermiers pour qu’ils puissent résister au gouvernement.
Pour donner à son mouvement une allure respectable et pour circonvenir une population dont le conservatisme atteignait même les gens favorables aux réformes, Mackenzie eut recours à une ruse savante. Il confia à Rolph et au docteur Thomas David Morrison* qu’un groupe de l’extérieur de Toronto se préparait à envahir la ville. Avec l’aide d’un de ses principaux collaborateurs dans les régions rurales, Jessé Lloyd*, Mackenzie produisit une lettre écrite par Thomas Storrow Brown* de Montréal ; elle contenait, leur dit-il mensongèrement, un message secret suivant lequel les réformistes du Bas-Canada étaient sur le point de se révolter mais souhaitaient que les partisans du Haut-Canada opèrent une diversion en vue de détourner l’attention des troupes britanniques. N’étant pas tout à fait convaincus, Rolph et Morrison lui demandèrent de mieux se renseigner sur le sentiment populaire au nord de Toronto. Au lieu de cela, durant la troisième semaine de novembre, Mackenzie organisa une réunion des leaders réformistes venant des régions de l’extérieur de la ville les plus gagnées à la réforme. Assisté de Lloyd et, semble-t-il, de Silas Fletcher, il persuada ces gens qu’ils étaient en mesure de faire tomber le gouvernement avec l’appui de Rolph, de Morrison et de quelques membres du « Family Compact » qui étaient censés être en faveur du projet.
Après avoir décidé que le groupe entrerait en action le 7 décembre, Mackenzie revint à Toronto où il exposa l’ensemble du plan à Rolph et à Morrison. D’abord offusqués de ce que le leader leur tenait la bride haute, ceux-ci se rendirent à l’argument que les partisans étaient prêts et consentirent à se joindre au groupe une fois qu’il serait entré dans Toronto. Rolph ayant proposé d’engager un chef militaire, Mackenzie confia le commandement des troupes rebelles au colonel Anthony Van Egmond*, qui habitait dans le Huron Tract et qui était un ardent adversaire du « Family Compact » en plus de posséder une vaste expérience du métier des armes. Le 15 novembre, Mackenzie avait publié dans son journal un projet de constitution inspiré principalement du modèle américain, mais comportant aussi des idées réformistes empruntées aux radicaux anglais et divers éléments à caractère utilitaire. Par la suite, il fit connaître ses intentions immédiates de façon plus éclatante et il projeta d’annoncer, le 29 novembre, qu’une convention provinciale serait tenue le 31 décembre. On n’a jamais pu dire avec certitude ce que Mackenzie comptait faire si le soulèvement aboutissait à un succès. Il considérait probablement qu’un gouvernement provisoire, dirigé par Rolph, serait au pouvoir jusqu’à la tenue de la convention, alors que les membres de cette assemblée discuteraient le projet de constitution et décideraient d’une forme de gouvernement pour le Haut-Canada. Sans doute ses vues n’étaient-elles pas aussi nettes, mais il envisageait certainement de telles étapes.
Le 24 novembre, de retour dans la région rurale du nord de Toronto, Mackenzie s’efforça tant bien que mal d’organiser ses partisans et pressa ses amis de recruter leurs voisins. On ne fit aucune tentative, semble-t-il, pour agir de concert avec les rebelles du Bas-Canada, où la révolte avait éclaté durant la troisième semaine de novembre. Devant une foule nombreuse réunie le 2 décembre à Stoufferville (Stouffville), à quelque 25 milles au nord-est de Toronto, Mackenzie exposa un plan qui était une version élargie de celui qu’il avait proposé deux semaines plus tôt. Les insurgés du Bas-Canada, disait-il, étaient en voie de vaincre toutes les résistances et se trouvaient à empêcher les troupes d’atteindre le Haut-Canada par voie d’eau. Il affirmait à ses auditeurs que toutes les régions de la province étaient prêtes à un soulèvement général. Il leur demandait de marcher sur Toronto et de s’emparer du pouvoir, ce qui ne devait pas être une tâche difficile car plus de la moitié des citoyens étaient disposés à se joindre à eux, notamment des réformistes comme Rolph et Morrison et des hommes influents comme Peter Robinson*, George Herchmer Markland et John Henry Dunn*, lesquels, sans adhérer au parti, avaient manifesté leur sympathie en démissionnant du Conseil exécutif dirigé par Head. Il ne les invitait pas à se battre, mais simplement à effectuer une manifestation armée afin d’intimider des petits groupes de tories irréductibles. Une fois que le lieutenant-gouverneur serait entre leurs mains, disait-il, le gouvernement provisoire de Rolph allait distribuer toutes les terres des réserves à la population, plus précisément 300 acres à chacun des participants à la marche sur Toronto. On allait peut-être confisquer les biens fonciers de ceux qui ne voudraient pas prendre part à la marche, comme on avait fait dans le cas des tories lors de la Révolution américaine. Il se disait convaincu qu’un nombre suffisant de personnes, au jour convenu, allaient se rassembler à la taverne de John Montgomery*, située sur la rue Yonge, à plusieurs milles au nord de la ville.
Au matin du vendredi 1er décembre, Mackenzie avait rédigé une « Déclaration d’indépendance » qui devait être imprimée au cours de la fin de semaine et distribuée avant la marche du jeudi. Tout en se gardant bien de mentionner une date ou de révéler la nature de l’action projetée, il voulait que la population fût prête à se soulever dès qu’elle aurait pris connaissance de la « manifestation » de Toronto. Le dimanche 3 décembre, Mackenzie reprit la route de Toronto. Il apprit que Rolph, sur la foi de rumeurs (en réalité sans fondement) voulant que le gouvernement organisait une résistance, avait envoyé à Samuel Lount*, un leader réformiste du nord de la ville, un message lui enjoignant de passer à l’action le lundi avec quelques centaines d’hommes. Mackenzie tenta de renverser cette décision, mais Lount et sa troupe étaient déjà en marche vers le sud en direction de la taverne de Montgomery.
Quand les premiers groupes atteignirent le point de ralliement, le lundi soir, on débattit vivement la question de savoir si les hommes, fatigués par une longue journée de marche sur les chemins boueux, devaient entrer immédiatement à Toronto ou attendre au matin. On ne sait trop ce qu’en pensait Mackenzie, mais il décida qu’une patrouille de reconnaissance, dont il ferait partie, irait d’abord se rendre compte des moyens de défense mis en œuvre à Toronto. La patrouille rencontra un groupe de gens cherchant à vérifier les rumeurs qui circulaient ; parmi eux se trouvait l’échevin John Powell qui, après avoir tué Anthony Anderson, le seul homme de Mackenzie ayant une expérience militaire, s’enfuit et alerta la ville.
Le mardi, Mackenzie était dans un tel état de surexcitation qu’il posa des gestes fort désordonnés. Au lieu de mener ses troupes sur Toronto, il passa une bonne partie de la journée à exercer des représailles sur les familles ou les propriétés de certains tories. Étonnés de cette attitude, ses adjoints, entre autres Lount et David Gibson, s’efforcèrent de le retenir et de s’excuser auprès des victimes. John Rolph, qui avait été envoyé par le lieutenant-gouverneur pour détourner les rebelles de leur projet, pressa Mackenzie d’entrer dans la ville au milieu de l’après-midi. Finalement, le soir venu, le leader et ses hommes se dirigèrent vers leur objectif, mais ils essuyèrent le feu d’un petit groupe de gardes loyalistes dirigés par le shérif William Botsford Jarvis et ils furent facilement mis en déroute. Montrant, pour une fois, un certain sens du commandement, Mackenzie tenta alors de réorganiser ses troupes, mais il échoua dans ses efforts parce qu’il leur avait fait croire que l’opposition serait nulle ou de faible importance. Venus participer à une manifestation en armes et se retrouvant, plutôt, au milieu d’une violente rébellion, un grand nombre d’hommes regagnèrent leur foyer cette nuit-là et le lendemain.
Pendant la journée du mercredi, Mackenzie s’empara de la malle-poste en service à l’ouest de Toronto, tandis que le gros de ses troupes et les renforts venus remplacer ceux qui étaient retournés chez eux la veille se tenaient à la taverne de Montgomery. Le 7 décembre, date originellement fixée pour la rébellion, les défenseurs de Toronto, armés par le gouvernement et renforcés par d’importants groupes de loyalistes recrutés à l’extérieur de la ville, se mirent en route vers la taverne et remportèrent une victoire facile sur les troupes beaucoup moins nombreuses et mal équipées des intrépides rebelles et des nouveaux venus qui n’étaient pas encore informés de la situation. La date de l’attaque ayant été avancée, Van Egmond n’était arrivé à la taverne que quelques heures plus tôt ; il avertit les rebelles que la situation était désespérée, mais Mackenzie, sous l’effet d’une grande excitation, lui avait « braqué un pistolet sur la tempe » et lui avait ordonné de combattre même sans espoir.
La facilité avec laquelle la plupart des chefs de la rébellion et un grand nombre d’insurgés gagnèrent les États-Unis donne à penser que Mackenzie n’avait pas tout à fait tort quand il prétendait que la grande majorité des gens, les tories comme les réformistes, ne cherchaient pas à s’opposer aux rebelles et qu’ils étaient en faveur des réformes, sinon de l’insurrection. Cependant, Mackenzie lui-même eut beaucoup de mal à échapper aux loyalistes qui le poursuivaient et à atteindre la rive américaine près de Niagara.
La population frontalière des États-Unis s’intéressait de plus en plus aux affaires canadiennes surtout depuis que Mackenzie avait envoyé de la taverne de Montgomery, le 6 décembre, une lettre à un journal de Buffalo pour demander aux gens de soutenir la rébellion. L’arrivée de Rolph à Lewiston avait également provoqué un grand émoi. Mackenzie passa la frontière le 11 décembre et, le lendemain, devant un auditoire bien disposé, il parla des aspirations de ses compatriotes à la liberté. Il s’intéressa ensuite à un plan qui devait permettre d’envahir le Haut-Canada depuis l’île de Navy sur le Niagara, avec l’aide de volontaires américains commandés par Rensselaer Van Rensselaer. Malgré l’arrivée de vivres, de munitions, de canons et de plusieurs centaines de sympathisants durant les semaines qui suivirent, le plan échoua parce que Van Rensselaer et Mackenzie ne purent s’entendre sur les tactiques à mettre en œuvre et que les troupes britanniques et la milice canadienne, sous la direction d’Allan Napier MacNab, bombardèrent l’île et détruisirent le navire d’approvisionnement des Patriotes, le Caroline. Un grand nombre de volontaires avaient déjà abandonné les insurgés quand le gouvernement américain ordonna aux membres du groupe de quitter l’île s’ils ne voulaient pas être poursuivis en justice comme des criminels. La femme de Mackenzie, bien que malade, était venue le rejoindre ; il l’amena à Buffalo, où il fut arrêté pour avoir violé les lois américaines sur la neutralité. Remis en liberté sous caution, il retourna à l’île de Navy ; le 14 janvier 1838, toutefois, Van Rensselaer exigea que les troupes rebelles regagnent la rive américaine. Au cours du mois, Mackenzie alla s’établir à New York.
Le leader persista quelque temps à croire qu’une bonne partie des habitants du Haut-Canada étaient prêts à se soulever s’ils pouvaient compter sur une aide aussi importante qu’une invasion par des sympathisants américains. Cependant, en raison de l’opposition du gouvernement des États-Unis, du manque d’organisation et de l’apathie générale, l’année 1838 se passa sans qu’il n’y eût d’attaque contre le Canada. Mackenzie lui-même, après le mois de février, ne participa guère sinon pas du tout à l’organisation des coups de main et il en vint à la conclusion que les incursions mal préparées, loin d’aider les réformistes dans leur lutte pour la liberté, forçaient le gouvernement du Haut-Canada à les opprimer. En janvier 1839, il s’installa à Rochester où, au mois de mars, il fonda avec John Montgomery une association visant à regrouper les exilés canadiens et à empêcher la mise sur pied d’expéditions téméraires. Les propositions adoptées par l’organisme ne furent pas toutes rendues publiques ; toutefois, on peut déduire que les membres n’envisageaient de combattre le Canada qu’en cas de guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. L’association ne fut guère soutenue par les réfugiés et manqua de fonds. Cet échec ainsi que des difficultés personnelles et l’absence de collaboration des Américains amenèrent Mackenzie, vers la fin de 1839, à abandonner le projet d’envahir le Canada.
En avril 1838, les autres membres de la famille de Mackenzie étaient arrivés à New York même si le leader, qui avait contracté de lourdes dettes avant la rébellion, n’était pas en mesure d’assurer leur subsistance. Des partisans généreux avaient avancé l’argent nécessaire pour lui permettre de fonder dans cette ville, en mai 1838, la Mackenzie’s Gazette. Au début, le nouveau journal compta un grand nombre d’abonnés parmi lesquels se trouvaient des gens intéressés aux événements en cours à la frontière, curieux de lire les textes de Mackenzie ou soucieux d’appuyer la cause de l’indépendance canadienne. Mais en août 1839, le leader intervint dans la politique américaine pour la première fois en dénonçant l’attitude des whigs sur la question des banques. En décembre, il accusa le gouvernement démocrate dirigé par Martin Van Buren d’avoir été l’instrument de la tyrannie britannique en émettant une proclamation de neutralité. De tels commentaires politiques et la diminution de l’intérêt pour les affaires canadiennes éloignèrent peu à peu les lecteurs, et Mackenzie se trouva aux prises avec des difficultés financières encore plus sérieuses. En outre, il constatait avec chagrin qu’un grand nombre de réfugiés, dont Rolph et Bidwell, avaient rompu leurs rapports avec lui.
Ce fut en juin 1839 qu’il subit son procès pour avoir enfreint les lois sur la neutralité. Se croyant un expert en matière de droit, il assuma lui-même sa défense avec force détails et détours, mais il fut condamné à une amende de $10 et à 18 mois de prison. Déjà criblé de dettes, il dut faire face aux nouvelles dépenses occasionnées par le fait qu’il devait assurer, de sa prison, la publication de la Gazette, et ce fut la goutte qui fit déborder le vase. Ayant fait appel à la générosité des gens, il reçut des dons en argent et de nouveaux abonnements, mais les embarras financiers continuèrent de le harceler. Son journal ne parut que de façon irrégulière.
Mackenzie fut assailli par des difficultés encore pires. L’insalubrité de la prison, qui était située dans un marais où se déversaient les eaux industrielles, ne tarda pas à le rendre très malade. En novembre, l’un de ses enfants était au plus mal et la santé de sa femme s’altéra. Le mois suivant, il perdit sa mère qui avait été son principal soutien dans les moments critiques de sa carrière. Il apprit que le président Van Buren hésitait à se montrer clément envers lui par crainte d’indisposer la Grande-Bretagne. En février 1840, il était découragé au point d’écrire à un ami qu’on l’avait « enterré vivant ». Il adressa des mémoires au jury d’accusation du comté de Monroe, au gouverneur de New York, au procureur général, au secrétaire d’État et au président lui-même. De nombreuses pétitions furent également présentées en sa faveur. Le ton de ses mémoires fut d’abord celui du raisonnement prudent, puis de l’appel pressant et, enfin, de la critique acerbe ; cette progression se retrouve souvent dans sa correspondance.
Il fut gracié en mai 1840, après avoir fait moins d’une année de prison. Dans son acharnement à combattre l’injustice, il élabora d’autres plans qui dérogeaient à la neutralité américaine et il proposa que des « gens adroits et audacieux » brûlent les navires, les casernes et les entrepôts que les Britanniques possédaient au Canada. Il déclara dans la Gazette que la vie américaine n’était pas ce qu’elle était censée être et que Van Buren s’était montré mesquin à son égard. Toutefois, il était désormais trop tard pour exercer des représailles contre les États-Unis ou la Grande-Bretagne. L’ordre revenait à la frontière. En septembre 1838, Mackenzie avait fait le premier pas vers la citoyenneté américaine. Il lui fallait poursuivre sa carrière aux États-Unis, pays qui le décevait déjà. Les lettres qu’il rédigea durant ces années d’infortune font souvent allusion à la question de l’amnistie. Il se sentait d’autant plus frustré que les autres rebelles, y compris Louis-Joseph Papineau*, avaient obtenu leur grâce. Trop orgueilleux pour présenter lui-même une requête en ce sens, bien qu’il en était venu à admettre que la rébellion était une erreur, il pria certains réformistes influents, comme Isaac Buchanan*, d’intercéder en sa faveur. En attendant, il suivait avec impatience les changements qui se déroulaient sans lui sur la scène politique d’outre-frontière.
En raison de ses problèmes d’argent, de son impuissance à trouver un travail agréable ou acceptable et des décès et maladies qui accablaient sa famille, Mackenzie continuait de mener une existence misérable. Il était toujours au centre de quelque controverse. Il sut, cependant, gagner l’amitié et le soutien de certaines personnes, comme Horace Greeley*. En décembre 1840, il cessa de publier la Mackenzie’s Gazette parce qu’il n’avait pas obtenu assez de dons et d’abonnés et qu’il avait dû renoncer au « patronage » depuis l’élection du parti whig. En avril 1841, à Rochester, il réussit à lancer le Volunteer, dont il fit paraître 17 numéros, à intervalles irréguliers. Dans ce journal, il étudia les affaires canadiennes et tenta de susciter un conflit entre la Grande-Bretagne et les États-Unis au sujet du procès d’Alexander McLeod*, un Canadien arrêté en novembre 1840 dans l’état de New York et accusé de meurtre et de crime d’incendie relativement à l’affaire du navire Caroline. Mackenzie ne parvint pas à soulever l’opinion publique américaine et McLeod fut acquitté. Cet incident montre bien que Mackenzie était l’homme d’une seule idée : dans sa volonté de « libérer » le Haut-Canada en provoquant une intervention américaine, il ne se rendait pas compte qu’il risquait de déclencher une guerre susceptible de dévaster les provinces.
Le dernier numéro du Volunteer parut en septembre 1841, et Mackenzie, qui manquait d’argent et d’influence, exprimait ainsi sa déception: « plus j’en apprends sur ce pays, plus je regrette amèrement la tentative de révolution de Toronto ». Avec sa famille, en juin 1842, il quitta Rochester pour s’installer à New York où il se lança dans diverses entreprises d’édition, refusant toutefois d’accepter un poste de rédacteur dans un journal. En août, il devint registraire et bibliothécaire de l’institut des artisans. Il ne recevait qu’un traitement d’environ $400, mais il était logé, et si son travail était « plutôt fastidieux », il était en mesure de joindre les deux bouts. Il obtint la citoyenneté américaine en avril 1843.
À l’automne, il rédigeait l’histoire d’un groupe de 500 patriotes irlandais ; il préparait un nouveau journal et faisait des démarches en vue de se faire donner le poste d’inspecteur au Bureau de la douane de New York. Quittant l’institut des artisans, il entreprit la publication de l’Examiner, dont il ne put faire paraître que cinq numéros. Le poste qu’il convoitait aux douanes ne lui fut pas accordé, mais il publia, au début de 1844, la première partie de l’ouvrage intitulé The sons of the emerald isle et il parvint presque à rentrer dans ses frais. En juillet 1844, il fut nommé commis à la douane avec un salaire de $700 par année ; toutefois, en juin 1845, il démissionna de ses fonctions quand le poste de receveur des douanes fut confié à un conservateur.
Pendant son séjour au Bureau de la douane, Mackenzie transcrivit ou s’appropria les papiers de Jesse Hoyt en vue de les publier ; ancien agent de douane, celui-ci avait eu des rapports étroits avec le président Van Buren et l’Albany Regency, groupe politique qui exerçait le pouvoir depuis longtemps dans l’état de New York. La vente du volume atteignit 50 000 exemplaires, et Mackenzie, qui n’en retira aucun bénéfice, fut critiqué pour avoir publié des documents privés à seule fin de dévoiler des scandales impliquant son ennemi, Van Buren. Aucunement intimidé, il fit paraître la seconde partie de son histoire des patriotes irlandais et, en avril 1846, il publia une biographie de Van Buren dans laquelle celui-ci était l’objet de vives critiques.
En mai 1846, Mackenzie fut envoyé à Albany par la New York Tribune de Horace Greeley afin d’assurer le compte rendu de l’assemblée constituante de l’état de New York. Les participants en arrivèrent à des changements radicaux : ils rendirent certains postes électifs et abolirent des institutions comme la Cour de la chancellerie ; ces prises de position eurent une forte influence sur les opinions politiques que Mackenzie allait exprimer au Canada dans les années 50. Il demeura à Albany jusqu’au printemps de 1847 et dirigea l’Albany Patriot. De retour à New York durant l’hiver de 1847–1848, il travailla à la Tribune et fit paraître des almanachs pour le compte de Greeley.
En février 1849, le gouvernement de Robert Baldwin et de Louis-Hippolyte La Fontaine fit adopter d’importants projets de réforme, y compris une loi d’amnistie. Mackenzie obtint sa grâce, s’étant abaissé à adresser par lettre une demande en ce sens à James Leslie*, qui était devenu secrétaire provincial. Il entreprit aussitôt une tournée qui le mena de Montréal à Niagara, mais il affirma qu’il n’avait pas tellement envie de rester au Canada en permanence mais plutôt de chercher à obtenir le droit de revenir s’il le désirait. Un retour définitif au pays signifiait qu’il lui faudrait trouver un emploi. Son esprit d’indépendance lui interdisait de travailler pour l’Examiner de Toronto, qui appartenait à Lesslie mais dont il déplorait les tendances annexionnistes, et il souhaitait diriger son propre journal. Il craignait également d’être poursuivi en justice par ses créanciers. À la fin de 1849, il fit un autre voyage à Toronto et à Niagara, mais il ne demeura pas au pays. Greeley, en qui Mackenzie trouvait un protecteur aussi patient aux États-Unis que les Lesslie l’avaient été en Écosse et au Canada, le fit travailler comme correspondant à Washington de la New York Tribune en janvier 1850 ; toutefois, Mackenzie quitta ce journal en avril et il revint s’établir à Toronto au début de mai, même s’il n’était pas assuré d’être bien accueilli ni d’être en mesure de faire vivre sa famille.
Mackenzie fit paraître d’autres articles dans la Tribune, collabora à la Niagara Mail et écrivit régulièrement dans l’Examiner. Lesslie lui offrit un poste permanent au journal en vue de hâter l’instauration de réformes radicales mais il refusait tout emploi à plein temps. Il s’efforça plutôt de recouvrer les sommes d’argent qui lui étaient dues, selon lui, depuis les années 30. Le comté d’York lui versa $1200 et il reçut £250 du gouvernement provincial pour services rendus en qualité de commissaire au canal de Welland. Sans tenir compte pour l’instant de ses créanciers, il tenta de se faire réélire au parlement. Au printemps de 1851, il fut élu dans le comté de Haldimand ; il battit entre autres George Brown*, directeur du Globe, qui n’avait pas la renommée de son adversaire et qui était surtout connu pour son opposition aux catholiques, dans une circonscription où le vote des membres de cette confession religieuse était important.
À l’Assemblée, Mackenzie appuya les mesures visant à une « réforme véritable », quel que fût le parti ou le groupe qui les présentait. Il s’intéressa à plusieurs questions débattues depuis les années 30, comme les réserves du clergé, l’aide de l’État aux collèges confessionnels et la Cour de la chancellerie. Lui qui s’inquiétait toujours des dépenses exagérées du gouvernement et du monopole qu’il exerçait, dénonça les subventions accordées aux projets de chemin de fer ainsi que les sociétés ferroviaires qui recevaient cette aide sans qu’une saine administration ne fût assurée par la concurrence ou la surveillance de l’État. La méfiance qu’il éprouvait depuis longtemps à l’égard des avocats et de la complexité des lois l’amena à présenter un projet visant à simplifier les dispositions légales et à les réunir dans un code, afin de permettre aux citoyens de se défendre eux-mêmes devant les tribunaux. Ce projet, qu’il soumit de nouveau durant les sessions suivantes, et d’autres du même genre, ainsi que son humeur parfois espiègle, parfois méchante, lui valurent d’être considéré comme un excentrique. En outre, comme il ne reçut pratiquement aucun appui pour défendre cette mesure et d’autres par la suite, il perdit graduellement sa réputation d’homme redoutable.
En 1851, toutefois, Mackenzie fit sentir sa présence. Il mena sur les affaires gouvernementales l’une de ces enquêtes redoutables dont il avait le secret et, par les attaques qu’il dirigea contre la Cour de la chancellerie, on estime qu’il fut l’un des responsables de la démission du premier ministre Robert Baldwin [V. William Hume Blake]. On croit également que Mackenzie, en menant une campagne contre ceux que lui et Lesslie appelaient les « faux » réformistes, contribua à la défaite de plusieurs collègues, dont Baldwin, aux élections tenues à l’automne. Il fallut donc qu’on tienne compte de lui en 1852, alors que Francis Hincks* eut des rencontres avec les responsables du nouveau mouvement des Clear Grits au sujet de l’union des groupes réformistes. Cependant, Mackenzie déclina l’invitation d’assister aux négociations car il voulait préserver sa « liberté d’action ». Par la suite, John Rolph, qui était entré avec Malcolm Cameron* au ministère dirigé par Hincks et Augustin-Norbert Morin, discuta avec lui à propos de postes à distribuer dans le comté de Haldimand et lui offrit même un emploi bien rétribué. Mackenzie refusa cette offre quand il apprit que le poste serait créé spécialement pour lui et alourdirait le fardeau des contribuables.
Après ces succès, Mackenzie joua un rôle de moins en moins important. Il s’aliéna la sympathie de Hincks et de Rolph en fustigeant le gouvernement pour sa mauvaise administration et son attitude hypocrite à l’égard des réformes. Il fit éclater son indignation contre les faux réformistes lorsque fut révélée, en mai 1853, l’affaire du « tripotage de £10 000 » dans laquelle Hincks et le maire de Toronto, John George Bowes, avaient réalisé des bénéfices aux dépens du public en négociant des obligations de chemin de fer. Il affirmait avec vigueur que le gouvernement, y compris Rolph et Cameron, sacrifiait les principes réformistes afin d’obtenir le pouvoir. En mars et avril 1854, il rompit complètement ses relations avec Rolph (notons que celui-ci avait justement négligé, cette fois, de le consulter sur les postes à distribuer dans Haldimand) en l’accusant, dans le Mackenzie’s Weekly Message, d’avoir agi d’une manière perfide durant les pourparlers relatifs à la reddition des insurgés de 1837.
Dans d’autres domaines également, tout n’allait pas au mieux pour Mackenzie. À la fin de 1852, il offensa James Lesslie, son plus important allié au Canada et peut-être son meilleur ami, en lui refusant la permission de réviser avant publication une lettre qui attaquait violemment la politique concernant les terres de la couronne. Lesslie lui interdit d’écrire dans l’Examiner ; ils se réconcilièrent par la suite, mais Mackenzie avait alors fondé le Message (qui allait devenir le Toronto Weekly Message). Malgré les nombreux abonnements du début et un montant de $2 000 fourni par des amis, le journal connut des problèmes financiers dès la première année. En même temps, Mackenzie était de plus en plus harcelé par ses vieux créanciers. Comme il ne rejoignait qu’un nombre limité de lecteurs par le Message, ses attaques, solidement documentées, ne pouvaient empêcher un gouvernement visiblement corrompu de se livrer à une orgie de « patronage » et de dépenses inconsidérées. Ces abus lui firent perdre toute confiance dans le régime de la responsabilité ministérielle et l’amenèrent à souhaiter des réformes « démocratiques » suivant lesquelles le gouvernement serait contrôlé par le peuple plutôt que par les hommes politiques. Cependant, les mesures qu’il proposa au début des années 50 furent presque toutes rejetées. Il s’aliéna aussi le principal adversaire du gouvernement, George Brown, dont il ne cessait de souligner la fausse attitude réformiste et les attaques malavisées contre les catholiques. Mackenzie se dépensait en pure perte car il appuyait toujours Brown durant les élections, considérant qu’il était le moins pire des candidats.
À l’été de 1853, Mackenzie était isolé de tous les réformistes influents, dégoûté de la politique d’alors et accablé par de sérieux problèmes d’argent ; il commençait à mettre en doute la valeur même de l’Union des Canadas. Au milieu de l’année 1854, il arriva à la conviction que les Canadiens français recevaient bien plus qu’ils ne donnaient, et cela au détriment des habitants du Haut-Canada. Il estimait donc de plus en plus qu’il fallait dissoudre l’Union.
Dans les années 1854 à 1857, Mackenzie eut encore l’occasion de participer à l’élaboration d’une politique d’ensemble pour le mouvement réformiste. On sollicita son avis en 1854, alors que des lettres lui parvinrent de la plupart des fondateurs du mouvement clear grit et d’autres éminents partisans de ce groupe, dont James Lesslie, David Christie*, Charles Lindsey, William McDougall* et Alexander Mackenzie* ; ces gens estimaient tous que Mackenzie, malgré son esprit quelque peu confus, était un véritable réformiste. Ils étaient déçus de la qualité des réformes apportées par le ministère Hincks-Morin, mais ils n’avaient pas d’autre choix que d’appuyer Hincks puisqu’ils rejetaient les idées des tories. Lorsque le gouvernement démissionna en septembre 1854, défaite que Hincks, à tort ou à raison, attribua partiellement aux attaques solidement charpentées de Mackenzie, ils cherchèrent à donner plus de pureté au mouvement réformiste et, naturellement, ils voulurent s’assurer la participation de Mackenzie.
En novembre 1854, Lesslie proposa de fusionner l’Examiner ainsi que le North American de McDougall avec le Message et de former ainsi un puissant journal « indépendant », dont Mackenzie deviendrait l’administrateur et le rédacteur en chef. Celui-ci refusa, estimant que sa liberté serait menacée si d’autres personnes détenaient des actions dans le journal. Ses correspondants grits lui demandèrent ensuite d’appuyer Brown qu’ils en vinrent à considérer un an ou deux après comme le seul leader valable même s’ils n’étaient pas complètement satisfaits de ses vues sur la réforme. Mackenzie n’en continua pas moins de s’en prendre à Brown, quoiqu’il collabora quelque temps, en 1857, à la mise sur pied d’un comité exécutif réformiste dont la principale figure était le rédacteur en chef du Globe. David Christie, cette année-là, fut le seul qui tenta d’amener Mackenzie à faire partie d’un groupe de réformistes.
Mackenzie défendait obstinément à l’Assemblée les projets qu’il présentait. Entre 1854 et 1857, il fit adopter des mesures visant à convertir la monnaie au système décimal, à faciliter le règlement des élections contestées et à faire élire les maires par les citoyens plutôt que par les conseils municipaux ; il appuya également des projets recueillant l’assentiment populaire, tels que l’abolition des réserves du clergé, l’élection des conseillers législatifs, le financement des chemins de fer par l’entreprise privée et le traité de réciprocité. En sa qualité de président du comité des finances en 1854–1855, il établit des preuves de mauvaise administration financière et de favoritisme abusif avec une profusion telle qu’il embarrassa le gouvernement conservateur dirigé par sir Allan Napier MacNab et John Alexander Macdonald*. Pour un simple député, il accomplit un travail impressionnant dans le domaine législatif et il mena des attaques mordantes et efficaces ; ce fut un labeur qu’on minimisa, car l’on attendait plus de lui que des autres. Mackenzie en arriva à penser que la corruption de son époque et l’intolérable fardeau du régime de l’Union empêchaient la réalisation des véritables réformes. L’aggravation de sa situation financière le rendit encore plus pessimiste. Forcé d’interrompre la publication du Message en février 1855, il refusa néanmoins de travailler à plein temps pour l’Examiner et le Weekly Globe. Lorsque l’Examiner cessa de paraître, il publia à nouveau le Message en décembre 1855, même s’il ne pouvait se le permettre. Finalement, en mars 1856, Lesslie, Archibald Alexander Riddell et d’autres personnes lancèrent une campagne de souscription en vue de le récompenser pour son labeur incessant. Un montant d’environ $7 500 fut réuni et, bien que Mackenzie souhaitait se rendre en Angleterre, la collecte permit d’acheter une maison et d’avancer les fonds nécessaires à la publication du Message.
Comme son énergie diminuait et qu’il avait perdu tout espoir en l’avenir du Haut-Canada, Mackenzie, en août 1858, démissionna de son siège à l’Assemblée. Il ne publia plus le Message que de façon sporadique et il déclina l’invitation de se porter candidat au Conseil législatif ou à la mairie de Toronto. Il abandonna l’idée d’une nouvelle constitution pour le Haut-Canada et, en 1858 et 1859, il considéra de plus en plus sérieusement la possibilité d’une annexion aux États-Unis si la population venait à perdre toute illusion à l’endroit du gouvernement responsable. Lorsqu’il recommença à faire paraître régulièrement le Message en juin 1859, il prônait la rupture des liens politiques avec la Grande-Bretagne et il était d’avis que l’annexion allait suivre inévitablement.
Son moral remonta quelque peu quand arrivèrent les dons versés au fonds « Homestead ». Il approuva la liste des réformes essentielles qui fut dressée au congrès réformiste de 1859, refusant toutefois de faire partie d’un comité parce qu’il ne représentait aucune circonscription. Le fait d’avoir délaissé les obligations quotidiennes de la politique l’aida également à retrouver son entrain. Il vint en aide à ses amis durant les élections de 1861, mais le Message cessa presque entièrement de signaler les événements politiques, et les derniers commentaires qu’on put lire sur le destin du Haut-Canada montraient une certaine pondération. Au lieu de l’annexion, Mackenzie estimait désormais que les problèmes pouvaient être résolus par un genre d’union qui regrouperait la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada et l’Irlande. Il eut même des relations cordiales avec George Brown en 1861. Bien plus, à la fin de juin 1861, deux mois à peine avant sa mort, il avait recouvré assez d’enthousiasme pour caresser l’idée de briguer un nouveau mandat à l’Assemblée.
Mackenzie n’était pas pour autant un homme heureux. Il était talonné par ses créanciers ; le poids des années pesait sur lui et l’avenir de la province qu’il aimait lui paraissait sombre. Au cours des derniers mois de sa vie, on croit qu’il fut affligé de troubles mentaux car il refusa les secours de la médecine. Le 28 août 1861, il eut une attaque d’apoplexie qui lui fut fatale.
Durant les années 50, Mackenzie se considérait comme un individu solitaire menant un combat héroïque contre des forces écrasantes, et ce sentiment était avivé par les nombreuses lettres qu’on lui faisait parvenir pour louer ses efforts, même s’il obtenait peu de succès. Ces témoignages le soutenaient dans son combat autant, peut-être, que sa propre volonté. Bien que Mackenzie eut la satisfaction de voir George Brown adopter certaines de ses idées, il ne put voir son projet de démocratie populaire mis de l’avant. Il ne fut pas, dans les années 50, le leader qu’il avait été dans les années 30 : on ne pouvait guère compter sur lui pour le travail d’organisation politique ; il négligea de tenir des assemblées publiques comme celles qui lui avaient permis dans le passé de rejoindre la population et, comme il le disait fort justement, l’époque était trop prospère. Vivant dans l’abondance, les gens étaient portés à accepter la corruption et les erreurs d’administration. Cependant, malgré que Mackenzie mourut sans avoir jamais pris la tête d’un groupe de personnes partageant ses vues, le radicalisme dont il était le représentant exerça sur la politique ontarienne une influence considérable qui se fit encore sentir bien après la Confédération.
Les jugements portés par les historiens sur Mackenzie n’ont guère cessé de refléter l’opinion de Charles Lindsey qui, en 1862, lui attribua presque tout le mérite, ou le démérite, de la rébellion du Haut-Canada. En même temps, Lindsey conférait à l’insurrection un caractère de respectabilité, en affirmant à tort qu’elle avait été nécessaire pour permettre au Canada d’obtenir le gouvernement responsable. En faisant de Mackenzie un héros avant tout, on ne tient pas compte de certains traits de sa personnalité et on perpétue des conceptions historiques erronées ; on ne peut bien juger cet homme qu’en le considérant dans son intégralité. Dans une large mesure, il se comportait comme les marchands, les propriétaires et les entrepreneurs de son temps : s’il avait des idées radicales et parlait d’améliorer le sort des ouvriers et des fermiers, il s’opposait aux grèves tenues dans son propre atelier et, comme tous les gros commerçants, il était impitoyable envers ses débiteurs. Il se souciait peu des minorités, particulièrement des juifs et des Noirs, et, bien qu’il écrivit des articles enthousiastes sur l’amélioration du sort des pauvres, ses réalisations dans ce domaine sont inférieures à celles de Jessé Ketchum, des Baldwin ou de John Strachan. Puritain s’estimant chargé d’une mission et journaliste infatigable cherchant à se faire connaître du public, il contribua à propager les idées d’autrui et exprima d’une façon tout à fait sincère les doléances d’un grand nombre de citoyens du Haut-Canada avant la rébellion. L’époque était mûre pour un homme de sa valeur. Toutefois, ceux qui acceptent l’image d’un Mackenzie victime courageuse et solitaire de la persécution des tories oublient que d’autres réformistes connurent un sort semblable au sien, que les vexations dont il fut l’objet venaient généralement d’individus et non du gouvernement et qu’il les avait souvent provoquées par sa propre agressivité. Il demandait aux autres d’être logiques, mais il ne faisait pas la distinction entre les griefs importants et les plaintes insignifiantes et il manquait de suite dans les idées. Ses vues économiques étaient contradictoires : il faisait l’éloge des valeurs rurales du xviiie siècle tout en admirant les progrès du commerce et de la technologie. Il lutta contre l’intervention du gouvernement dans l’économie, mais le développement du Haut-Canada ne fut rendu possible que par un financement à long terme et des investissements de l’État. Enfin, les auteurs qui prétendent que Mackenzie, grâce à la rébellion, fut à l’origine d’une nouvelle ère politique au Canada négligent de souligner l’importance des conditions sociales et économiques nouvelles, des influences extérieures et des négociations qui permirent aux réformistes modérés et aux tories d’obtenir une nouvelle constitution.
Bien que Mackenzie ne cessa de craindre les monopoles, d’exiger un gouvernement démocratique et la disparition du favoritisme et de la prodigalité, les événements qui marquèrent ses dernières années – période que les historiens n’ont pas suffisamment étudiée – montrent bien que son action était limitée par l’étroitesse de ses vues et qu’il était incapable de se satisfaire d’aucune forme de gouvernement, qu’il s’agisse de celui du Haut-Canada, des États-Unis ou du Canada-Uni. Son besoin irrépressible de tout réformer, sa méfiance à l’endroit de toute autorité et sa soif insatiable d’indépendance personnelle laissent croire que sa seule règle de conduite était : « je suis contre ». Cependant, les attaques résolues qu’il mena contre ceux qui lui semblaient être les ennemis du Haut-Canada furent toujours motivées par le désir d’assurer le progrès de son pays d’adoption. En raison de l’amour profond qu’il éprouvait pour le Haut-Canada et du zèle ardent qu’il mit à défendre les intérêts de sa province, on peut affirmer que Mackenzie fut l’un des premiers nationalistes de l’Ontario.
Les papiers de Mackenzie sont rassemblés en deux collections principales : celle des PAO (Mackenzie-Lindsey papers) réunie par Mackenzie lui-même et celle des APC (MG 24, B18) réunie par William Lyon Mackenzie King*. La collection des PAO renferme également des fac-similés de la correspondance de Mackenzie provenant de collections américaines telles les papiers de William Henry Seward déposés à l’University of Rochester Library (Rochester, N.Y.). Les papiers de Mackenzie d’avant 1837 ont presque tous été détruits par sa famille durant la rébellion, mais on trouve encore quelques-unes de ses lettres dans la collection John Neilson (APC, MG 24, B1) et dans les papiers de Lesslie rassemblés au Dundas Hist. Soc. Museum (Dundas, Ont.). Cette dernière collection et les papiers de George Brown (APC, MG 24, B40) contiennent des données sur la dernière partie de la carrière de Mackenzie. Trois collections aux APC renferment des affirmations de divers participants à la rébellion au sujet de la conduite de Mackenzie à cette époque : RG 1, E3 ; RG 5, A1 ; et PRO, CO 42 (mfm aux APC). Aux PAO, on trouve également des informations utiles dans les documents relatifs à la rébellion de 1837. Un jugement sur l’attitude de Mackenzie durant le soulèvement et des renseignements sur les dernières années de sa carrière se trouvent dans les papiers de John Rolph (APC, MG 24, B24). Les papiers de David Gibson aux PAO contiennent quelques allusions à Mackenzie concernant ses activités avant et après la rébellion de 1837, de même que des documents importants sur le soulèvement et la participation de Mackenzie.
On peut lire une biographie de Mackenzie écrite par W. D. Le Sueur* qui traite principalement de sa carrière politique (des copies de ce texte dactylographié se trouvent aux University of Toronto Archives, aux APC et aux PAO) ; la famille Lindsey fit valoir devant les tribunaux que la biographie interprétait mal certaines informations tirées des papiers Mackenzie Lindsey et l’ouvrage ne fut jamais publié.
Il existe également de nombreux documents imprimés se rapportant à la carrière de Mackenzie. Il faut lire les publications gouvernementales alors qu’il était député, notamment : H.-C., House of Assembly, The seventh report from the select committee on grievances [...] (Toronto, 1835). On consultera avec profit l’ouvrage de F. B. Head, A narrative (Londres, 1839), réédité en 1969 par S. F. Wise. Mackenzie écrivit lui-même un grand nombre de livres et de brochures. Les principaux sont : A new almanack for the Canadian true blues [...] (2e éd., York [Toronto], [1833]), écrit sous le pseudonyme de Patrick Swift ; Sketches of Canada and the United States (Londres, 1833) ; Mackenzie’s own narrative of the late rebellion, with illustrations and notes, critical and explanatory [...] (Toronto, 1838) ; The sons of the emerald isle, or, lives of one thousand remarkable Irishmen [...] (New York, 1844) ; The lives and opinions of Benj’n Franklin Butler [...] and Jesse Hoyt [...] (Boston, 1845) ; et The life and times of Martin Van Buren [...] (Boston, 1846).
Les journaux publiés par Mackenzie sont une source inestimable de renseignements ; les plus importants sont : le Colonial Advocate, 1824–1834 ; la Constitution (Toronto), 1836–1837 ; le Correspondent and Advocate (Toronto), 1834–1837 ; la Mackenzie’s Gazette (New York), 1838–1840 ; le Rochester Volunteer (Rochester, N.Y.), 1841–1842 ; et le Mackenzie’s Weekly Message (Toronto), 1852–1860. Des textes choisis ont été colligés par Margaret Fairley dans The selected writings of William Lyon Mackenzie, 1824–1837 (Toronto, 1960), et par A. W. Rasporich dans William Lyon Mackenzie (Toronto, 1972). Il faut aussi consulter le Canadian Correspondent ([Toronto]), 1832–1834, qui fut publié par William John O’Grady et qui prit une attitude radicale. Le Christian Guardian, publié par Adolphus Egerton Ryerson à compter de 1829, montre le comportement de Mackenzie du point de vue des méthodistes. Les journaux s’opposant à Mackenzie furent le Canadian Freeman (York [Toronto]), publié par le réformiste Francis Collins, et le Courier of Upper Canada (Toronto) publié par le tory George Gurnett ; il ne subsiste que des collections incomplètes de ces journaux. Le Patriot and Farmers’ Monitor (Toronto), lancé à Kingston en 1828, fut dirigé par Thomas Dalton*, qui passa du groupe réformiste à celui des tories. Mackenzie rédigea aussi des articles pour un grand nombre de journaux, dont il n’était pas le directeur, y compris le New York Daily Tribune, d’Horace Greeley, et l’Examiner (Toronto), de James Lesslie.
On retrouve le Toronto de l’époque de Mackenzie dans Scadding, Toronto of old (Armstrong) et une description et de précieux renseignements dans Town of York, 1815–1834 (Firth). La première étude importante sur la carrière politique de Mackenzie fut faite par John Charles Dent* dans Last forty years et Upper Canadian rebellion. En réponse à ce dernier ouvrage, John King, le gendre de Mackenzie, fit paraître The other side of the « Story », being some reviews of Mr. J. C. Dents first volume of The story of the Upper Canadian rebellion, and the letters in the Mackenzie-Rolph controversy [...] (Toronto, 1886). À la fin du xixe siècle parurent deux autres études : Robina et K. M. Lizars, Humours of ‘37, grave, gay, grim : rebellion times in the Canadas (Toronto, 1897), et D. B. Read, The Canadian rebellion of 1837 (Toronto, 1896). Une dizaine d’années plus tard, la biographie de Mackenzie, rédigée par Charles Lindsey en 1862, Life and times of Mackenzie, fut revue par G. G. S. Lindsey, le petit-fils de Mackenzie, et publiée sous le titre de William Lyon Mackenzie (Toronto) en 1909.
Le premier auteur moderne qui étudia l’époque de Mackenzie fut Aileen Dunham, Political unrest in Upper Canada, 1815–1836 (Londres, 1927 ; réimpr., Toronto, 1963). Plusieurs années plus tard, Graig fit paraître son Upper Canada. Il existe deux biographies récentes : William Kilbourn, The firebrand : William Lyon Mackenzie and the rebellion in Upper Canada (Toronto, 1956), et David Flint, William Lyon Mackenzie : rebel against authority (Toronto, 1971). Dans S. D. Clark, Movements of political protest in Canada, 1640–1840 (Toronto, 1959), on trouve une étude sociologique de la rébellion.
On peut également consulter de nombreux textes dans les revues, notamment deux études importantes : Eric Jackson, The organization of Upper Canadian Reformers, 1818–1867, OH, LIII (1961) : 95–115, et F. C. Hamil, The reform movement in Upper Canada, Profiles of a province : studies in the history of Ontario [...] (Toronto, 1967), 9–19. Des articles portant plus particulièrement sur la carrière de Mackenzie ont été rédigés par L. F. Gates, qui prépare aussi une biographie des dernières années du patriote ; à lire : The decided policy of William Lyon Mackenzie, CHR, XL (1959) : 185–208 ; Mackenzie’s Gazette : an aspect of W. L. Mackenzie’s American years, CHR, XLVI (1965) : 323–345 ; et W. L. Mackenzie’s Volunteer and the first parliament of united Canada, OH, LIX (1967) : 163–183. R. A. MacKay a publié une intéressante analyse : The political ideas of William Lyon Mackenzie, Canadian Journal of Economics and Political Science (Toronto), III (1937) : 1–22. John Moir a traité de la carrière journalistique de Mackenzie aux États-Unis dans Mr. Mackenzie’s secret reporter, OH, LV (1963) : 205–213, et John Ireland [M. L. Magill] a étudié l’incident du Caroline dans Andrew Drew : the man who burned the Caroline, OH, LIX (1967) : 137–156. F. H. Armstrong a rédigé The York riots of March 23, 1832, OH, LV (1963) : 61–72 ; Reformer as capitalist : William Lyon Mackenzie and the printers’ strike of 1836, OH, LIX (1967) : 187–196 ; William Lyon Mackenzie, first mayor of Toronto : a study of a critic in power, CHR, XLVIII (1967) : 309–331 ; et William Lyon Mackenzie : the persistent hero, Journal of Canadian Studies (Peterborough, Ont.), VI, n° 3 (août 1971) : 21–36. J. E. Rea a préparé une bibliographie dans Rebellion in Upper Canada, 1837, HSSM Trans. (Winnipeg), 3e sér., n° 22 (1965–1966) : 87–94, et dans William Lyon Mackenzie— Jacksonian ? Mid-America : an Hist. Quarterly (Chicago), L (1968) : 223–235. [f. h. a. et r. j. s.]
Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie
Frederick H. Armstrong et Ronald J. Stagg, « MACKENZIE (McKenzie, MacKenzie), WILLIAM LYON », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 4 févr. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/mackenzie_william_lyon_9F.html.
Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique
| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/mackenzie_william_lyon_9F.html |
| Auteur de l'article: | Frederick H. Armstrong et Ronald J. Stagg |
| Titre de l'article: | MACKENZIE (McKenzie, MacKenzie), WILLIAM LYON |
| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9 |
| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
| Année de la publication: | 1977 |
| Année de la révision: | 1977 |
| Date de consultation: | 4 févr. 2026 |